Les élections européennes de juin 2024 ont eu lieu. Aussitôt passée l’euphorie pour les uns, la déception pour les autres, ce fut le séisme politique en France, à travers l’annonce de la dissolution de l’Assemblée nationale par le président de la République. Et la panique qui s’est aussitôt emparée de tous les états-majors, pressés de s’organiser par la proximité des nouvelles échéances. Quels constats ou réflexions peut-on brièvement en tirer ? Voici quelques-uns de ceux que je peux livrer à titre personnel.
Sur le plan des élections elles-mêmes
De manière générale, je me fais peu d’illusions au sujet de la politique, qui me semble occuper une place trop importante dans la vie quotidienne, dans les opinions sur tous les sujets, trop systématiquement politisés et donc pervertis par cette politique omniprésente, y compris là où elle ne devrait pas se nicher, c’est-à-dire partout.
L’information tourne beaucoup trop autour de la politique et des élections futures. À peine un président élu, on en est déjà quelques mois après à deviser sur ses perspectives de réélection ou sur les chances de tel ou tel de devenir son successeur. Cela occupe les Français, qui en font un sujet souvent central ou de discussions animées de tous les jours, malgré l’insignifiance relative de leur vote.
Pire, occupés à deviser sur les chances de tel ou tel d’accéder à la fonction suprême, ou de tel ou tel parti à s’imposer dans la vie politique, le vote ne porte plus véritablement sur ce qui devrait être le sujet central – ici les élections européennes – mais plutôt sur l’appréciation que l’on a de tel ou tel mouvement, de la protestation que l’on entend faire entendre (le plus souvent à l’égard de celui qui gouverne), considérant alors le vote davantage comme un moyen de sanction ou de militantisme que comme une adhésion à des idées ou des propositions.
Hélas, on sait que la plupart des politiques naviguent en fonction des circonstances et des passions collectives.
Leurs chances d’accéder au pouvoir, et donc d’espérer pouvoir orienter celui-ci plutôt dans le sens de leurs idées, dépendent de leur capacité à pervertir ces mêmes idées et à les diluer dans un tas de compromissions sans lesquelles l’horreur politique les empêcherait très probablement d’y songer un instant.
La politique se résume bien trop souvent à l’art de la propagande et du mensonge, de la pensée binaire (pour ou contre), de la simplification à outrance, sans laquelle on suppose que les messages ne pourraient avoir aucune portée. Le réalisme s’accommode mal de la complexité, on le sait.
La perspective permanente des élections suivantes suscite la politique spectacle, ce qui n’est pas nouveau mais dont un parti comme LFI s’est fait le chantre, animant pour les uns une vie politique devenue ennuyeuse, achevant pour les autres de la décrédibiliser, tant ce spectacle est devenu puéril et désolant, si ce n’est parfois glauque et inquiétant.
Dans ce spectacle permanent et enivrant qui rythme la vie de nombreux Français drogués à cette téléréalité bien affligeante, les sondages jouent un rôle non négligeable. Entretenant cette dépendance à ce spectacle dont on est impatient de connaître le prochain épisode, mais qui a aussi et surtout pour effet de modifier les comportements des plus zélés et d’influer sur les résultats. Jusqu’à susciter des comportements opportunistes accélérant encore l’issue du vote, comme avec l’idée du « vote utile » (pas toujours justifié).
D’autres Français, las de toute cette vacuité ou tout simplement complètement perdus par des successions d’arguments mélangés et contradictoires parmi lesquels il est bien difficile de se retrouver, se réfugient dans l’abstention, qui n’est en réalité qu’un mélange hétéroclite de réalités très diverses et dissemblables, mélange à la fois de fatalisme, d’indifférence, de tentation de la protestation ponctuelle ou systématique (sans forcément de lendemains), voire de capitulation. Mais que les effets de la mémoire courte et de la légitimité du vote balayent bien rapidement.
D’autres encore espèrent – sans doute vainement – que soit reconnu le vote blanc, qui là encore peut être sujet à conjecture tant il peut lui aussi se révéler hétéroclite et sujet à interprétation.
Bien plus que par des idées extraordinaires, novatrices ou transcendantes, il est de fait que quelle que soit l’époque, parmi ceux qui sont encore électeurs, leur choix est mu pour beaucoup par des considérations relativement insignifiantes : l’aspect physique du candidat, son sourire, son apparence, son air engageant (le sourire et la jeunesse de Rima Hassan, comme naguère la « belle gueule » de Che Guevara sur cette photo qui a tant fait rêver les hordes de ceux qui l’ont exhibé ou l’exhibent encore sur leur t-shirt sans bien savoir qui il est… ou les méfaits particulièrement scabreux dont il est l’auteur). Sans oublier ceux qui se sont fait élire soit parce que leur marionnette sympathique proclamait chaque jour à la télévision « mangez des pommes » ou ceux qui se disaient ennemis de la méchante finance et entendaient s’afficher en « président normal ».
Le choix peut aussi être motivé simplement par des considérations très terre à terre : la facture de gaz qui augmente, l’âge de départ à la retraite, ou que sais-je encore.
Sans oublier la valeur étonnante que peut revêtir une étiquette (« En Marche », à une certaine époque, plus maintenant), qui a pu suffire à certains à se faire élire rien qu’en apposant ce label sur leur candidature (ou celle du « Nouveau Front Populaire » qui, avec sa débauche de promesses folles où il y en a pour presque tout le monde, devrait réaliser un véritable raz-de-marée aux prochaines élections législatives. Non sans « courage », affirme sans vergogne (sic) un certain Fabien Roussel qui n’hésitera pas avec ses nouveaux compères et consoeurs du jour à faire couler à flot – plus encore que les prédécesseurs immédiats – comme nous ne l’avons encore jamais vu, l’argent qui n’existe pas, sans souci des lendemains qui déchantent).
Sur le plan des perspectives politiques
La période qui s’ouvre est particulièrement critique, inquiétante, pourvoyeuse de petites et grandes trahisons. Jamais nous ne sommes arrivés à une telle période de trouble, de déliquescence avancée, d’incertitude absolue, même si ce n’est là que le fruit des erreurs, renoncements et perversions politiques. La France et son économie, atteintes dans leur stabilité, leur réputation et leur crédibilité, devraient rapidement en subir les effets délétères.
Les marchandages politiques vont bon train. Certains sont prêts à vendre leur âme (même si ce n’est pas entièrement nouveau).
D’autres (généralement affichés à gauche ou à l’extrême gauche) brillent une fois encore par leur refus de la démocratie, ou de leur conception de la démocratie comme étant à géométrie variable (manifestations pour rejeter le vote RN, intolérance pour tout ce qui s’écarte de leurs idées). Qu’ils n’emportent pas le pouvoir et ils ne manqueront pas de tenter une nouvelle fois d’organiser la révolution de leurs rêves.
L’abstention ne me paraît pas être une perspective dont il y aurait quelque chose à espérer. Comme je l’écrivais dans un article à ce sujet à la suite des dernières élections municipales :
« Grenoble vit de plus en plus dans l’insécurité ? Les finances vont de plus en plus mal ? Les promesses tenues en matière d’écologie (et surtout les piètres résultats en la matière) vous semblent ne pas avoir été respectées ? Même chose à Paris ? Eh bien on ne peut constater que ce point de vue n’est officiellement pas partagé, puisque ces équipes ont été brillamment reconduites ».
Nous aurions tort de croire qu’il suffit de confier le poste de Premier ministre à quelqu’un en pensant que forcément son incompétence sera révélée au grand jour, et que lui et son parti se seront compromis pour la suite. La politique ne fonctionne pas ainsi, beaucoup d’autres facteurs entrent en ligne de compte, et les électeurs ont souvent la mémoire courte.
À ceux qui veulent par exemple éviter l’arrivée au pouvoir de Mélenchon et ses affidés, il est recommandé de songer que l’abstention renforce son poids relatif dans les résultats, puisque n’importe quel autre vote, quel qu’il soit, baissera son score proportionnellement (avis aux abstentionnistes).
Et nous ne saurions trop nous méfier du vote punitif. D’aucuns voulaient envoyer un message fort en s’abstenant de voter pour Nicolas Sarkozy qui les avait déçus… ils ont eu François Hollande. Ce ne pouvait pas être pire. Puis ils ont puni Hollande en élisant Macron… Ce fut sans doute pire encore. Il fallait donc punir Macron, et on a abouti à la situation où le RN ou LFI sont en mesure d’aspirer à gouverner. Qui peut croire que le vote punitif suffit à nos politiques à tirer les leçons de leurs égarements permanents ?
En conclusion
La politique est source de conflits et de perversion. Elle est faite d’inconstance et de trahisons. Elle est bien trop souvent à courte vue, et repose beaucoup sur les circonstances et combinaisons du moment. Mais sans être notre horizon indépassable, et faute de songer à interdire les partis politiques, la démocratie conserve les défauts qu’elle a toujours eus par nature depuis ses premières origines. Il est donc vain de croire que l’on pourra espérer des transformations radicales par le simple fait de s’abstenir. Comme il est vain de croire que le chaos est souhaitable pour que les choses changent et que les politiques en tirent les leçons. Ce ne sont alors que les plus extrêmes ou opportunistes qui se chargeront d’en récolter les fruits.
La surenchère dans les promesses est ce qui risque bien une nouvelle fois de l’emporter. Celui qui gagnera les élections, dans les conditions actuelles et après plusieurs décennies d’illusion donnée aux Français que l’État peut tout et est en mesure de pourvoir à tous nos besoins (quoi qu’il en coûte), sera celui qui promettra aux électeurs de diminuer immédiatement l’âge de départ à la retraite (hors toute considération de bon sens ou de moyen terme), qui promettra de faire payer « les riches », qui assurera qu’il baissera la facture de gaz des ménages, ou tout autre fantasme susceptible de rameuter les foules à bon compte et sans souci des lendemains bien sombres qui ne manqueront pas d’en découler.
Dans ce contexte, il n’est cependant jamais inutile de persévérer dans l’idée qu’il reste possible par l’éducation, l’argumentation patiente, le débat, la transmission, de faire évoluer peu à peu les idées. Même si cela prend du temps – beaucoup de temps – et, qu’en attendant, bien des drames et désillusions se produiront.
Pour ceux qui aspirent à davantage de libéralisme, il n’est pas évident de s’y retrouver. Le terme « libéral » lui-même est galvaudé. Ceux à qui on attribue cette étiquette, que ce soit aux États-Unis où c’est pire encore, ou ici-même, en Europe comme en France (Macron est encore parfois qualifié de libéral !) ne le sont pas. Le libéralisme lui-même n’a pas vocation à se mêler de politique et à se constituer en tant que mouvement, alors qu’il s’agit d’un état d’esprit, d’une philosophie.
Nous le savons là encore, libéralisme et démocratie ont beaucoup de mal à s’accorder. Alexis Tocqueville avait déjà montré le caractère despotique de la seconde. Et il est bien difficile de se sentir pleinement satisfait, faute de mieux, sinon de son mode de fonctionnement, du moins de ses résultats. Il n’en reste pas moins que transmettre et diffuser les valeurs du libéralisme, notamment en direction de certains politiques qui pourraient s’en inspirer au moins partiellement, n’est pas une chose vaine. En d’autres temps, en d’autres lieux même aujourd’hui, cela existe. C’est donc que c’est possible. Sur le temps long. Et toujours avec l’idée que les choses sont fragiles et les succès temporaires.
En ces temps où l’on pourrait être tentés de baisser les bras, il est donc toujours utile de continuer de défendre nos valeurs, de les transmettre, de les diffuser, de débattre, d’argumenter. Pour que vive la liberté.
—
À lire aussi :
- Le mythe de la démocratie, de Lucian Boïa
- La démocratie est-elle vouée à disparaître ?
- Pourquoi je serais plutôt aristocrate, de Vladimir Volkoff
- Jean-François Revel : regard sur la démocratie et les institutions
- Jean-François Revel : La tentation totalitaire
- Le diable dans la démocratie, de Ryszard Legutko
- Discours de la servitude volontaire, d’Étienne de La Boétie
- Le procès de Socrate – Un philosophe victime de la démocratie ? de Claude Mossé
- La Démocratie des crédules de Gérald Bronner
- L’école peut-elle sauver la démocratie ? de François Dubet et Marie Duru-Bellat
- L’univers totalitaire en littérature et au cinéma (7 volets)
- L’enfer est pavé de bonnes intentions (18 volets) – Les totalitarismes
- Hannah Arendt – Socrate et la question du totalitarisme
- La liberté d’expression mal en point
- La liberté d’inexpression, d’Anne-Sophie Chazaud
- Histoire de l’humanisme en Occident, d’Abdennour Bidar
- « La Révolution française et la psychologie des révolutions », de Gustave Le Bon
- Pourquoi nous n’aimons pas la démocratie, de Myriam Revault d’Allonnes
- Le crépuscule de l’universel, de Chantal Delsol


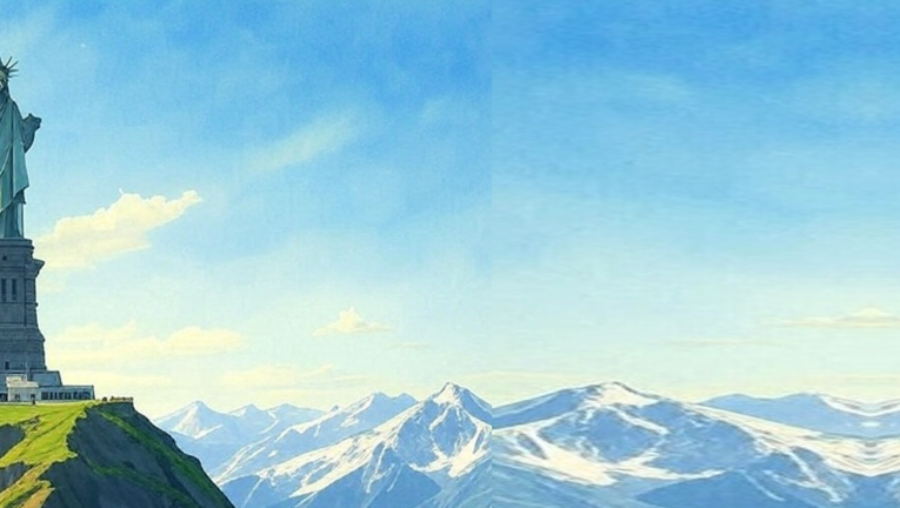


“Nous le savons là encore, libéralisme et démocratie ont beaucoup de mal à s’accorder”
Voilà bien un propos dangereux, de la veine que les insanités débitées quotidiennement par LFI.
Dangereux et faux. Tocqueville ou pas.
Car les deux ont toujours marché de concert, s’épaulant mutuellement.
Le libéralisme ne saurait être un despotisme éclairé. C’est même contraire à son histoire, s’étant construit contre les despotismes.
Merci pour votre réaction. Je vous invite toutefois à cliquer sur le lien en référence accompagnant ce propos. La question n’est évidemment pas si simple et tranchée qu’il y paraît (en témoigne aussi la petite liste de références sous l’article), même si je comprends ce que vous voulez exprimer. Et certainement pas “de la même veine que les insanités” que vous dénoncez. Il s’agit d’un sujet d’étude de très longue date et qui a fait l’objet de nombreuses études ; non d’une lubie du moment.
En échange, je vous propose la lecture de “Prospérité, puissance et pauvreté : Pourquoi certains pays réussissent mieux que d’autres” de Daron Acemoglu.
Je vous remercie pour la référence. A première vue, cet ouvrage semble en effet très prometteur et certainement passionnant.
Excellent article qui se conclut un peu maladroitement en opposant démocratie et libéralisme alors qu elles sont complémentaires