Quoique le non-exercice du droit électoral par une partie importante des citoyens en droit de voter soit au fond un phénomène assez ancien, il n’attirait pas la même attention à l’époque des comices, des états généraux et des assemblées provinciales. Et certainement c’était justice : car c’est surtout lorsque le désengagement de la puissance publique est devenu une nécessité vitale, que le désengagement du citoyen du processus démocratique se présente comme un problème, et même comme un danger.
Le vote est une forme de l’exercice de la liberté, et l’abstention est un choix politique. Dans la grande bataille des idées, ce n’est toutefois pas autre chose qu’une capitulation. Et il n’en est pas ici comme des grands rois, qui, ayant contemplé une bataille depuis un poste reculé, pouvaient bien à leur aise, à l’abri du danger, célébrer leur victoire ; car l’abstentionnisme est une pratique rarement gagnante. D’abord, l’abstention, pour autant qu’elle reste minoritaire, ne peut légitimement servir de motif pour l’invalidation du résultat d’une élection, soutient Benjamin Constant.
« Si l’on considère comme une nullité dans une élection l’absence d’une fraction d’électeurs, cette nullité aura lieu toutes les fois qu’un parti vaincu cherchera dans l’inertie les ressources que la force lui refuse. » (Mémoires sur les Cent-Jours ; Œuvres complètes, t. XIV, p. 272)
C’est pourtant la position de repli, auxquels sont arrivés par exemple les socialistes, en 1851, pour signaler leur opposition aux nouvelles restrictions portées contre les modalités du suffrage ; Gustave de Molinari a raison, dans la presse, de critiquer leur choix ; seules ses moqueries sont à cet endroit mal placées. (Voir notamment La Patrie du 9 janvier 1851 ; O. C., t. VIII, p. 24-27).
À lire aussi
Le Green Deal européen survivra-t-il aux élections européennes de juin prochain ?
L’abstentionnisme est une forme de défaitisme et même de fatalisme. Il touche surtout les minorités, qui, quoique très fragiles face au pouvoir absorbant de l’État, ne veulent pas même se déranger, se sentant certaines de leur défaite. C’est là un problème politique qui doit intéresser les spécialistes des questions politiques des deux côtés de l’Atlantique, soutient Édouard Laboulaye. (Histoire politique des États-Unis, t. III, 1866, p. 338.) Au lieu de défendre leurs libertés et leurs droits, devant la menace socialiste grandissante, trop d’électeurs, dit aussi Yves Guyot, « s’éloignent des urnes et s’abandonnent au destin comme des musulmans fatalistes », selon une pratique qui est tout sauf raisonnable. (« L’abstention électorale », Le Siècle, 1er mars 1895)
L’abstention a pour conséquence la sur-représentation des catégories d’électeurs qui exercent avec plus de diligence leur droit électoral. Elle peut conduire, et elle conduit fréquemment à l’asservissement discret d’une génération par une autre. (Paul Leroy-Beaulieu, « L’État moderne et ses fonctions », 2e article, Revue des Deux-Mondes, 1er octobre 1888, p. 564.)
Quel système électoral ?
Pour répondre aux périls que l’abstention fait courir, Édouard Laboulaye, notamment, réfléchit à une réforme du système électoral qui puisse permettre à chaque électeur de faire entendre sa voix. Imaginons par exemple, dit-il, que du fond de sa province un électeur ait des sympathies pour un candidat de Paris. S’il sait qu’il peut l’aider de sa voix, il votera, et le scrutin n’en sera que plus représentatif des vrais sentiments du pays. Ce système doit être bien étudié et perfectionné, mais à l’évidence il y a quelque chose à chercher de ce côté. On a commencé à y songer en Angleterre et aux États-Unis. (Histoire politique des États-Unis, t. III, 1866, p. 339.)
Dans la discussion des causes de l’abstention, on porte souvent accusation contre le libéralisme, selon un enchaînement bien connu : le libéralisme produit l’individualisme, qui lui-même produit l’abstentionnisme électoral.
Cette critique, assurément, n’est pas sans fondement.
En séparant nos intérêts particuliers des intérêts de la masse, et en les mettant à l’abri des atteintes dans une sorte de nouvelle forteresse, le libéralisme est assez susceptible de conduire au désintérêt et à l’abstention politique. Contre Germaine de Staël, qui ne voyait que la chance et l’avantage de la liberté des modernes, Benjamin Constant était plus désabusé, mais surtout plus perspicace, quand il faisait remarquer que la liberté moderne, individualiste, produisait naturellement une forme d’indifférence pour les affaires publiques. (É. Hofmann & F. Rousset, Le groupe de Coppet, 2005, p. 105)
« Le danger de la liberté moderne », écrivait-il, « c’est qu’absorbés dans la jouissance de notre indépendance privée, et dans la poursuite de nos intérêts particuliers, nous ne renoncions trop facilement à notre droit de partage dans le pouvoir politique. » (De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes ; O. C., t. XV, p. 310)
L’individu est retranché dans sa forteresse nouvelle, acquise à si grands frais ; désormais, dans tous les aspects de sa vie, il est à craindre qu’il ne porte plus des regards qu’accidentellement vers la sphère d’action des hommes qui l’entourent. (Commentaire sur l’ouvrage de Filangieri ; O. C., t. XXVI, p. 314)
Le point de vue de Tocqueville
Alexis de Tocqueville partageait assez ce point de vue. Devant les effets politiques de l’individualisme nouveau, il croit qu’il y a une éducation civique à faire ou à refaire.
Il s’agit de montrer à l’électeur le lien étroit qui unit ses affaires privées aux questions politiques pour lesquelles il reste indifférent. À celui qui se démène, couvre de grandes distances pour s’assurer un salaire, mais qui ne se rend pas au scrutin organisé devant chez lui, la juste méthode serait de lui prouver qu’il fait décidément un mauvais calcul.
« Ce serait, se plaçant sur le terrain étroit qu’il a choisi lui-même, de lui montrer qu’en effet suivant que l’État sera bien ou mal gouverné et que l’administration publique sera dans telle main plutôt que dans telle autre, il sera ou plus riche ou plus pauvre, qu’il n’y a rien qui ait plus d’influence sur la vie privée que les choix qu’on fait dans la vie publique, et que, pour tout dire en un mot, la plus importante de toutes les affaires pourrait bien être le soin à donner aux affaires publiques. » (Brouillon d’article ; O. C., t. III, vol. 3, p. 398)
Il suffit pour cela, continue Tocqueville, de dresser la liste de tous les pouvoirs d’un maire, par exemple, et les mille sortes d’influence que son action quotidienne a sur la vie du plus humble des citoyens.
Si le libéralisme, dans sa phase ascendante, peut avoir pour effet d’accroître l’absentéisme électoral, ce n’est pas à dire qu’il en soit la seule cause, présente ou future. La surexcitation du système politique est aussi un facteur connu d’absentéisme.
Bon observateur des phénomènes politiques en France et aux États-Unis, Édouard Laboulaye constate :
« Avec des élections trop fréquentes, on arrive à des résultats politiques détestables. Les gens tranquilles sont fatigués par ces élections perpétuelles et deviennent indifférents. » (Histoire politique des États-Unis, t. III, 1866, p. 353.)
Le déclin de la liberté a aussi beaucoup de raison de favoriser l’abstention. Quand la pratique de la liberté politique est réelle et sérieuse, dit Gustave de Beaumont, elle a plutôt pour effet de passionner les citoyens à la défense des intérêts généraux ; mais quand la liberté disparaît, quand la corruption électorale trouve devant elle une large carrière, le peuple plonge irrémédiablement dans l’indifférence. (sur la réforme parlementaire et la réforme électorale, Le Siècle, 22 février 1847. — Proposition de loi pour assurer la liberté des votes dans les élections, mars 1844, p. 9)
Et Benjamin Constant lui-même, qui, on l’a dit, alerte sur les tendances abstentionnistes de la liberté moderne, reconnaît aussi que la désaffection politique possède aussi des sources antilibérales. La compression des libertés locales, l’extension abusive de la centralisation, notamment, produisent ces effets. La centralisation détruit la vie locale, où les intérêts en jeu sont plus aisément perceptibles, où l’influence d’un électeur isolé est aussi mathématiquement supérieure. (De la liberté des Anciens, etc. ; O. C., t. XV, p. 300.)
Il est dans la nature de l’homme de s’attacher aux intérêts de la petite localité dans laquelle son existence se passe ; rejeté violemment dans une masse trop grande, il est tout déboussolé, et ne peut tisser des liens avec elle. (Principes de politique ; O. C., t. IX, p. 786).
À lire aussi
Abstention : la politique doit se moderniser pour séduire
Il n’en demeure pas moins qu’un libéral radical trouve rarement à voter pour un candidat qui représente ses idées ; et supposant qu’à droite et à gauche figurent des candidats qui sont tous interventionnistes et protectionnistes, Gustave de Molinari trouve qu’on a toutes les raisons pour ne pas voter ; mais qu’alors ce ne soit pas indifférence, car il faut plutôt redoubler d’efforts pour faire l’éducation du pays. (L’Économiste Belge, 1856, n° 10, p. 2 ; O. C., t. XII, p. 159)




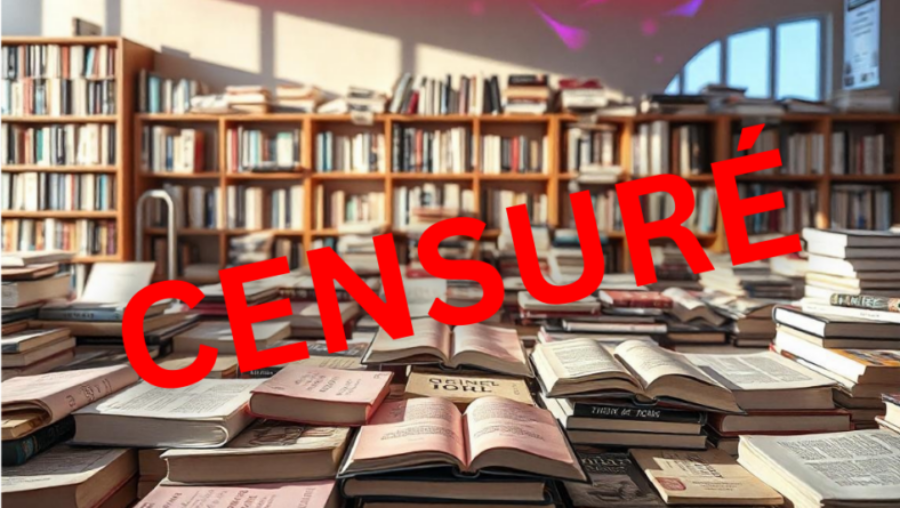
L’abstention… La voir comme un taoiste : être là sans agir !
Franchement, à quoi sert de voter pour un parti qui promet des choses qu’il ne fera pas et fera ce qu’il n’a pas annoncé ?
Le résultat d’un referendum, ça engage (et encore). Le résultat d’une élection ? Que dalle !
L’abstentionniste… Garde les mains propres même s’il n’a pas de mains !
Je trouve que l’argument de ne pas aller voter car ça sert à rien ou que les gars sont des charlatans est très léger.
Le vote blanc devrait avoir plus de visibilité (dans un premier temps car non pris en compte actuellement), puis un véritable impact (quand la visibilité sera à un tel point qu’il pourra avoir un impact). Cela permettrait peut être aux “fébriles” et “défaitistes” de se déplacer.
Ensuite, la crédibilité des abstentionnistes se détériorent quand ceux là même vont manifester contre le gouvernement et provoquant de la casse (généralement)…
La règle est pourtant simple = si tu ne vas pas voter alors que tu le peux, tu n’as pas ton mot à dire pour la suite… C’est le principe même de notre système.
Les mêmes abstentionnistes s’empresseraient très certainement d’aller dans la rue pour demander le droit de vote dans un régime de dictature…
On en fait quoi, du vote blanc ?
A partir de quel niveau lui fait-on produire des effets, et lesquels ?
Si on considère qu’il l’a emporté, on prend les mêmes et on recommence? Succès assuré. On cherche de nouvelles têtes, des inconnus ? De même.
Le vote blanc n est qu une baudruche……pschitt….🤣🤣🤣🤣.
“passionner les citoyens à la défense des intérêts généraux”
Justement, plus on se passionne pour l’enjeu, plus on a envie de militer pour convaincre un maximum d’électeurs de faire “le bon choix” mais moins on a envie d’aller déposer son propre bulletin désespérément inutile tant son poids est négligeable. Dans ce cas, on ne s’abstient pas par indifférence ou par défaitisme mais par lucidité sur l’exiguïté de sa propre influence.
Et dans la mesure où le vote est facultatif, participer volontairement à ce jeu c’est s’engager à reconnaître la validité du résultat même s’il est aussi désastreux qu’on le prévoit: s’abstenir c’est éviter d’en être complice.
Que le citoyen vote ou pas a une élection, il se doit de reconnaître les résultats
Ce serait un peu facile pour se dédouaner à bon compte de la politique
On sens une volonté de ne pas assumer sa responsabilité…..celle d être un citoyen avec ses droits ( de voter……) mais aussi ses devoirs ( reconnaître les résultats du vote……)
Notre société réclame toujours haut et fort ses droits tout en passant sous silence ses devoirs…..