Des leçons utiles et passionnantes, pour y voir plus clair sur quelques-unes des grandes questions économiques contemporaines.
Douze ans après ses 8 leçons d’histoire économique, Jean-Marc Daniel nous propose 10 nouvelles leçons. Toujours avec l’idée qui lui est chère que les événements qui se produisent paraissent souvent inédits, exceptionnels, voire particulièrement dramatiques, à ceux qui les vivent. Ces derniers omettant toutefois que, dans nombre de situations, les leçons du passé auraient permis de s’apercevoir qu’il n’en est rien. A l’instar de ce qu’Alfred Sauvy en son temps dénonçait, lorsqu’il évoquait par exemple le déficit de connaissance ou de rigueur intellectuelle dans son ouvrage L’économie du diable.
L’économie au service du bien social
Dès l’introduction, en référence au premier professeur d’économie de l’histoire, l’Anglais Nassau William Senior, Jean-Marc Daniel rappelle en quoi l’économie a pu être considérée comme une science, se distinguant en cela de la propagande et de la politique. Il s’agissait de diffuser un savoir, avec pour intention d’améliorer le bien-être social. Ce que ne renierait aucun libéral. En ce sens, Nassau William Senior s’opposait aux protectionnistes.
Il disait simplement que l’économiste établit que le libre-échange, en faisant baisser les prix, améliore le pouvoir d’achat de tous, alors que le protectionnisme, en empêchant la concurrence, avantage certains secteurs. L’économiste considère que son rôle est de concevoir les politiques qui améliorent la situation globale de la population. Le protectionniste est celui qui choisit de favoriser une partie de la population au détriment de l’autre, choix qui, n’étant pas justifiable économiquement, trouve d’autres justifications – politiques, éthiques ou religieuses (…) La rigueur scientifique impose à l’économiste de ne pas chercher à justifier l’action du décideur par des théories fausses, mais de lui fournir des moyens d’apprécier les conséquences de ses actes. C’est plus nécessaire que jamais de nos jours où le ralentissement de la croissance interroge sur la capacité des théories économiques à fournir les moyens de la relancer.
L’importance de l’histoire en économie
C’est ce qui explique aussi que, en plus des théories et de l’appui des outils mathématiques et statistiques, l’histoire constitue la matière expérimentale de l’économiste, celle qui permet de confronter les affirmations de la science économique à la réalité historique.
Ce dont souffre l’économie, c’est de la méconnaissance qui l’entoure et de la pollution de son message par des prises de position qui semblent devoir d’autant plus fasciner le public qu’elles sont fallacieuses. Il est facile de susciter l’enthousiasme contre l’égoïsme du marché ou de trouver des soutiens dans la dénonciation de la nocivité de tel ou tel impôt. Mais il est plus austère et plus ingrat de chercher à faire comprendre les thèses de Coase sur la taille optimale de la firme, de s’interroger sur le traitement des externalités chez Pigou, de démonter le théorème de Debreu-Arrow ou plus simplement de définir les missions de l’Etat.
Et c’est bien d’histoire dont il va être question dans cet ouvrage, avec tout le talent, la connaissance et le sens des anecdotes passionnantes qui font le style de Jean-Marc Daniel.
On perçoit mieux ainsi, pour commencer, à quel point les banqueroutes qui se sont multipliées durant de nombreux siècles ont partie liée avec la propension des Etats à mener des guerres de conquête, avec le pillage comme moyen privilégié de les financer, promesse faite (mais finalement souvent pas tenue) aux banquiers de l’époque de les rembourser par ce moyen.
Jusqu’à ce que, de banqueroute en banqueroute, la création des banques centrales vienne assurer le rôle de banquier exclusif de l’Etat, puis de payeur en dernier ressort. Jusqu’à nos jours, où nous avons tendance à vivre dans l’illusion que la dette publique est sans limite.
Question de crédibilité. Une crédibilité qui est liée à la capacité d’un Etat à percevoir l’impôt, meilleur moyen d’éviter la dette et de se donner la possibilité d’une véritable croissance économique durable autre que par le pillage sans lendemain des voisins. Ce qui est l’objet d’un autre chapitre savoureux au cours duquel on perçoit parfaitement, nombreuses illustrations historiques à l’appui, à quel point le fisc est capable d’une imagination sans limite.
Dépenses publiques, dette, croissance
Un chapitre passionnant sur les dépenses publiques permet d’illustrer la manière dont elles peuvent conduire à des dérives en matière de dette, puis d’obstacle à la croissance. Un chapitre qui démarre avec la juste analyse de Machiavel selon laquelle dépenser en espérant, pour le gouvernant, en retirer une réputation ne sert à rien, dans la mesure où les bénéficiaires sont des ingrats (on peut en effet constater aujourd’hui encore que les contribuables se souviennent rarement des avantages fiscaux dont il arrive qu’ils bénéficient, tandis qu’ils ont une forte propension à se plaindre constamment du sentiment de ne pas suffisamment recevoir de l’Etat. Quand ce n’est pas simplement l’Envie qui régit les comportements).
Il est donc sage de se résoudre à être appelé avare, qualité qui n’attire que du mépris sans haine, que de se mettre, pour éviter ce nom, dans la nécessité d’encourir la qualification de rapace, qui engendre le mépris et la haine tout ensemble.
De Jean-Jacques Rousseau à William Gladstone en Angleterre, et sa vision libérale de l’Etat minimal, en passant par Joseph de Villèle, ministre des Finances partisan de la réduction sans concession des dépenses publiques, sous la Restauration, ou encore Leroy-Beaulieu, on voit que l’esprit du XIXe siècle était bien éloigné de celui qui a ensuite dominé depuis le XXe siècle, conforme quant à lui à la loi de Wagner selon laquelle « si la dépense s’élève sans cesse, c’est que l’Etat y trouve le moyen d’assurer sa pérennité ».
D’un niveau de dépenses publiques d’environ 14% du PIB en 1830 et toujours à ce niveau en 1913, on est ainsi passés comme on le sait à 56% aujourd’hui.
Déjà en son temps, nous rappelle Jean-Marc Daniel, Turgot se débattait pour tenter de baisser les dépenses publiques et les nombreux gaspillages qu’elles induisent inéluctablement. L’histoire bégaie…
Car la croissance joue un rôle majeur en économie, au-delà du problème de sa mesure. Un autre chapitre nous en montre les enjeux, à travers les travaux de Simon Kuznets ou Robert Solow, entre autres auteurs fondamentaux. C’est un état d’esprit auquel ne sont pas étrangers l’entrepreneur, le rôle du progrès technique, de l’investissement ou encore de la concurrence, comme du libre-marché, de l’énergie bon marché, ou des transformations sociétales, notamment. Les révolutions entamées à Berlin en1989, et qui se sont prolongées dans les pays émergents ensuite, sont sur ce point fondamentales :
Les années de croissance que ces pays ont devant eux ne seront pleinement efficaces que lorsque le processus d’élimination des kleptocrates « post-brejnéviens » sera terminé. C’est alors en effet que la dynamique de l’épargne et de l’investissement, de la concurrence et de la destruction créatrice pourra se faire de façon durable et équilibrée.
Travail, transition énergétique, monnaie, inflation
Sur le travail, Jean-Marc Daniel rappelle comment les hommes politiques se sont fourvoyés sur la question du droit au travail au XIXe siècle, puis de la prétention du communisme mais aussi du keynésianisme à parvenir au plein-emploi. Quand ce ne sont pas la crainte du progrès technique ou le droit à la paresse qui pervertissent les mécanismes de base du raisonnement économique.
Au sujet de la transition énergétique, il rappelle de manière passionnante comment l’économie mondiale s’est développée au cours de siècles successivement grâce aux différentes sources d’énergie de référence que nous connaissons, mais aussi la manière dont certains ont pronostiqué à tort leur épuisement, depuis non avéré. Sur les COP (rencontres sur les évolutions climatiques), il met en lumière les engagements du type « passager clandestin » (ou free rider) qu’ont pratiqué en réalité nombre de pays, de l’économiste prix Nobel 2018 William Nordhaus, qui ont davantage grâce à ses yeux.
Sur la monnaie et l’inflation, il écrit un chapitre pédagogique pour permettre d’en comprendre ou d’en rappeler les grands fondements et les théories essentielles s’y référant, ainsi que les politiques économiques en vogue au cours des dernières décennies, tout en nous délectant de moult anecdotes passionnantes et instructives remontant à la mythologie et l’histoire antique, qui nous font voyager des eaux du Pactole à la création du franc et du dollar.
Banque, protectionnisme, guerres de monnaie
Les leçons à tirer des grandes crises financières historiques est que les interventions publiques et changements de réglementations y jouent souvent un rôle non négligeable. Alors même que ce sont les banquiers qui ont tendance à être honnis. « Le plus grave dans ce discours de dénonciation des banques, écrit-il, aussi vieux à vrai dire que la banque elle-même, est qu’il conduit à la multiplication des contraintes artificielles. Or, en bridant les banques, on bride le crédit et donc la croissance ». Il ne juge aucunement anormal, d’ailleurs, qu’une banque puisse faire faillite, comme toute autre entreprise lorsque les choix liés à son métier l’y conduisent.
Sur le protectionnisme, c’est l’occasion là encore de retenir les leçons de l’histoire, pour montrer les ambiguïtés liées aux pratiques en la matière. Après un rappel toujours essentiel des dérives, contradictions et égarements vers lesquels avaient mené les théories des économistes mercantilistes dès le XVIe siècle, avant leur résurgence partielle sous la plume de J. M Keynes quatre siècles plus tard, les nombreuses expériences historiques à travers le monde sont là pour témoigner de ce que le protectionnisme aboutit finalement toujours à baisse du pouvoir d’achat, quels que puissent être ses effets apparents ou les fausses promesses qu’il recèle à court terme. Et pourtant, il continue encore et toujours à faire recette régulièrement auprès de nombre de nos dirigeants. Menant aux guerres commerciales, dont on n’a généralement rien à gagner, Jean-Marc Daniel met en lumière le fait que, loin de constituer une solution, le protectionnisme est au contraire une menace. Et l’arme la plus redoutable en la matière est probablement l’arme monétaire, à laquelle il consacre son dernier chapitre, qui en retrace l’histoire et les subtilités.
Ne pas se référer à un passé révolu
Laissons encore la parole à Jean-Marc Daniel qui, pour conclure son ouvrage, insiste une nouvelle fois sur l’importance de ne pas se couper de l’histoire pour pouvoir en retenir les leçons, mais sans pour autant se référer à un cadre de référence qui n’a plus lieu d’être :
De fait, si l’on reprend les arguments de Giddens, on peut se demander avec lui quel sens cela a de défendre la classe ouvrière quand il n’y en a plus, quel sens donner au mot pauvreté quand naguère elle s’identifiait à la faim et aujourd’hui à l’obésité, quel sens cela a encore de demander plus d’Etat quand ceux-ci accaparent déjà plus de 50% de la richesse nationale, ou de parler de nationalisme quand les pays modernes ne sont plus que des juxtapositions de communautés ethnico-religieuses…
À lire aussi :
· Ricardo, reviens ! Ils sont restés keynésiens
· 3 controverses de la pensée économique
· Il était une fois… L’argent magique
· Les impôts : histoire d’une folie française
· Jean-Marc Daniel est-il devenu keynésien ?
· Éloge de la concurrence contre la connivence
· Les économistes sont-ils encore crédibles ? Entretien avec Jean-Marc Daniel

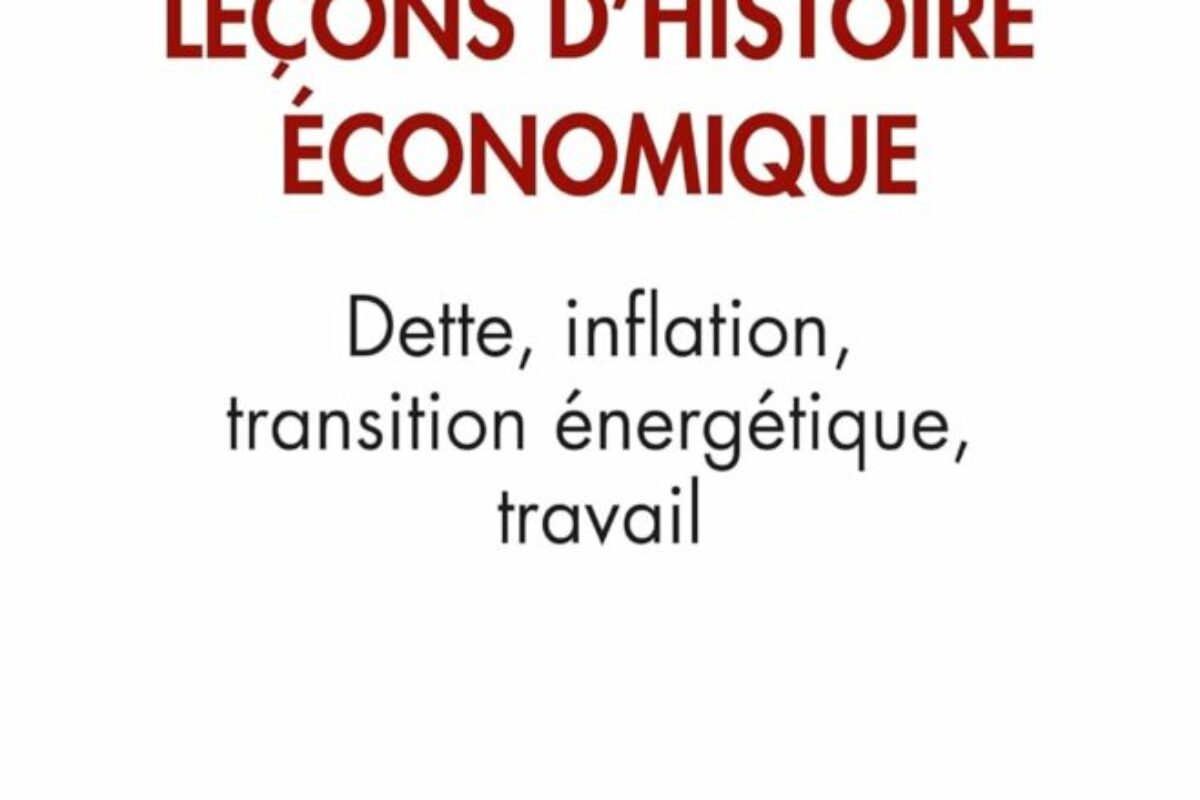

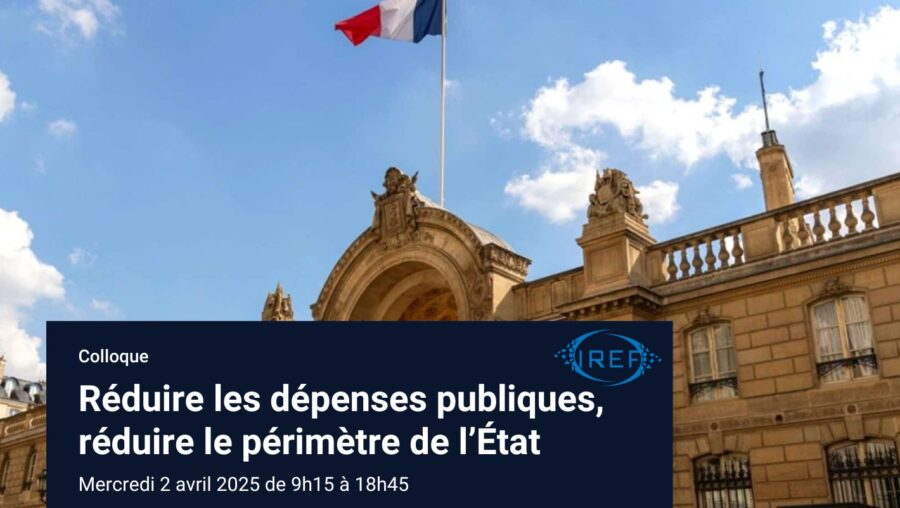

Tour le monde sait très bien quel fléau empêche l’économie de croître: l’état et ses politiciens ignorants et idiots!
Lecture pa
J’aime beaucoup JM Daniel, toujours passionnant et pleins de faits historiques ! néanmoins il aurait du regarder dans l’histoire récente avant d’écrire ceci ! “Or, en bridant les banques, on bride le crédit et donc la croissance” il oublie l’abus des banques avec les sub primes et la quasi explosion du système financier mondial ! on peut parler aussi des exagérations de la bourse …il faut bien réglementer ceci sinon c’est le far west ! autre reproche sur le protectionnisme qui bride le marché et la croissance ..le contre exemple parfait est la Chine, qui est ultra protectionniste et qui à créée de la richesse pour TOUT le monde et pas uniquement pour les RICHES en occident !
Suite aux subprimes les européens ont bride fortement le système bancaire contrairement aux USA, résultat, la croissance américaine est plus du double de la moyenne européenne
Les bulles boursières font partie de la vie économique.
Le protectionnisme chinois s appuie sur un état totalitaire qui est en grande difficulté économique ( bulle immobilière, surproduction industriel…..)
Un libéral interventioniste avec plus de régulations est un bel oxymore……😅😅😅😅