Moins de deux ans après avoir été très violemment attaqué au couteau par un jeune exalté lors d’une conférence qu’il s’apprêtait à donner, justement sur l’importance de préserver la sécurité des écrivains, Salman Rushdie revient sur cet événement et sur les temps qui ont suivi, à travers un livre, Le couteau.
Une attaque ignoble
La conférence de ce 12 août 2022 n’avait même pas commencé que l’écrivain, pour lequel aucune mesure de sécurité particulière n’avait été prévue, fut la cible de la course effrénée d’un jeune illuminé qui lui asséna rien moins que 15 coups de couteau, avec une violence inouïe. Durant 27 secondes, qui furent sans doute les secondes les plus longues de la vie de l’auteur, interrompues uniquement par le courage de quelques anonymes présents sur place, qui parvinrent finalement à maîtriser le forcené.
L’écrivain n’en réchappa que par miracle. Profondément mutilé, atteint de plaies très profondes en divers endroits du corps, y compris à l’œil droit, qui fut littéralement crevé. Et, on s’en doute, profondément traumatisé également, on le serait à moins.
C’est sur cette attaque effroyable qu’il revient dans ce livre très intime, cherchant à analyser la situation, mais aussi à montrer quel retentissement elle a eu sur sa vie et celle de ses proches, tout en se faisant une sorte de devoir de résister à cette haine ancrée chez tant d’exaltés, tentant de donner une leçon de tolérance et de défense des vertus attachées à l’idée de liberté.
Une vie bouleversée
Lui qui se dit athée, se demande encore quelle sorte de providence a pu ainsi protéger sa vie, de sorte qu’il a réchappé à la mort de manière aussi improbable. Lui offrant toute latitude d’apporter une réponse à cette lamentable attaque et une « seconde chance » dans sa vie, tandis que son agresseur croupit maintenant en prison.
Le lundi 15 août était le Jour Trois. Le jour où il devint évident que j’allais continuer à vivre. Disons : où je serais libre de vivre. Et c’était bien cette liberté qui, à cet instant, m’importait le plus.
C’est à une narration non seulement de l’événement lui-même que Salman Rushdie se livre, détaillant sa surprise, sa stupéfaction, sa terrible douleur, ses multiples perceptions, mais aussi des minutes et des heures qui suivent où, à demi-conscient, il subit à la fois la crainte de la mort et les pensées envers ses proches.
Il revient sur les cinq dernières annĂ©es prĂ©cĂ©dant cet acte, partagĂ©es avec sa femme – la romancière, poĂ©tesse, photographe et vidĂ©aste Rachel Eliza Griffiths – Ă qui il voue un vĂ©ritable amour et avec qui il vivait en osmose quasiment parfaite. Mais aussi le bonheur d’être entourĂ© d’une famille aimante. Un doux bonheur pratiquement sans nuage, que vient alors interrompre un sombre inconnu dont il dĂ©couvrira avec stupeur et dĂ©solation qu’il n’avait rien lu de lui et ne s’était basĂ©, pour forger sa haine, que sur une ou deux courtes vidĂ©os sur les rĂ©seaux sociaux affirmant qu’il Ă©tait un ĂŞtre mauvais !
La culture en péril
Car c’est cette légèreté qui interroge le plus, et justifie la présentation de ce livre dans cette série. En cette époque où les réseaux sociaux ont un peu trop pris le pas sur ce qu’est la véritable culture ou ce qu’est l’information détaillée et analysée, cédant le pas au culte de l’immédiat, quand ce n’est pas à la tyrannie du divertissement, des esprits faibles peuvent être amenés à recourir à la violence la plus extrême en ne se basant que sur de simples rumeurs ou jugements de valeur non vérifiés, faisant fi de la liberté d’expression et de pensée, comme de tout rudiment de culture humaniste.
Celle à laquelle Salman Rushdie, comme beaucoup d’entre nous, pensait pouvoir se référer en toute indépendance et en toute quiétude, avant que les temps changent. Jusqu’à la régression.
J’ai parfois le sentiment d’appartenir à une autre époque. Je me revois, enfant, dans le jardin de notre maison des années 1950. J’écoutais mes parents et leurs amis qui riaient et plaisantaient en discutant de tous les sujets possibles, de la politique du moment à l’existence de Dieu sans ressentir la moindre contrainte qui les aurait obligés à censurer ou atténuer leurs opinions […] C’est dans ce cadre que j’ai pris ma première leçon de liberté d’expression, que j’ai appris qu’elle devait aller de soi. Si vous redoutez les conséquences de ce que vous dites, vous n’êtes pas libre. Quand j’écrivais Les versets sataniques, il ne m’est jamais venu à l’esprit d’avoir peur.
L’art contre les idées reçues
L’un des moments forts du livre est sans doute ces pages où, après avoir longtemps rêvé de pouvoir rencontrer et dialoguer avec son agresseur, chose pratiquement impossible, Salman Rushdie imagine un dialogue fictif avec lui. Laissant ainsi libre cours à ce qu’il se figure pouvoir correspondre aux convictions de l’un et de l’autre.
Un dialogue incisif digne de celui qu’Amélie Nothomb imaginait dans son roman Hygiène de l’assassin (que j’ai lu il y a 32 ans, mine de rien…) et qui restitue assez bien ce que l’on peut en effet concevoir de l’état d’esprit de ce jeune homme. Non sans une pointe d’humour, d’ailleurs, quand l’écrivain fait référence à l’imam Yutubi, symbolisant les sources du jeune assaillant, qui ont forgé sa haine irrationnelle. Jeune homme de 24 ans dont le profil ressemble fort à ce perdant radical dont Hans Magnus Enzensberger nous dressait le portrait-robot (voir l’article que nous présentions en mars 2019 à ce sujet). Un humour ou un rire qui sauvera le monde, si l’on s’en tient à ce que certains se prennent à espérer, au-delà de la sombre violence qui parsème le quotidien.
À rebours de cette étroitesse d’esprit qui caractérise nombre d’esprits obtus, c’est aussi l’art qui nous sauvera contre les idées reçues. C’est l’une des leçons que nous donne Salman Rushdie à travers cet essai.
L’art dĂ©fie l’orthodoxie. Le rejeter ou le vilipender pour ce qu’il est c’est ne pas comprendre sa nature. L’art place la vision personnelle de l’artiste en opposition aux idĂ©es reçues de son temps. L’art sait que les idĂ©es reçues sont ses ennemis, comme l’a dit Flaubert dans Bouvard et PĂ©cuchet. Les clichĂ©s sont des idĂ©es reçues et, Ă ce titre, des idĂ©ologies, que les unes et les autres dĂ©pendent de la sanction d’invisibles dieux cĂ©lestes ou pas. Sans l’art, notre capacitĂ© Ă rĂ©flĂ©chir, Ă avoir une vision neuve des choses, et Ă renouveler notre monde dĂ©pĂ©rirait et serait condamnĂ©e Ă mourir. L’art n’est pas un luxe. C’est l’essence mĂŞme de notre humanitĂ© et il n’exige aucune protection particulière si ce n’est le droit d’exister. Il peut ĂŞtre mis en cause, critiquĂ© et mĂŞme rejetĂ©. Il n’accepte pas la violence. Et en fin de compte, il survit Ă ceux qui l’oppriment. Le poète Ovide a Ă©tĂ© exilĂ© par CĂ©sar Auguste mais la poĂ©sie d’Ovide a survĂ©cu Ă l’Empire romain. La vie du poète Mandelstam a Ă©tĂ© ruinĂ©e par Joseph Staline mais sa poĂ©sie a survĂ©cu Ă l’Union soviĂ©tique. Le poète Lorca a Ă©tĂ© assassinĂ© par les brutes du gĂ©nĂ©ral Franco mais son art a survĂ©cu au fascisme de la Phalange.
D’autres esprits obtus
Mais il existe d’autres esprits obtus (ou idiots utiles ?) que Salman Rushdie Ă©voque Ă quelques endroits du livre. Ces intellectuels ou Ă©crivains qui ne l’ont aucunement soutenu Ă l’époque oĂą fut lancĂ©e la fatwa contre lui après la sortie de son roman Les versets sataniques, mais encore aujourd’hui, après l’attentat dont il a Ă©tĂ© victime. Ceux qui – Ă l’image de ce professeur d’Oxford affirmant que ceux qui prennent la dĂ©fense de Salman Rushdie ont une « conception nĂ©olibĂ©rale de la libertĂ© d’expression » – se dĂ©partent peu des haineux qui souhaitent la mort de l’écrivain.
Mais pour ma part, j’ignore toujours ce que signifie « néolibéral », qui ne fait toujours pas partie de mon vocabulaire…
Salman Rushdie, Le couteau : Réflexions suite à une tentative d’assassinat, Gallimard, avril 2024, 272 pages.
_________
Ă€ lire aussi :
- La culture en péril (1) – Georges Steiner, Le silence des livres
- La culture en péril (2) – Georges Steiner, Ceux qui brûlent les livres
- La culture en péril (3) – Charles Dantzig, Pourquoi lire ?
- La culture en péril (4) – Jacqueline Kelen, L’esprit de solitude
- La culture en péril (5) – Collectif La Main Invisible, Libres !!
- La culture en péril (6) – Alain Finkielkraut, L’après littérature
- La culture en péril (7) – Tzvetan Todorov, La littérature en péril
- La culture en péril (8) – Christine Sourgins, Les mirages de l’art contemporain
- La culture en péril (9) – Patrice Jean, La poursuite de l’idéal
- La culture en péril (10) – Antoine Compagnon, La littérature pour quoi faire ?
- La culture en péril (11) – Justine Augier, Croire : Sur les pouvoirs de la littérature
- La culture en péril (12) – Michel Desmurget, Faites-les lire !
- La culture en péril (13) – Joseph Roth, L’autodafé de l’esprit
- La culture en péril (14) – Milan Kundera, L’Occident kidnappé
- La culture en péril (15) – Mario Vargas Llosa, Eloge de la lecture et de la fiction
- La culture en péril (16) – Philippe Nemo, « Crise de la culture ? »


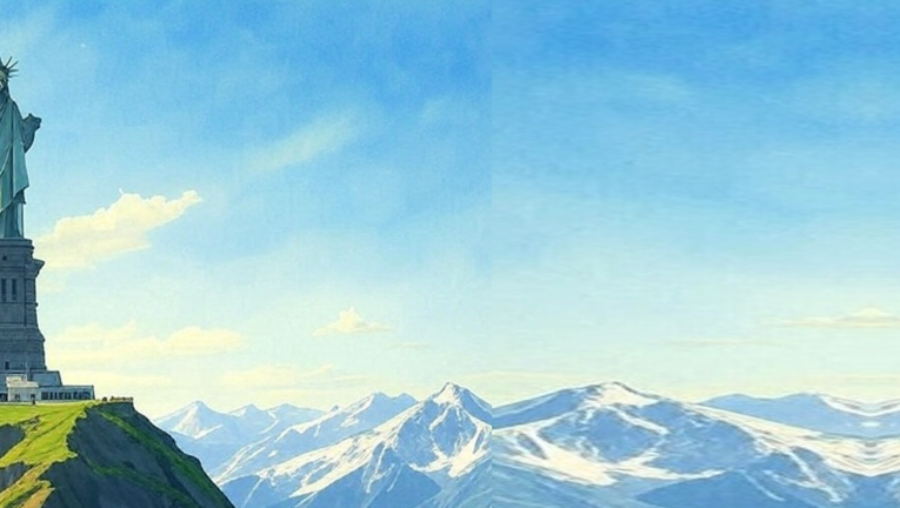


J’ai l’impression qu’il y a des grosses dynamiques de repliement sur soi, de peur et de raccrochement Ă des certitudes qui n’ont plus trop court, quelles que soient les appartenances religieuses, les traditions familiales, les classes sociales ou les postures politiques.
Il me semble que le nĂ©o-libĂ©ralisme est justement l’approche qui permet de rĂ©utiliser les mots de la pensĂ©e libĂ©rale pour s’inscrire dans des attitudes obtuses et autoritaires.