Ce texte correspond à la leçon inaugurale prononcée par Antoine Compagnon le jeudi 30 novembre 2006 au Collège de France. Après avoir dressé un panorama historique de l’opposition entre traditions théorique et historique de la littérature, qui a débouché sur la distinction entre approche rhétorique ou poétique d’une part, et histoire littéraire et philologie d’autre part, l’éminent professeur s’interroge sur l’objet de la littérature, sur les valeurs qu’elle peut créer et transmettre dans le monde actuel. Rejoignant en cela d’une certaine manière en partie le questionnement que nous avons pu aborder avec Tzvetan Todorov. S’inscrivant au passage aussi dans les traces de Marcel Proust, qui écrivait :
La vraie vie, la vie enfin découverte et éclaircie, la seule vie par conséquent réellement vécue, c’est la littérature […] Par l’art seulement, nous pouvons sortir de nous, savoir ce que voit un autre de cet univers qui n’est pas le même que le nôtre, et dont les paysages nous seraient restés aussi inconnus que ceux qu’il peut y avoir dans la Lune.
La littérature en recul
Ce qui motive cette question de l’utilité de la littérature est le constat de la place de moins en moins importante qu’elle prend au sein de notre société.
« Car le lieu de la littérature s’est amenuisé dans notre société depuis une génération : à l’école, où les textes documentaires mordent sur elle, ou même l’ont dévorée ; dans la presse, où les pages littéraires s’étiolent et qui traverse elle-même une crise peut-être funeste ; durant les loisirs, où l’accélération numérique morcelle le temps disponible pour les livres. Si bien que la transition n’est plus assurée entre la lecture enfantine – laquelle ne se porte pas mal, avec une littérature pour la jeunesse plus attrayante qu’auparavant – et la lecture adolescente, jugée ennuyeuse parce qu’elle requiert de longs moments de solitude immobile. Quand on les interroge sur le livre qu’ils aiment le moins, les lycéens répondent Madame Bovary, le seul qu’on les a obligés à lire. »
Au mieux, nous dit Antoine Compagnon, la littérature laisse de plus en plus indifférent, au pire elle suscite de la haine, étant vue par certains comme un facteur de « fracture sociale ». D’où la question de son utilité.
Ce que permet pourtant la littérature
Alliant plaisir et connaissance, évasion et action, le roman permet souvent d’en apprendre « plus sur la vie que de longs traités savants », affirme-t-il. Tandis que beaucoup ont voulu, pendant longtemps, opposer lettres et sciences.
La vie est plus facile et plus claire aussi pour ceux qui savent lire. Instruire en plaisant, comme dans les Fables de La Fontaine. Éduquer moralement, comme à travers les contes ou la fiction. Suppléer à l’expérience, pour mieux guider la conduite que ne peuvent le faire les seules règles théoriques. Représenter ainsi concrètement plutôt que de manière abstraite. Dotant, en outre, l’homme moderne « d’une vision qui porte au-delà des restrictions de la vie journalière ».
Mais ce n’est pas tout. Les Lumières et le romantisme y voyaient par ailleurs un remède, libérant l’individu de sa sujétion aux autorités et le guérissant de l’obscurantisme religieux.
En ce sens, la lecture est une expérience d’autonomie, elle contribue à la liberté et à la responsabilité de l’individu, à s’opposer au pouvoir lorsque celui-ci mène à la servitude ou qu’il persécute. À l’instar, une nouvelle fois, de ce que nous avions vu avec Kundera, la littérature apparaissant dans certains cas comme un moyen de résistance à l’oppression ; à condition, bien sûr, de ne pas se trouver récupérée au service d’un pouvoir, comme ce fut parfois le cas sous certains régimes.
La littérature permet également de dépasser le langage ordinaire, corrigeant ainsi les défauts de langage et permettant de mieux percevoir « des choses qui ne frappaient pas explicitement nos sens et notre conscience ». Des nuances d’émotion et de pensée qui nous demeuraient jusque-là invisibles (je pense une nouvelle fois à la véritable révélation que fut la découverte de la littérature française pour Mahmud Nasimi telle qu’il l’exprime dans Un Afghan à Paris).
La littérature aide donc au développement de notre personnalité. Même si, bien sûr, l’auteur reconnaît une capacité comparable au cinéma et à différents médias de faire vivre et d’accéder à une expérience sensible, ainsi qu’à une connaissance morale. Bien mieux qu’un traité de philosophie, elle contribue à l’éthique pratique comme à l’éthique spéculative. Comme elle permet de mieux vivre et par son caractère universel, elle s’oppose aux errances de la cancel culture.
Une défense de la singularité et un moyen de mieux comprendre les autres
« Le propre de la littérature étant l’analyse des relations toujours particulières qui joignent les croyances, les émotions, l’imagination et l’action, elle renferme un savoir irremplaçable, circonstancié et non résumable, sur la nature humaine, un savoir des singularités […] La littérature doit donc être lue et étudiée parce qu’elle offre un moyen – certains diront même le seul – de préserver et de transmettre l’expérience des autres, ceux qui sont éloignés de nous dans l’espace et le temps, ou qui diffèrent de nous par les conditions de leur vie. Elle nous rend sensible au fait que les autres sont très divers et que leurs valeurs s’écartent des nôtres. Ainsi un fonctionnaire au fait de ce qui rend sublime le dénouement de La Princesse de Clèves sera-t-il plus ouvert à l’étrangeté des mœurs de ses administrés. »
Dans les pas de Montaigne ou de Bacon, nous pouvons donc affirmer que la littérature est une source d’humanisme. Elle permet de mieux jouir de la vie ou de mieux la supporter (Samuel Johnson), de rendre la vie digne d’être vécue (T.S Eliot), permettant de mieux comprendre le monde et la condition humaine, de développer de manière utile émotions, empathie, compassion, pour renforcer son autonomie, l’indépendance de sa personnalité, sa capacité à aller vers les autres, son aptitude à prendre de la distance vis-à-vis des idées reçues, de la langue de bois, de la pensée unique, des conformismes, des façons convenues de penser la vie, de la bonne conscience ou de la mauvaise foi (de multiples auteurs sont cités à l’appui de chacun de ces éléments).
La littérature est donc un excellent rempart contre la bêtise, une source de sagesse et de subtilité, une possibilité d’exprimer l’exception, permettant ainsi une connaissance différente de la connaissance savante, de développer une capacité de mieux sentir et ressentir, de mieux éclairer les comportements et les motivations humaines. Le tout en ne concluant jamais, mais en restant ouverte. Elle est expérimentation des possibles, « visant moins à énoncer des vérités qu’à introduire dans nos certitudes le doute, l’ambiguïté et l’interrogation ».
Antoine Compagnon, La littérature pour quoi faire ?, Fayard/Pluriel, janvier 2018, 96 pages.
À lire aussi :
- La culture en péril (1) – Georges Steiner, Le silence des livres
- La culture en péril (2) – Georges Steiner, Ceux qui brûlent les livres
- La culture en péril (3) – Charles Dantzig, Pourquoi lire ?
- La culture en péril (4) – Jacqueline Kelen, L’esprit de solitude
- La culture en péril (5) – Collectif La Main Invisible, Libres !!
- La culture en péril (6) – Alain Finkielkraut, L’après littérature
- La culture en péril (7) – Tzvetan Todorov, La littérature en péril
- La culture en péril (8) – Christine Sourgins, Les mirages de l’art contemporain
- La culture en péril (9) – Patrice Jean, La poursuite de l’idéal

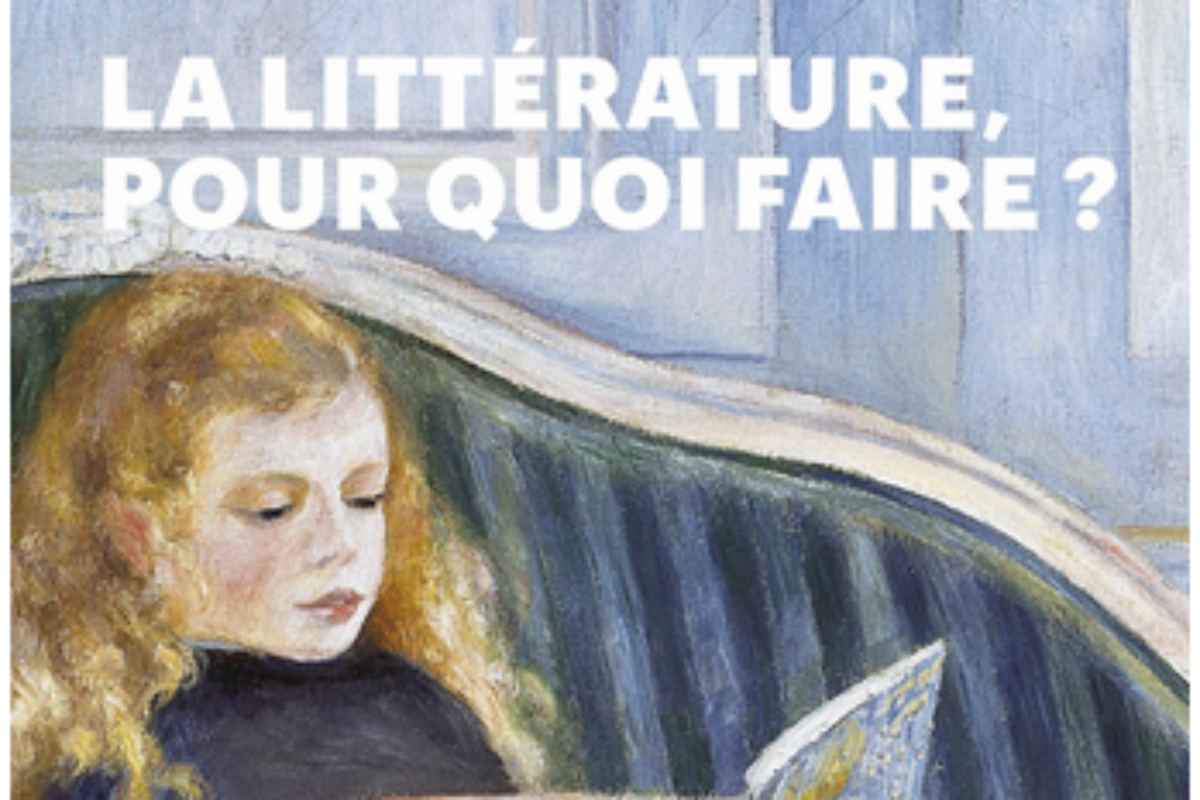



C’est terrible que l’on en soit à ce besoin de défendre la littérature et que tous les plaisirs finissent en devoir! On doit maintenant défendre l’air, l’eau, les arbres, les bélugas, les emplois, les femmes, les migrants, l’Ukraine… Comme tout ce qu’on défend (cela vient de ce signifiant polysémique) finit par disparaître, je pleure aujourd’hui sur la fin des livres et ce qu’ils contenaient parfois, la littérature!