Dans l’avant-propos de ce texte qui fit polémique, Tzvetan Todorov retrace de manière fort intéressante son itinéraire depuis Sofia, sous l’ère soviétique.
Fils de bibliothécaires, ayant vécu depuis toujours au beau milieu de tonnes de livres, qui le passionnent dès le plus jeune âge, il suit des études de lettres ; études de fait sous l’emprise de l’idéologie officielle, qu’il parvient à contourner discrètement en orientant son mémoire de fin d’études vers l’étude des formes linguistiques.
Quand littérature rime avec vie et avec libertés
C’est un départ opportun pour Paris qui lui fait finalement franchir le rideau de fer et avoir la possibilité d’échapper à la « schizophrénie collective » à laquelle conduit le régime totalitaire bulgare. Une intégration pas forcément aisée au départ, mais où il découvre progressivement les perspectives offertes par les libertés individuelles.
Lui faisant ainsi prolonger son séjour en s’intégrant parfaitement au monde universitaire parisien, jusqu’à être naturalisé. Et surtout en s’émancipant de son champ d’étude initial pour se plonger dans la philosophie morale et politique. La littérature, dès lors, lui permet de mieux comprendre le monde et de l’aider à vivre.
Plus dense, plus éloquente que la vie quotidienne mais non radicalement différente, la littérature élargit notre univers, nous incite à imaginer d’autres manières de le concevoir et de l’organiser. Nous sommes tous faits de ce que nous donnent les autres êtres humains : nos parents d’abord, ceux qui nous entourent ensuite ; la littérature ouvre à l’infini cette possibilité d’interaction avec les autres et nous enrichit donc infiniment. Elle nous procure des sensations irremplaçables qui font que le monde réel devient plus chargé de sens et plus beau. Loin d’être un simple agrément, une distraction réservée aux personnes éduquées, elle permet à chacun de mieux répondre à sa vocation d’être humain.
Le système éducatif en question
C’est à travers la scolarité de ses enfants que Tzvetan Todorov découvre pour la première fois qu’une tout autre conception que la sienne de la littérature règne en France, qui par certains côtés confine à l’absurde. Avant, quelques années plus tard, de 1994 à 2004, de participer au Conseil national des programmes.
Il constate alors, à son grand dépit, que ces programmes sont davantage attachés au formalisme qu’au sens de l’œuvre, à sa beauté, et à son lien avec la vie. La réflexion et ce dont parlent les œuvres sont négligés au profit des outils (genres, registres, situation d’énonciation…). C’est confondre là les moyens avec les fins (les deux devant être étudiés). Les œuvres littéraires sont ainsi devenues des « objets clos et autosuffisants ». État qui s’est étendu à l’étude de l’histoire, du droit, voire des sciences naturelles, nous dit-il. Héritage des études universitaires qui, à partir des années 1960-70, ont formé les professeurs de français d’aujourd’hui aux tendances du structuralisme. Mutation sensible surtout à partir de la remise en cause de mai 1968.
Sans surprise, les élèves du lycée apprennent le dogme selon lequel la littérature est sans rapport avec le reste du monde et étudient les seules relations des éléments de l’œuvre entre-eux. Ce qui, à n’en pas douter, contribue au désintéressement croissant que ces élèves manifestent à l’égard de la filière littéraire […] Pourquoi étudier la littérature si elle n’est que l’illustration des moyens nécessaires à son analyse ?
Tendance aujourd’hui confortée par le courant de la « déconstruction », particulièrement vif aux États-Unis.
Un phénomène qui s’est également étendu, nous dit Todorov, aux journalistes dans leurs critiques des livres, mais aussi aux écrivains eux-mêmes, particulièrement en France, étant tous passés par les mêmes enseignements universitaires. S’y ajoutent une tendance au nihilisme et une autre au solipsisme. A travers une conception formaliste de nombreuses œuvres contemporaines (fascination de soi de certains auteurs décrivant leurs moindres émois ou se livrant à l’autofiction) et une littérature qui devient représentation de la négation (du monde et de ses méfaits). Un appauvrissement, selon l’auteur.
La naissance de l’esthétique moderne
Tzvetan Todorov nous propose alors une explication historique aboutissant à l’inversion de la hiérarchie entre sens et beauté à partir surtout du XVIIIe siècle. Le contexte de la création disparaît au profit de lieux où sont rassemblées des œuvres (musées) pour y être consommées. La valeur esthétique est mise au premier plan. Aboutissant au XXe siècle à transformer un objet quelconque en objet d’art. Avec toutes les conséquences que cela induit. Illustrant ainsi « la progressive sécularisation du monde en Europe, tout en contribuant à une nouvelle sacralisation de l’art ». L’art abandonne alors ses finalités pratiques pour viser des finalités internes, pouvant aller jusqu’à l’autosuffisance du créateur et sa transcendance par rapport au monde. La réception de l’œuvre par un public compte dorénavant davantage que sa production.
L’esthétique des Lumières, toutefois, analyse l’auteur à travers un chapitre passant en revue les idées de différents auteurs, induisait une complémentarité entre activité philosophique et artistique, entre abstraction et monde sensible, entre général et particulier, entre recherche des vérités et sagesse. La beauté pouvait encore résider dans l’imitation (du monde) et l’atteinte de la vérité. « … Tout but dénature l’art. Mais l’art atteint au but qu’il n’a pas », écrit ainsi Benjamin Constant. Considérant ainsi que, même si la littérature ne doit pas être didactique, elle n’est pas pour autant coupée du monde. Reposant nécessairement, ainsi que le pensait également Germaine de Staël, sur des idées et valeurs, réunissant « auteurs du passé et lecteurs à venir ».
Le romantisme s’inscrit dans la continuité des Lumières, en recherchant non pas la vérité dans le même sens que celle des sciences (vérité de correspondance), mais en interprétant, en déchiffrant le monde (vérité de dévoilement), en donnant forme à l’informe.
Ce n’est, finalement, qu’au début du XXe siècle qu’intervient la rupture décisive.
… La prétention de la littérature à la connaissance n’est alors plus considérée comme légitime, mais le discours de la philosophie et de la science se trouve frappé du même soupçon […] L’œuvre d’art se définit alors par sa soumission exclusive aux exigences du beau, éliminant toute question relative au rapport que cette œuvre entretient avec le monde.
À rebours de la complexité des XVIIIe et XIXe siècles (Baudelaire, Flaubert, Balzac, etc.), qui avait rompu avec l’unicité (auparavant l’imitation). Les mouvements dits d’avant-garde, notamment en Russie, sont à la source de cette nouvelle conception, fondée sur l’abstraction en peinture ou l’émancipation du langage par rapport au réel.
Désormais, un abîme se creuse entre littérature de masse, production populaire en prise directe avec la vie quotidienne de ses lecteurs ; et littérature d’élite, lue par des professionnels – critiques, professeurs, écrivains – qui ne s’intéressent qu’aux seules prouesses techniques de ses créateurs. D’un côté le succès commercial, de l’autre les qualités purement artistiques. Tout se passe comme si l’incompatibilité des deux allait de soi, au point que l’accueil favorable réservé à un livre par un grand nombre de lecteurs devient le signe de la défaillance sur le plan de l’art et provoque le mépris ou le silence de la critique. L’époque où la littérature savait incarner un subtil équilibre entre représentation du monde commun et perfection de la construction romanesque semble révolue.
Après la Première Guerre mondiale, les régimes totalitaires veulent « mettre l’art au service d’un projet utopiste de fabrication d’une société entièrement nouvelle et d’un homme nouveau ». La recherche solitaire du beau et l’autonomie artistique n’y sont donc plus de mise, remplacées par la soumission aux objectifs politiques du moment. Quant aux pays où règne la liberté d’expression, les artistes n’y sont que plus résolus à exiger la disparition de tout rapport entre l’œuvre et le monde, prônant ainsi le formalisme (rendu nihiliste par la vision des désastres de l’histoire européenne).
Même si aujourd’hui ces différentes conceptions coexistent, la triade formalisme-nihilisme-solipsisme n’en est pas moins dominante en France , selon l’auteur (dans les rédactions des journaux littéraires, ou encore parmi les directeurs des théâtres subventionnés ou des musées).
Que peut la littérature ?
Pour mieux comprendre en quoi littérature rime avec vie et avec liberté, Tzvetan Todorov s’appuie sur les exemples de John Stuart Mill, qui s’est sorti d’une sévère dépression à l’âge de vingt ans grâce à la découverte d’un recueil de poèmes de Wordsworth, y trouvant « l’expression de ses propres sentiments sublimés par la beauté des vers », ou encore de Charlotte Delbo, arrêtée par l’occupant allemand, puis déportée à Auschwitz. Ce sont les compagnons fiables des livres qui lui ont permis de revenir à la vie. Tandis que l’auteur lui-même exprime à quel point ils jouent également un rôle absolument fondamental dans la sienne, même s’il n’a pas connu de malheurs comparables.
La littérature peut beaucoup. Elle peut nous tendre la main quand nous sommes profondément déprimés, nous conduire vers les autres êtres humains autour de nous, nous faire mieux comprendre le monde et nous aider à vivre.
Nous y apprenons au moins autant sur la condition humaine et les expériences humaines que ne peuvent le permettre la sociologie ou la psychologie. Plus que les concepts et les lois générales tirées de l’abstraction, on y trouve les expériences singulières, individuelles, la diversité du vécu. Et elle peut être comprise « par d’innombrables lecteurs, provenant d’époques et de cultures fort différentes », pouvant donner lieu à des interprétations multiples, laissées à la liberté du lecteur, qui de plus jouit de la liberté de penser par lui-même.
Il se pourrait même qu’elle nous « guérisse de notre « égotisme », entendu comme l’illusion d’une autosuffisance », selon le philosophe américain Richard Rorty. Point de vue que je partage pleinement, tant je pense que la violence délinquante puise souvent sa source et est souvent liée au manque d’empathie lié à la capacité d’imagination défaillante de certains. Empathie qui me paraît être l’une des qualités les plus essentielles à même de nous rapprocher de cet universalisme hélas en régression auquel, selon l’auteur, la littérature permet d’accéder.
Moins ces personnages nous ressemblent et plus ils élargissent notre horizon, donc enrichissent notre univers. Cet élargissement intérieur […] représente plutôt l’inclusion dans notre conscience de nouvelles manières d’être, à côté de celles que nous possédions déjà. Un tel apprentissage ne change pas le contenu de notre esprit, mais le contenant lui-même : l’appareil de perception plutôt que les choses perçues. Ce que les romans nous donnent est, non un nouveau savoir, mais une nouvelle capacité de communication avec des êtres différents de nous ; en ce sens, ils participent plus de la morale que de la science. L’horizon ultime de cette expérience n’est pas la vérité mais l’amour, forme suprême du rapport humain.
À cet égard, j’avais été très surpris en lisant Mahmud Nasimi de constater à quel point ce que je pressentais était magistralement – et au-delà même de ce que j’aurais pu imaginer – vérifié par la véritable leçon de vie que lui a offert, arrivé à Paris, la découverte de la littérature, et à quel point elle avait pu transformer radicalement à la fois sa façon de voir les choses, de ressentir, d’éprouver, voire même d’éprouver de l’empathie. Un chemin de liberté unique et impressionnant. Qui lui a permis à lui aussi de se sortir de sa misérable condition pour accéder au bonheur.
Au-delà, nous pouvons songer à l’importance de la littérature dans l’identité culturelle et l’avenir des libertés telle que nous avons pu l’entrevoir de manière forte avec Kundera.
Tous ces exemples permettent de mieux prendre conscience du rôle essentiel que peut jouer la littérature dans notre société, notre existence et nos libertés. D’où l’intérêt de ce vibrant plaidoyer de Tzvetan Todorov en faveur d’un enseignement davantage centré sur le sens des œuvres plutôt que sur leur formalisme.
— Tzvetan Todorov, La littérature en péril, Champs essais, mars 2014, 96 pages.
À lire aussi :
- La culture en péril (1) – Georges Steiner, Le silence des livres
- La culture en péril (2) – Georges Steiner, Ceux qui brûlent les livres
- La culture en péril (3) – Charles Dantzig, Pourquoi lire ?
- La culture en péril (4) – Jacqueline Kelen, L’esprit de solitude
- La culture en péril (5) – Collectif La Main Invisible, Libres !!
- La culture en péril (6) – Alain Finkielkraut, L’après littérature


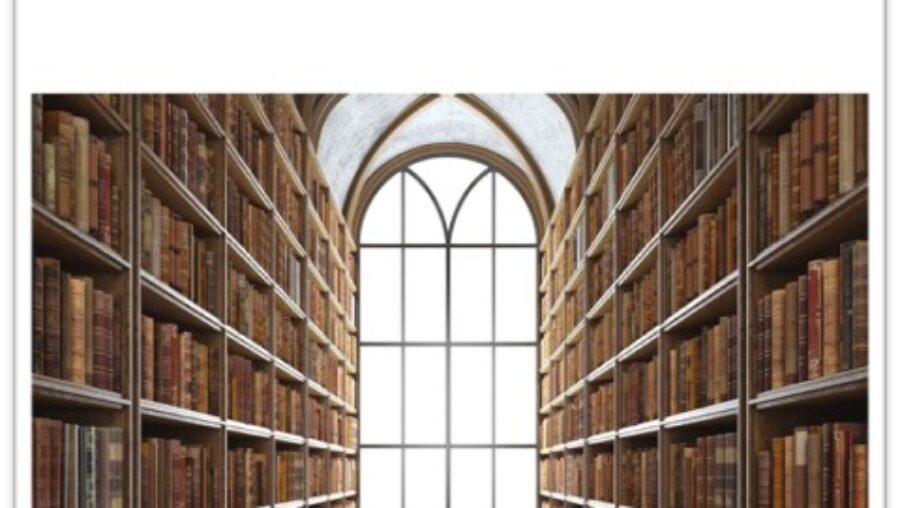

Très beau texte, merci de l’avoir republié.