Joseph Roth est un écrivain et journaliste austro-hongrois du début du XXe siècle. Témoin de la Première Guerre mondiale, puis de la montée du nazisme, il assiste à la destruction des livres, dont les siens, à l’arrivée des nazis au pouvoir en 1933. Il s’exile alors à Paris, où il meurt prématurément six ans plus tard à 44 ans, malade, alcoolique et sans argent.
Dans ce très court fascicule qui est la reproduction de l’un de ses articles, il se penche sur le péril représenté par les autodafés, une forme extrême de censure qui préfigure des destructions plus vastes et des massacres d’individus.
L’origine de « L’autodafé de l’esprit »
Le contexte de cet écrit est présenté à la fin du recueil. Son origine se situe à la suite immédiate de l’autodafé géant du 10 mai 1933 sur la place de l’Opéra de Berlin, réalisé avec l’appui des Sections d’Assaut, sous l’impulsion du ministre de la Propagande et de l’Instruction publique Joseph Goebbels. Vingt mille livres d’écrivains juifs furent brûlés, tandis que la même chose se produisait simultanément dans vingt autres villes allemandes, suivie par d’autres encore le 21 juin.
Depuis son exil parisien, Joseph Roth réagit aussitôt, se lançant sous pseudonyme dans la contre-propagande, en écrivant ce texte en français, afin d’éviter la censure et les menaces sur son intégrité. Il entend défendre la culture allemande mais aussi européenne contre cette purge.
Mais il n’avait pas attendu ce jour pour mettre en garde, dès les années 1920, contre un monde en train de disparaître. Notamment à partir de 1925, où il devient envoyé spécial du journal libéral Frankfurter Zeitung.
La destruction de l’esprit
L’écrivain évoque dès le début de son écrit la « capitulation honteuse » dont a fait preuve l’Europe spirituelle de l’époque, « par faiblesse, par paresse, par indifférence, par inconscience… ». Car « peu d’observateurs dans le monde semblent [alors] se rendre compte de ce que signifient l’auto-da-fé des livres, l’expulsion des juifs et toutes les autres tentatives forcenées du Troisième Reich pour détruire l’esprit ». Toujours cet aveuglement et cette peur qui gouverne tout, à différentes époques.
Joseph Roth analyse – en prenant le recul du passé – comment on sentait poindre depuis longtemps déjà , sous le Reich prussien de Bismarck, ce sentiment moral d’exil des écrivains allemands (tout au moins de ceux qui demeuraient « libres et indépendants ») face à la prédominance de l’autorité physique, matérialiste et militaire sur la vie spirituelle.
Qui préfigurait, par son hostilité à l’esprit, à l’humanisme et aux religions juives et chrétiennes, ce qui allait advenir aux livres. Il s’en prend ainsi à ceux qu’il nomme les « Juifs de l’Empereur Guillaume », qui se sont selon lui fourvoyés en se soumettant à Bismarck plutôt que de s’allier « au véritable esprit allemand ». Allant jusqu’à dominer depuis 1900 la vie artistique de l’Allemagne.
Le simple commencement de la destruction
Au moment oĂą Joseph Roth Ă©crit, l’Europe n’est pas encore Ă feu et Ă sang. Pourtant, par son Ă©vocation de l’antisĂ©mitisme et de tous ceux – pas seulement juifs – qui reprĂ©sentent l’esprit europĂ©en, la littĂ©rature allemande et le fleuron du monde intellectuel de l’époque, il montre que c’est non seulement la civilisation europĂ©enne qui court vers la destruction avec l’arrivĂ©e d’Hitler au pouvoir, mais au-delĂ ce sont le droit, la justice, puis l’Europe entière qui menacent d’être ravagĂ©s par la barbarie, puis la destruction totale. Jusqu’à ce qu’il ne reste plus rien du monde d’hier. Il ne se trompait pas… MĂŞme s’il n’a pas vu se produire ce qu’il avait prophĂ©tisĂ©.
Cet Ă©crit est, en dĂ©finitive, la mĂ©moire d’une Ă©poque rĂ©volue, de ce que des Ă©crivains et intellectuels – en particulier juifs allemands – ont apportĂ© Ă la culture, Ă la civilisation, Ă l’esprit europĂ©en le plus Ă©voluĂ©, avant que l’Europe et le monde ne soient mis Ă feu et Ă sang. En remontant aux autodafĂ©s, il montre comment la destruction de la culture, bastion de la civilisation, est toujours le point de dĂ©part de l’offensive destructrice contre celle-ci, remplacĂ©e par les pires totalitarismes.
La culture qui – Ă l’instar de ce que montrera Milan Kundera plus tard dans un autre contexte – peut aussi constituer un Ă®lot de rĂ©sistance salvateur…
Joseph Roth, L’autodafé de l’esprit, Editions Allia, mai 2019, 48 pages.
_________
Ă€ lire aussi :
- La culture en péril (1) – Georges Steiner, Le silence des livres
- La culture en péril (2) – Georges Steiner, Ceux qui brûlent les livres
- La culture en péril (3) – Charles Dantzig, Pourquoi lire ?
- La culture en péril (4) – Jacqueline Kelen, L’esprit de solitude
- La culture en péril (5) – Collectif La Main Invisible, Libres !!
- La culture en péril (6) – Alain Finkielkraut, L’après littérature
- La culture en péril (7) – Tzvetan Todorov, La littérature en péril
- La culture en péril (8) – Christine Sourgins, Les mirages de l’art contemporain
- La culture en péril (9) – Patrice Jean, La poursuite de l’idéal
- La culture en péril (10) – Antoine Compagnon, La littérature pour quoi faire ?
- La culture en péril (11) – Justine Augier, Croire : Sur les pouvoirs de la littérature
- La culture en péril (12) – Michel Desmurget, Faites-les lire !


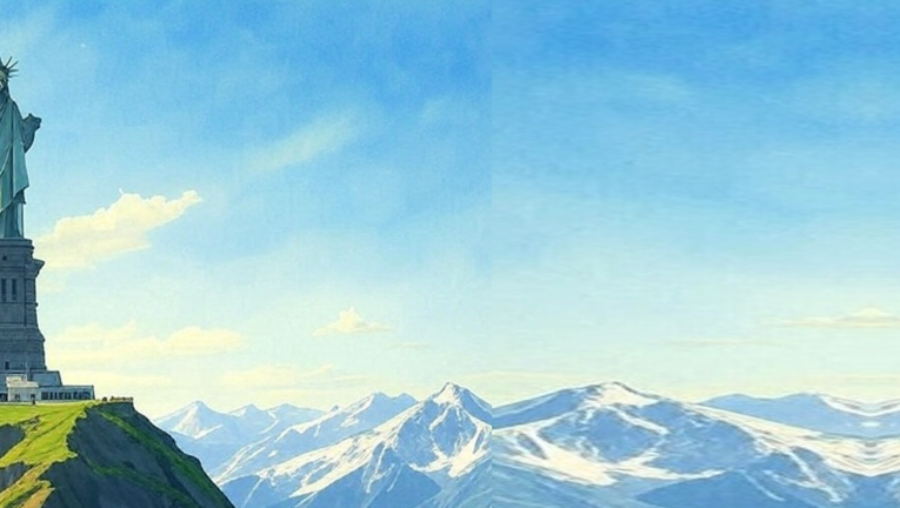


Un livre Ă mettre entre toutes les mains, celles de M. Macron (le gars qui ne connaĂ®t et ne reconnaĂ®t pas l’Histoire et la Culture) et de tous les macronistes et pro-macronistes qui le suivent.