L’une des croyances les plus solidement ancrées est que la résolution des grands problèmes du monde ne peut provenir que d’une élite qui posséderait à la fois la connaissance, la volonté et la capacité de concevoir les solutions et de les mettre en œuvre pour faire advenir le « monde d’après ».
Bien que ces tentatives d’établir un Paradis sur Terre aient à chaque fois donné des résultats catastrophiques, la croyance persiste. Pour comprendre pourquoi, il faut se tourner vers un mouvement philosophico-religieux appelé la gnose. Né au tout début du christianisme et n’existant plus aujourd’hui sous forme institutionnalisée, il conserve toujours une influence majeure dans la pensée politique moderne.
La gnose est une doctrine philosophique et religieuse selon laquelle le salut de l’âme passe par une connaissance directe de la divinité et donc par une connaissance de soi. Le gnostique voit le monde comme un lieu étranger dans lequel l’Homme s’est égaré et d’où il doit retrouver son chemin vers l’autre monde de son origine. C’est une prison dont il veut s’échapper.
Cet enfermement est le produit de l’ignorance. C’est donc par la connaissance de sa vraie vie et de sa condition d’aliénation dans ce monde que l’âme pourra se libérer. Le but du gnosticisme est de détruire l’ordre de la réalité vécu comme défectueux et injuste et grâce au pouvoir créateur de l’Homme de le remplacer par un ordre parfait et juste.
L’idée avancée par Éric Voegelin, philosophe américain d’origine autrichienne, est que bien qu’étant à l’origine un mouvement religieux, le gnosticisme influence considérablement la pensée philosophique et politique moderne. La raison en est la perte de sens qui résulte des changements, de l’effondrement des institutions, des civilisations et de la cohésion ethnique depuis la révolution industrielle.
Celles-ci créent un besoin de retrouver une compréhension du sens de l’existence humaine.
Émergence d’une élite consciente autoproclamée
Le gnosticisme moderne prend la forme d’une spéculation sur le sens de l’Histoire, interprétée comme un processus identifié et clos pouvant être manipulé par une élite qui dispose à la fois de la connaissance du processus et de la volonté de le changer.
Cette élite est révolutionnaire et nécessairement peu nombreuse.
Ainsi, alors que Marx avait théorisé le socialisme comme une nécessité historique, c’est-à-dire qu’il adviendrait tout seul, Lénine estimait au contraire que cet avènement ne pourrait être le produit que de l’action révolutionnaire d’un groupe d’hommes déterminés. En prophète gnostique, il conceptualisait le parti communiste comme « l’avant-garde conscientisée des masses » qui devait agir pour guider ces dernières vers le royaume socialiste. Cette élite est également autoproclamée sur la base de sa connaissance exclusive. Parce qu’elle possède cette connaissance et cette volonté, elle est nécessairement aliénée du reste de la population qui, elle, ne la comprend pas voire lui est hostile. Cette aliénation n’est pas vue par le gnostique comme une faiblesse ou comme mettant en cause sa propre légitimité mais comme la conséquence inévitable de possession d’un savoir exclusif vu comme inaccessible aux masses. À l’extrême, l’aliénation devient même une preuve que le gnostique est élu pour sa tâche.
Selon Voegelin, la gnose est directement contraire à la philosophie. Depuis les Grecs, cette dernière part de l’idée qu’il existe une réalité accessible à une science au-delà de l’opinion. Elle naît de l’amour de cette réalité ; elle traduit l’effort de l’Homme pour la comprendre, en percevoir l’ordre et s’y accorder. Au contraire, la gnose désire dominer la réalité. Elle correspond à une démarche de pouvoir. À cette fin, le gnostique construit un système philosophique et politique. La construction de systèmes est une forme de raisonnement gnostique et non philosophique.
Les quatre croyances de l’élite gnostique
Partant d’une situation d’insatisfaction face à la réalité du monde, l’attitude gnostique est caractérisée par quatre croyances.
- Le problème réside dans la réalité et non dans une limitation humaine.
- Le salut est possible.
- L’ordre de la réalité devra être changé dans un processus historique, ce changement étant du ressort de l’action humaine.
- C’est au gnostique qu’incombe la tâche d’œuvrer pour un tel changement.
De là vient l’empressement du gnostique à se présenter comme un prophète qui proclamera sa connaissance du salut de l’humanité.
Les mouvements gnostiques tirent leurs idées de la notion chrétienne de perfection, qui comprend deux dimensions :
- Une dimension téléologique qui caractérise un mouvement vers un but éloigné et ambitieux (la perfection).
- Une dimension axiologique qui définit en quoi le but consiste.
La première dimension est mise en avant par les philosophies « progressistes », notamment celles des Lumières, pour lesquelles l’histoire de l’humanité est celle d’un progrès continu vers la connaissance et la sagesse.
La seconde dimension met l’accent sur l’état de perfection à atteindre.
Les conditions d’un ordre social parfait sont décrites et élaborées en détails et prennent la forme d’une image idéale. On trouve ici tous les projets idéalistes, comme la Cité de Platon ou bien sûr L’Utopie de Thomas More. Il est caractéristique des projets axiologiques qu’ils dressent un tableau parfois très précis du but à atteindre mais ne se préoccupent que rarement des moyens de le réaliser. La réalité est supposée se plier à la volonté humaine.
Certains projets combinent les deux dimensions en développant à la fois une conception du but final et une description des méthodes par lesquelles il doit être atteint.
Dans ce registre, on trouve principalement les mouvements qui descendent d’Auguste Comte et de Karl Marx. Dans les deux cas, on trouve une formulation relativement claire de l’état de perfection : chez Comte, un état final de la société industrielle sous le règne temporel des managers et le règne spirituel des intellectuels positivistes ; chez Marx, un état final d’un royaume de liberté sans classe.
Avec la création du symbole du prophète, un nouveau type émerge dans l’histoire de l’Occident à l’époque moderne : l’intellectuel qui connaît la formule de salut des malheurs du monde et peut prédire comment l’histoire du monde prendra son cours dans le futur.
Le mur de la réalité
La volonté de puissance du gnostique qui veut dominer le monde a triomphé de l’humilité du philosophe face à la réalité. Celle-ci reste cependant ce qu’elle est. Elle n’est pas modifiée par le fait qu’un penseur élabore un programme pour la changer et s’imagine qu’il peut le mettre en œuvre.
Car, explique Voegelin, un tel programme nécessite de construire une image de la réalité dont ont été éliminés les traits qui le feraient apparaître comme irréaliste et insensé. C’est le principe d’un modèle : il faut simplifier la réalité et enlever ce qui gêne. À force d’enlever ou d’ignorer tout ce qui rend le modèle impraticable, le gnostique perd contact avec la réalité. Le résultat n’est donc pas la domination de cette dernière, comme espéré, mais la création de ce que Voegelin nomme une « Deuxième Réalité », une production fantaisiste, une construction chimérique. La construction se heurte au mur de la réalité, au grand dam du gnostique.
Conformément au premier principe, c’est cette dernière qui est alors accusée.
Le gnostique est alors confronté à un choix douloureux : soit renoncer à son système (ce fut le cas des pays socialistes à la fin des années 1990), ce qui laisse son insatisfaction initiale entière, soit au contraire lutter contre la réalité pour le sauvegarder. Dans cette fuite en avant, le gnostique va mettre son échec sur le compte d’ennemis voire de traîtres dans son propre camp (purges soviétiques des années 1930) qu’il va essayer d’éliminer, ou sur le compte d’une conscience insuffisante des masses, incapables de comprendre les vrais enjeux et la beauté du système et qu’il va donc falloir éduquer voire rééduquer (révolution culturelle en Chine dans les années 1960).
À l’époque moderne et dans une forme heureusement plus bénigne cela donne les impatiences d’activistes environnementaux comme Greta Thunberg qui accuse les dirigeants du monde de passivité face à un enjeu qu’elle considère comme prioritaire, ou ceux qui estiment que le système démocratique est un obstacle à une action déterminée face aux enjeux. La certitude d’avoir raison, de posséder une connaissance et une conscience que la masse ne possède pas, est typiquement gnostique : elle les fait trouver insupportable ce qu’ils voient comme une inertie voire une résistance, alors que leur système est tout à fait prêt à prendre le relais.
Une élite gnostique ni nécessaire, ni souhaitable
La tentation gnostique reste aujourd’hui très présente tant il nous semble évident que l’ampleur des problèmes auxquels nous sommes confrontés appelle nécessairement à des solutions que seule une élite éclairée et compétente techniquement peut développer.
La délégation de la résolution des problèmes à une telle élite n’est cependant ni nécessaire ni souhaitable. Elle n’est pas nécessaire car l’histoire du changement humain montre qu’il a très souvent trouvé son origine dans la « masse » tant décriée par les gnostiques.
Pour ne prendre qu’un exemple parmi d’autres, la révolution industrielle est née non au sein de l’élite de l’époque, qu’elle fut intellectuelle, politique, scientifique ou religieuse mais de l’action de personnes tout à fait ordinaires issues de cette « masse », comme James Watt, qui est né pauvre.
La délégation à une élite n’est pas non plus souhaitable car toute consciente qu’elle se croit, elle est sujette à l’erreur : rien ne dit que son diagnostic est juste ; rien ne dit que les solutions qu’elle propose dans son « système » sont souhaitables ou même viables ; rien ne dit même que ce qu’elle identifie comme insatisfaisant le soit vraiment, que ce qu’elle voit comme un problème en soit vraiment un, ou qu’il soit le plus important.
Rappelons, entre mille exemples, les lamentations des marxistes qui avaient théorisé une paupérisation croissante du prolétariat pour constater au contraire que son niveau de vie s’élevait rapidement et que les prolétaires n’avaient qu’un seul souhait : devenir bourgeois.
On peut aussi penser aux prophéties du biologiste Paul Ehrlich en 1968 selon lequel la surpopulation amènerait inéluctablement à des famines en 1970. La plupart de ses prévisions apocalyptiques se sont révélées erronées.
La dernière raison est que l’élite gnostique, rappelons-le, est autoproclamée et que souvent elle n’est une élite tant qu’existe le problème qu’elle a identifié et qui lui donne naissance. Sa prétention à être une élite n’a souvent aucune légitimité. À l’extrême, le « problème » n’est qu’un prétexte pour une prise de pouvoir.
En conclusion, si l’incertitude de notre époque appelle effectivement à des redéfinitions du sens de ce qui se passe, restons méfiants face aux élites auto-proclamées qui se proposent de le faire pour nous.
Source pour cet article: Eric Voegelin, Science, Politics and Gnosticism, ISI Books (2004).
—

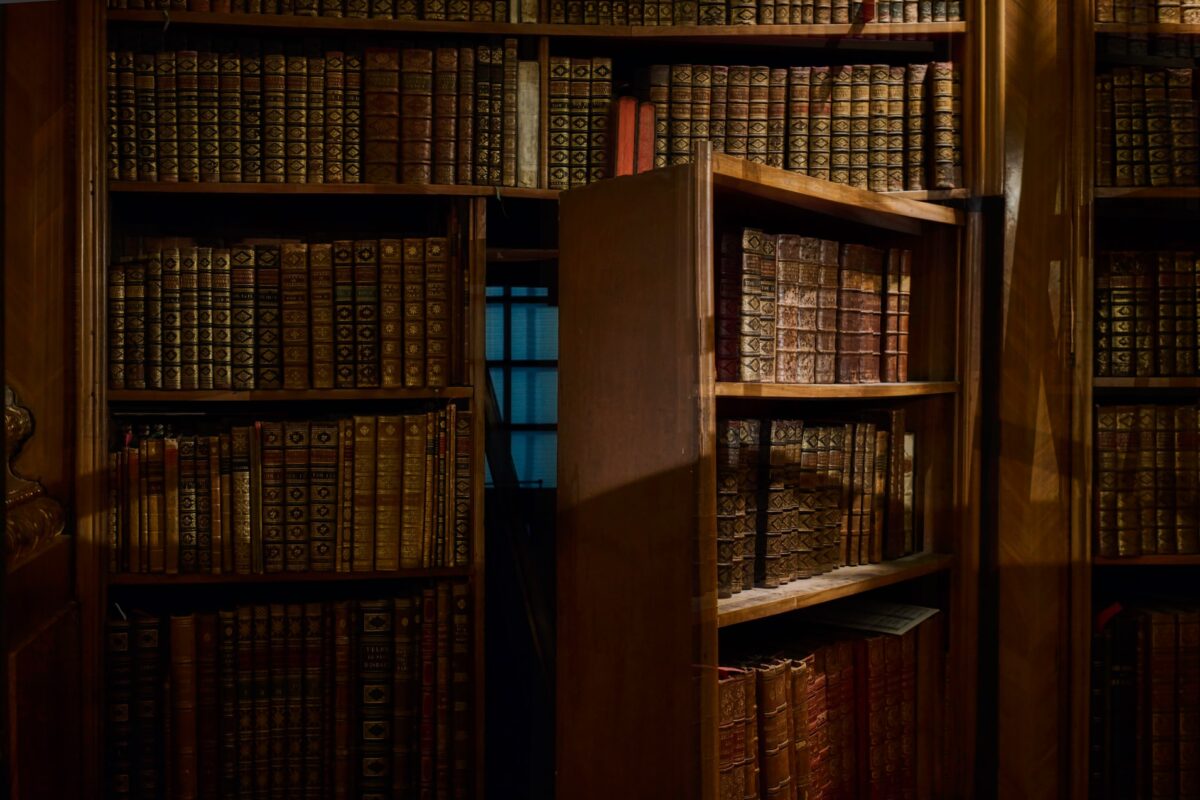
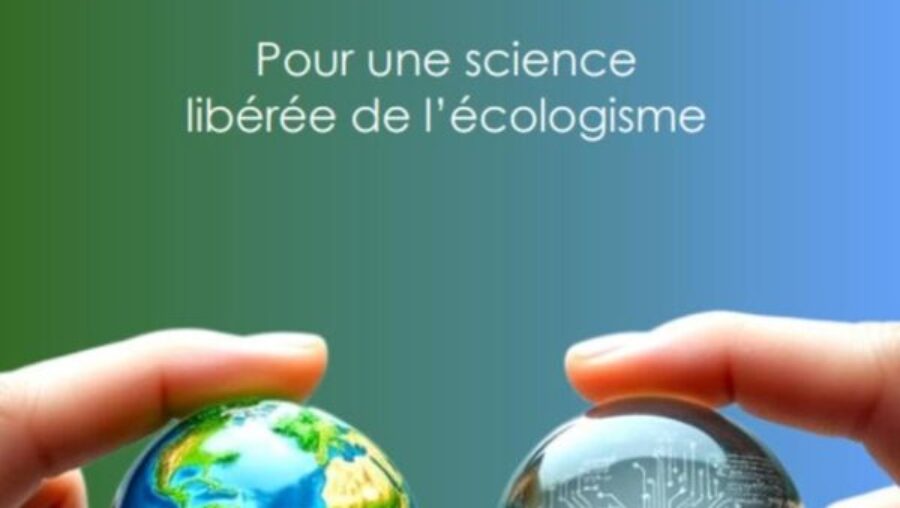
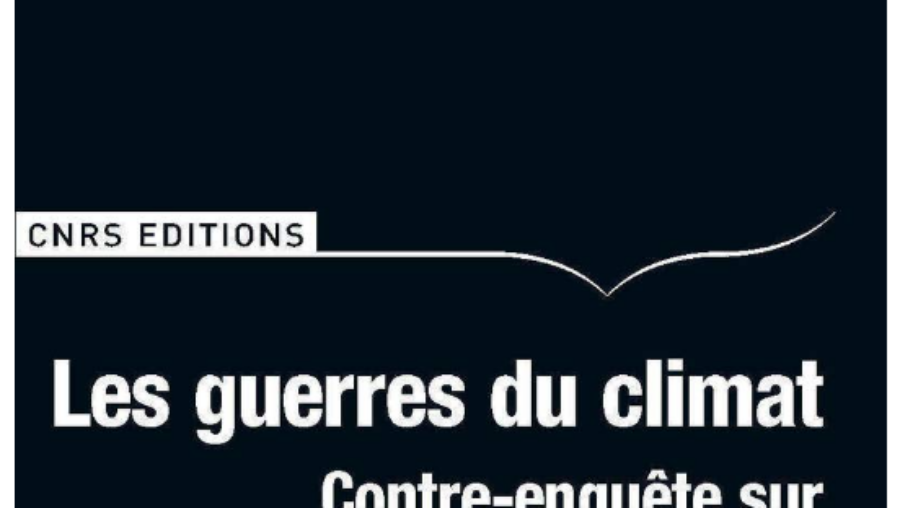

une élite concurrentielle..qui se constate..par les résultats..emerge toujours..
les élites…les “intellectuels? les médias? les universitaires?
Des ratés et des incapables des médiocres des incompétents qui se consolent par leurs élucubrations conscients qu’ils sont de leur incapacité à réaliser quoi que ce soit de valable.
On sait désormais que l’élitisme ne fournit que des menées idéologiques.
Fin du commentaire sur Contrepoints du livre de Piacentini
” Ce déclin a surtout à voir avec des politiques publiques qui semblent être un mélange d’incompétence et d’idéologie de la part d’une petite classe dirigeante perturbant sérieusement le développement naturel des pays occidentaux depuis maintenant plusieurs décennies.”
Olivier Piacentini, La chute finale : l’Occident survivra-t-il ?, Édition Godefroy, 2022, 248 pages.
La V ème République est typique : une minorité (le mot “élite” est trompeur) représentant, grâce au système présidentiel, 25 % de l’opinion, a confisqué le pouvoir depuis 50 ans avec les résultats que l’on constate aujourd’hui.
L’Elite dans sa définition ne peut-être qu’une émanation, du peuple !
N’importe quelle élite, si elle n’est pas choisie, mais auto-proclamée, Tombée du ciel, si elle propose des théories et des solutions qu’elle est seule a connaitre et décider. Est un danger ! (Ursula et l’UE, Pfizer, Jupito-Macron, en sont des formes d’exemples).
En lisant les 4 croyances de l’élite gnostique, je pense au libéralisme plus qu’à toute autre doctrine. La seule différence se trouve au point 4 avec d’un côté soit une élite gnostique et de l’autre juste des individus libres gnostiques.
1/ Le problème réside dans la réalité et non dans une limitation humaine.
2/ Le salut est possible.
3/ L’ordre de la réalité devra être changé dans un processus historique, ce changement étant du ressort de l’action humaine.
4/ C’est au gnostique qu’incombe la tâche d’œuvrer pour un tel changement.
En fait le libéralisme est une gnose.
Le point 4 est vraiment le problème pour le libéralisme, tous les individus ne pouvant atteindre le même niveau de connaissance. Et paf tout l’édifice libérale s’écroule..
@indivisible . Pas d’accord avec vous , ma vision ,point 1 : le libéralisme prône le pragmatisme , il ne veut changer la réalité mais s’y adapter . 2 le salut : ici l’auteur n’est pas assez précis , je pense qu’il voulait dire le salut “sur terre” grosse différence , toute doctrine qui y prétend est en effet totalitaire , 3 , le libéralisme ne veut pas “changer la réalité” : il en prend acte et considère que les êtres humains sont invités à s’y adapter , faire avec , ex : on veut traverser l’océan , le libéral décide de construire un navire , le gnostique dit que la mer c’est mal et ordonne comme action à la plèbe de la vider à la petite cuillère ; 4 : le libéral laisse chacun suivre son chemin . Ce n’est pas plus à Pierre que Jacques de s’y coller , c’est à chacun de “mind his own business”
Bien que cela n’est pas d’une grande importance, je vais défendre mon point de vue.
Le point 1, je le comprend comme une prise en compte de la réalité, le pragmatisme comme vous le souligner, puisque la limitation humaine impliquerait une réduction de la liberté.
Concernant 2, le salut est en effet terrestre, pour les libéraux leurs principes favoriserait la paix et la prospérité. C’est une forme de salut par rapport à une situation illibérale.
Pour le point 3, le libéralisme favorise l’action humaine, certes individuelle, par les échanges libres. Ce qui in fine provoque un processus historique.
4/ le gnostique peut être un libéral. Son action individuelle (avec celles de tous les autres individus) peut transformer le monde.
Il est donc tout à fait possible d’en faire une lecture libérale.
Très intéressante et érudite mise en perspective . On peut aussi noter une certaine filiation cathare chez les écolos écolos actuels . On sous estime généralement chez nous l’éclairage que peut apporter l’étude des mouvements religieux passés , présent pour décoder les possibles dérives futures .