Ah, mes études médicales… Elles sont loin derrière, les années 1980, l’autre siècle !
Elles offraient alors un certain prestige. Quand j’entrais timidement dans les salons bourgeois, tortillant les nougats, moi gamin de basse extraction, les parents des potes prenaient soudain un air respectueux quand je lançais être étudiant en médecine.
J’existais, d’un coup. Ah, le statut social… Gare tout de même : le médecin doit disposer d’un supplément d’âme pour supporter la tâche et se montrer empathique. Il est rugueux, l’exercice et, à l’effort, viennent souvent se mêler les larmes. La souffrance et la mort rodent et le cuir doit se tanner. Pour ceux qui ne considèrent que les avantages, je me permets d’apporter ce témoignage, à l’heure où trop de jeunes confrères se suicident.
Chez les potes, souvent, la question ne tardait pas à suivre. On me demandait un conseil pour soi ou pour grand-mère mais les connaissances sont longues à acquérir. La pathologie, c’était à partir de la quatrième année, pas avant. Un concours, six ans d’examens et de stages puis un second concours, cinq ans d’internat et un post-internat, chef de clinique ou assistant. Passé la trentaine, il fallait encore quelques années de pratique avant de maitriser la chirurgie, si on la maitrise jamais.
Une dégradation du métier de médecin
Il n’était pas bien performant, notre enseignement, pas bien encadré : à chacun de tracer sa voie, le nez dans les livres et cela me convenait. Certains patrons ne jouaient pas le jeu, certains internes se retrouvaient sur la touche et la politique s’imposait, à l’occasion, quand un seul poste de chef était disponible pour plusieurs impétrants. L’ami d’hier vous poignardait sans état d’âme, une bonne vieille école de la vie. Aujourd’hui, éloigné de ces problématiques, je m’avoue admiratif quant aux performances de mes jeunes confrères. Dans le CHU proche de ma clinique, les efforts sont réels pour former des urologues de grande qualité. Le niveau des spécialités est excellent en France. Pour l’instant…
De mon temps, le médecin généraliste était le pivot, non le bras de l’administration : sur lui reposait la prise en charge. Il assurait les urgences, sondages, coliques néphrétiques… Durant les années 1990, la classe technocratique s’est emparée de la santé, dans une ambiance de haine de classe : les médecins vomissaient les directeurs qui les privaient des prérogatives de leurs chefferies de service et les directeurs le rendaient bien, à ces c..s de médecins dépensiers. Rapidement, les bureaucrates ont pris en charge les hôpitaux, multiplié le nombre de cadres, de protocoles et de réunions. Ils ont considéré qu’il était anormal que les urgences soient traitées ailleurs que dans leurs merveilles d’hôpitaux administrés.
Ils ont désinvesti les généralistes, fait campagne dans la presse et vous pouvez admirer aujourd’hui le résultat : urgences submergées de pathologies non urgentes et patients justement amers. On a oublié que l’État a été l’initiateur de cette déroute. Et Touraine, secondée par un certain Véran, a lancé en son temps un plan cancer visant à rapatrier la cancérologie vers le public, une spécialité assurée pour plus de la moitié du volume et moins de la moitié des coûts par les cliniques privées : regardez la tarification T2A et sa fameuse différence privé-public. Les centres publics savent qu’ils ne sont pas en capacité, ils ne souhaitent pas être débordés, précisément en ce domaine et l’entente privé-public est au beau fixe mais madame a décrété, dogmatisme oblige.
Nous verrons, mais je commence à m’inquiéter, non en tant médecin mais en tant que malade à venir.
Les généralistes, donc, ces valeureux praticiens, toujours en première ligne, eux qui se riaient de la fatigue et de l’effort, ont été cantonnés à des tâches administratives. Leur exercice est borné par des réglementations que nos faiseurs des CERFA, technocrates et autres agents des ARS et des dizaines d’administrations en charge pondent à la chaine. Pour ces prodiges, sans qui rien n’irait droit, la réponse est univoque : ils décrètent, feignant de ne pas voir qu’ils démotivent des étudiants désabusés quand ils n’en poussent pas d’autres à se tourner vers d’autres domaines.
Pas de médecin dans les campagnes : on les forcera à y exercer.
Pas assez de médecins en France : on élargit le numerus clausus.
Après 68, on l’a remisé un certain temps, figurez-vous : on comptait des médecins smicards dès les années 1980 et on a dû inventer le MICA, un machin administratif de départ anticipé à la retraite. Belle réussite. Cela fonctionnerait-il encore ? Pas certain : le métier attirait les vocations, pour diverses raisons, y compris financières. Dans un pays, à hauteur de la Suisse en 1980, déclassé, dans une nation sclérosée par les contraintes administratives, appauvrie par une fiscalité et des charges sociales confiscatoires (que les professions libérales encaissent de plein fouet), cela ne fonctionnera peut-être pas.
Et voilà que viennent s’ajouter les considérations idéologiques.
Un changement de mentalité
Ceux qui devraient être des ingénieurs de santé, libres de penser à leur guise, se doivent de faire allégeance à la sainte église du politiquement correct, faute de quoi ils n’auront pas de médecine. Et quel catéchisme, quelle dialectique, quelle hauteur… Supprimez le mot race et adieu racisme, effacez des dates ou des personnages historiques vénérés à leur époque mais faisant tache chez nos vertueux du jour et le monde ira en paix. De futurs Mozart de la chirurgie partiront étudier ailleurs, car ils n’ont pas su exprimer correctement la réaction à adopter dans la chocolaterie « Au nègre joyeux » du musée XVIIIe.
Chacun connait, chez nos ministres, l’expérience de Sherif : la moyennisation passera par là. Déjà, et cela m’horrifie, certains opèrent sans rechigner des jeunes en deçà de l’âge de la maturité cérébrale, qui entendent changer de sexe : 62 % d’entre eux souffrent pourtant de troubles psychotiques, selon les études. Elle est là, la problématique médicale et, père d’un enfant souffrant lui-même de troubles psy, je m’avoue consterné. Selon les mêmes mécanismes, l’idéologie bafouant l’éthique, on impose la moraline en vogue. Je n’aurais surement pas pu poursuivre mes études…
L’an dernier je me suis accroché avec une réanimatrice de l’hôpital qui me reprochait mon manque d’empathie vis-à-vis de mes collègues. J’ai argué que mon empathie allait aux patients. Elle, mère célibataire, trouvait odieux de devoir travailler au-delà des horaires dans un service de réanimation surchargé. L’épidémie la contraignait à bosser après la sortie de la maternelle et c’est elle qu’il fallait plaindre. Je songeais aux malheureux intubés agonisant sur le ventre. Quelque chose a changé…
Les intérêts du praticien priment, à l’occasion. Je me souviens d’une vidéo, un médecin chinois qui tombait épuisé après une semaine sans sommeil à soigner les patients atteint du covid. Peut-être s’agissait-il d’un de ces fameux fake mais je gage que l’incident a pu se produire en Chine.
Certains confrères français, salariés de la faculté de médecine et de l’université, encaissent à l’occasion des honoraires privés assimilés, à l’heure de bilans annuels et sans distinction, à l’activité privée nationale. Ils ne risquent pas de tomber raides de fatigue. On aurait envie de leur suggérer, parfois, avec toute la confraternité qui s’impose : allez bosser… Vous manquez de moyens mais le pays entier en manque, justice, police, santé, armée, faute, entre autres, à tous ceux qui se goinfrent sur le dos de la bête en espérant échapper à leurs obligations. Jamais la réponse ne viendra d’un État, qui peut, au mieux, accompagner. Personnellement, je pense qu’il faut œuvrer à s’en passer et à tracer seul sa route. Vive la liberté…
Voyez l’actuel chef et sa troupe. D’eux, je retiendrai Notre Dame en flammes et la gestion d’une crise qui ne s’est jamais reproduite malgré les annonces. Et je reverrai ce ministre de la Santé, à qui l’on demandait simplement d’assurer l’intendance. S’il a failli en ce domaine, il a pesé sur tous les autres, y compris ceux qui ne relevaient ni de sa responsabilité, ni de ses compétences de bureaucrate.
À ces deuils en cascade, faudra-il ajouter celui des études médicales ?
Et dire qu’ils risquent de rempiler…



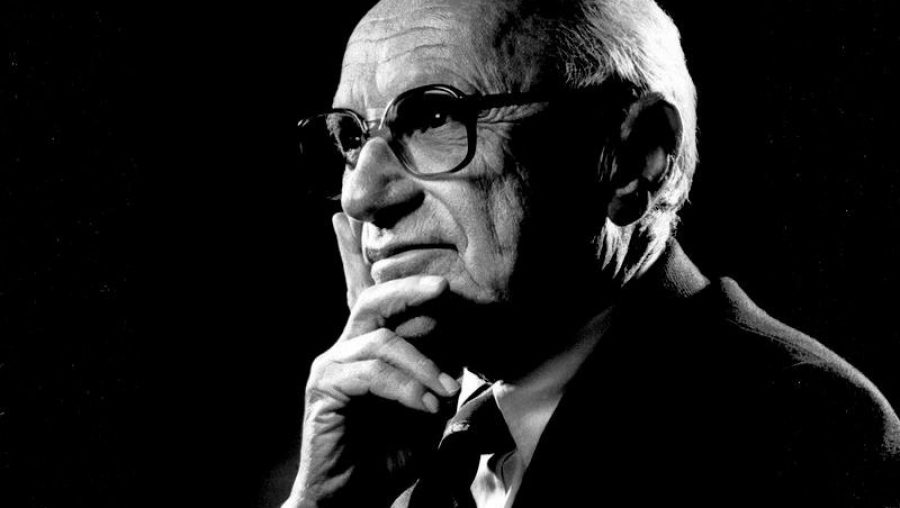

Merci pour ce témoignage. On sent chez vous une grande amertume, qui peut se comprendre au regard du désastre que nous vivons. Un système obèse, suradministré, qui a oublié l’humain pour ne pondre que du soin industriel. La France a montré qu’après les Knysna de toute nature, elle avait souvent la capacité de rebondir. Encore faut-il être conscient de la gravité du problème et mobiliser les ressources humaines capables de le résoudre – pas juste entretenir les copinages pour faire en sorte que l’édifice tienne encore un peu plus.
En même temps comment s’étonner que le niveau baisse en médecine quand le niveau “tout court” sortie du bac s’est effondré depuis les années 90 ?
Si on considère qu’il y a plus de mentions très bien aujourd’hui, en proportion des classes d’âge, que de bacheliers en 1990, même avec une médecine réellement libérale et une formation pédagogiquement excellente, il y aurait baisse. Alors imaginez avec la bureaucratie socialisant qu’est l’hôpital encadré par une autre bureaucratie socialisante comme la sécu, le tout géré par une classe politique marxiste léniniste d’un bout à l’autre du spectre, forcément… CPEF!
“L’épidémie la contraignait à bosser après la sortie de la maternelle et c’est elle qu’il fallait plaindre.”
Je crois qu’une des explications de la folie collective qu’on nous a imposée pendant cette épidémie est là : bien des soignants exerçant à l’hôpital public, de plus en plus, souhaitent avoir une petite vie pépère de fonctionnaire : c’est bien dans la mentalité français actuelle, accro à l’État-providence.
D’où, je crois, tant de médecins hospitaliers réclamant à cor et à cris des mesures plus coercitives les unes que les autres – même si elles ne marchent pas ou très médiocrement, mais c’est une autre question : il ne fallait surtout pas qu’ils soient surchargés, les pauvres petits. Et tant pis pour le pays, pour son économie, son avenir, tant pis pour les libertés élémentaires. Une forme de chantage qui rappelle celui pratiqué par certaines centrales syndicales de certains services dits publics : après eux, le déluge.