Par Ibrahim Anoba.
Un article de Libre Afrique
La promesse d’investissements de 5,1 milliards de dollars de la Première ministre britannique Theresa May, suivie de celle du président chinois Xi Jinping de 60 milliards de dollars de prêts et d’aide, témoignent de l’intérêt porté à l’Afrique. Cependant, la manière d’aider l’Afrique est mal comprise par l’Occident. L’approche de développement à adopter, ainsi les politiques à mettre en œuvre, sont des points sur lesquels les dirigeants africains et leurs partenaires se sont trompés depuis des années. Comment ?
Des prêts sans l’exigence de transparence financière
Les économistes ont du mal à répondre à de nombreuses questions. De combien de prêts le continent a-t-il besoin ? Est-il suffisamment solvable pour rembourser sans être en difficulté financière ? La réponse est simple : les structures administratives financières en Afrique ne sont pas suffisamment transparentes pour permettre une comptabilité rigoureuse des finances publiques.
Par exemple, les facilités de prêt du FMI et de la Banque mondiale dans les années 80 ont été un échec majeur en raison du manque de transparence des pays bénéficiaires. Et au lieu de rembourser leurs créanciers, les États se sont endettés davantage au point de demander l’annulation des dettes, notamment lors de l’initiative de 2005. Et ce n’est pas prêt de changer, puisque la Chine noie le continent de dette par le biais de ses prêts sans discernement.
Une aide étrangère se transformant en concurrence déloyale
Les nobles intentions des donateurs internationaux leur ont gravement nui ainsi qu’aux récipiendaires africains. Ils ont presque détruit le secteur privé, qui est le fondement de l’économie africaine, et ont transformé le continent en un dépotoir économique. Lorsque des dons étrangers visent l’allégement des effets d’une crise à court terme, les dons résolvent rarement le problème.
Au lieu de cela, le déversement de biens gratuits crée une concurrence déloyale, poussant les entreprises locales hors du marché. Par exemple, de nombreux dons internationaux de nourriture et de vêtements pour les victimes de l’insurrection de Boko Haram dans le nord-est du Nigeria se sont retrouvés à l’extérieur du pays. Ces dons ont mis de nombreux commerçants locaux en faillite d’autant que le Nigeria a des industries locales qui auraient pu satisfaire cette demande.
Un scénario similaire a entraîné des problèmes économiques pour le Rwanda, le Zaïre, l’Éthiopie, la Somalie et de nombreux autres pays. Actuellement, l’aide affecte les performances des entreprises locales dans la région du Sahel, où la famine et la sécheresse attirent les dons de l’étranger.
Une pression fiscale freinant le progrès
L’idée selon laquelle les taxes peuvent financer le développement est absurde. L’Afrique ne peut pas pour deux raisons : primo, le revenu moyen en Afrique est faible et, secundo, les économies ne prospèrent que lorsque les individus sont autorisés à conserver le maximum de leurs revenus.
Si plus de la moitié du continent vit déjà en-dessous du seuil de pauvreté, quelle proportion de leurs revenus peut-on crédiblement leur demander de céder au gouvernement sous forme d’impôt supplémentaire ? Quant aux entreprises qui prennent d’énormes risques pour investir sur le continent, devraient-elles être assujetties à des taux d’imposition exorbitants pour financer le train de vie de gouvernements corrompus ?
À l’heure actuelle, de nombreux pays ont mis en place un système d’imposition à plusieurs niveaux pour collecter des impôts auprès des entreprises, quelles que soient leur situation financière ou leur taille. Cela ne tient pas compte du fait que la plupart des propriétaires d’entreprises perdent de l’argent dans la corruption et les prélèvements sociaux obligatoires.
Une gouvernance centralisée alimentant la pauvreté
La plupart des gouvernements africains sont trop gros, trop bureaucratiques et trop corrompus. Mais les choses ne se sont pas toujours passées comme ça. Avant la colonisation l’Afrique était un lieu de tribus distinctes, avec des gouvernements indépendants soumis à des contre-pouvoirs systémiques. Les colons ont fusionné les tribus au sein d’une seule unité administrative centralisée pour des raisons de facilité de gouvernance, et certainement pas pour servir les intérêts des Africains.
Le développement ne peut être orchestré à partir de ces gouvernements centraux bureaucratiques, lorsque les besoins de chaque tribu constituant ces unions fictives diffèrent. Seuls les conseils locaux connaissent réellement les besoins de leurs citoyens et sont donc les mieux placés pour les satisfaire. Les images qui attirent les donateurs étrangers sont des pauvres des communautés rurales isolées. Mais beaucoup de ces personnes sont coupées de l’administration centrale.
Plutôt que de travailler directement avec ces communautés rurales et de tenir compte de leur dynamique, les donateurs étrangers accordent toute leur assistance aux gouvernements centraux ne disposant pas d’une connaissance suffisante des réels besoins de ces communautés. En fait, la plupart des gouvernements utilisent simplement ces ressources pour acheter l’allégeance politique.
Une justice partiale et inefficace
Adam Smith, dans son ouvrage La richesse des nations, a démontré de manière convaincante qu’un système judiciaire impartial favorisait le progrès économique. Il a souligné qu’il était important que le système juridique agisse en tant que médiateur juste dans les litiges entre l’État et ses citoyens, ainsi qu’entre les citoyens de différentes couches sociales. Actuellement, la justice est toujours le chaînon faible de l’Afrique. Si les bailleurs de fonds pouvaient faire pression sur les gouvernements africains pour les inciter à améliorer leur système judiciaire, nombre d’autres réformes pourraient s’enraciner.
Ensuite, il faut limiter le pouvoir de l’État et celui des courtisans qui gravitent autour. Il faut aussi limiter le poids de l’administration et respecter les droits de l’individu. Ce sont des conditions préalables au progrès économique. Mais, dans toute l’Afrique, le système judiciaire protège l’État et ses amis, en particulier dans les cas de litiges en matière de propriété et d’atteintes aux droits fondamentaux.
À titre d’exemple, la politique d’expropriation des terres proposée par le gouvernement sud-africain, qui divise le pays en fonction de critères raciaux, a déjà eu des effets négatifs sur le secteur agricole. De même, le Zimbabwe voisin s’est effondré à la suite de décisions similaires il n’y a pas si longtemps.
Des Africains innocents ont beaucoup souffert des agissements de dirigeants égoïstes. La seule chose qu’ils méritent pour aller de l’avant, c’est le droit de réaliser leur potentiel et de rechercher le bonheur sans l’ingérence de l’État. Une politique aussi altruiste soit-elle en apparence n’est noble que si elle est minutieusement contextualisée pour en évaluer clairement toutes les conséquences.
—


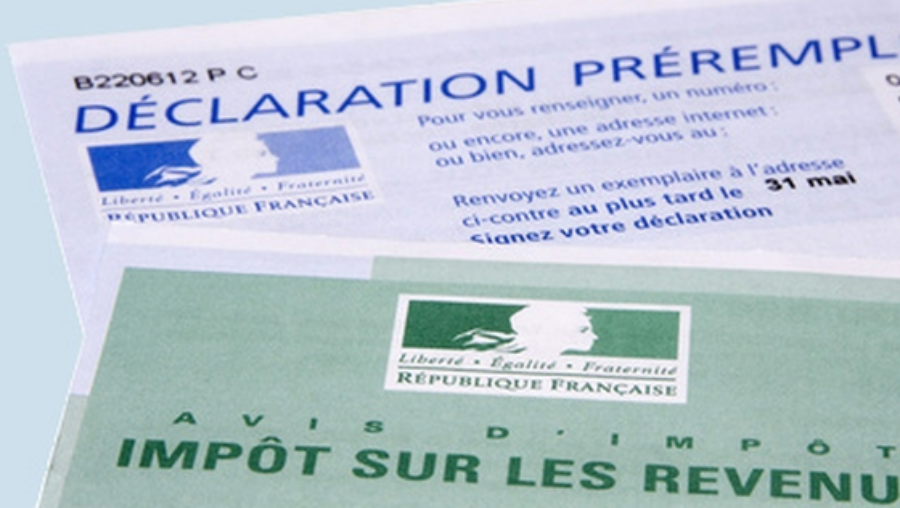


Donc pour résumer:
-si on donne de l’argent il est détourné
-si on donne des biens l’économie locale s’effondre.
J’en conclu: “Sire, surtout ne faites rien! vous nous avez assez aidés”