Un article de la Revue Politique et Parlementaire.
Selon les Marcheurs du parti LREM, le traditionnel clivage gauche/droite appartiendrait au passé, dans la mesure où les Français se moqueraient de savoir si une idée censée être salutaire pour eux relève de la gauche ou de la droite, du moment qu’elle donne de bons résultats. Si l’on peut en effet remettre en question la pertinence de catégories politiques figées comme droite et gauche – le grand penseur et économiste libéral du XIXe siècle, député des Landes sous la IIe République, Frédéric Bastiat, ne siégeait-il pas à gauche à l’Assemblée ? -, reste que la vraie « Révolution » – pour reprendre le titre de l’essai d’Emmanuel Macron (Paris, XO Éditions, 2016) – consisterait à libérer les Français du poids de l’étatisme, et non à continuer de faire croire que nous résoudrons nos problèmes par telle ou telle intervention ou réglementation étatique supplémentaire.
Dans une démocratie véritablement libérale – laquelle diffère complètement d’une démocratie où une majorité tyrannique a tous les droits, y compris celui d’écrabouiller l’individu dans sa sphère d’autonomie propre -, les citoyens n’ont pas à attendre passivement que leur situation s’améliore grâce à l’intervention de l’État, ou du fait de la survenue de quelque supposé homme politique providentiel que ce soit ; les solutions aux problèmes qui se posent à eux ne peuvent se trouver qu’en eux-mêmes, que dans l’usage qu’ils font de leurs ressources personnelles, ressources qu’ils peuvent librement choisir de mettre en commun avec d’autres s’ils le souhaitent, par convergence d’intérêts licites. Dans une démocratie libérale, c’est-à-dire une démocratie assise sur le respect des droits individuels inaliénables, et sur la circonscription du pouvoir étatique dans des limites nettement définies, ce sont les individus qui sont les principaux acteurs de leur propre destinée, de leurs réussites comme de leurs échecs, de leur bonheur comme de leur malheur.
Dans une société pleinement libre, l’individu peut certes connaître le succès comme l’insuccès – un, voire plusieurs échecs, étant parfois le prélude à sa réussite future -, mais dans un cas comme dans l’autre il ne s’appartient, ou devrait ne s’appartenir qu’à lui-même. C’est dans les sociétés anciennes, tribales ou féodales, que les individus, considérés comme la propriété du chef ou de la collectivité, dépossédés ainsi d’eux-mêmes, n’ont d’autre rôle que celui qui leur est imparti d’en haut, sans réelle possibilité pour eux de décider ou d’agir pour leur propre compte, en leur âme et conscience. A contrario, dans une démocratie libérale, les dirigeants doivent pour l’essentiel se borner à garantir le respect de l’État de droit, cadre législatif nécessaire, sans lequel il ne saurait sans doute y avoir de libre accomplissement des individus par eux-mêmes ; or bien souvent nos dirigeants tentent de nous faire croire qu’eux seuls sont à même de nous fournir les « recettes » propices au succès et au bien-être des individus, ce qui revient alors à entretenir le mythe selon lequel ces derniers ne peuvent réellement exister que dans ou par l’État.
Dans une démocratie libérale, le rôle premier du politique ne consiste pas à prendre des « mesures » ou à établir des « dispositifs » en tous genres ; il ne consiste pas à légiférer à tour de bras sous prétexte qu’il y va de l’intérêt général, mais à garantir l’autonomie de la société civile, condition sine qua non au développement et à l’épanouissement et des individus qui la composent.
À cet égard, notre État doit cesser d’être un État encore largement guidé par les idées collectivistes, et doit devenir un État libéral : un État faisant respecter l’État de droit, mais laissant le soin aux individus de se déterminer eux-mêmes, de créer et d’innover librement, d’accroître les limites de leur champ d’action, sans jamais chercher à se substituer à eux dans leurs choix ou la conduite de leur existence. En d’autres termes, notre État doit cesser d’être, comme dit Max Stirner dans L’Unique et sa propriété (1844), « l’ostracisme organisé des Moi » ; et il doit aussi savoir revenir aux principes fondateurs de 1789 que sont le respect de la liberté individuelle et de la propriété privée1.
De cet État libéral – contradiction qui n’est en fait qu’apparente -, nous sommes encore bien trop éloignés, sans doute parce que l’expérience socialiste faite au XXe siècle, à laquelle nombre de pays de par le monde se sont livrés avec les résultats catastrophiques que l’on sait, aura, en dépit de ses échecs patents, durablement marqué notre perception du rapport souhaitable entre l’État et les individus. Les « progressistes » n’ont en effet de cesse de vanter les mérites supposés de notre (coûteux) « modèle social », ensemble d’acquis auquels les Français ne renonceraient dit-on pour rien au monde, sous peine de devoir à nouveau sombrer dans le capitalisme « sauvage » du XIXe siècle et la « tyrannie » du marché libre. Ce à quoi nous répondrons que la plupart des problèmes auxquels la France est confrontée depuis des décennies, que ceux-ci soient notamment d’ordre économique ou social, tient justement au fardeau accablant du progressisme et de l’interventionnisme étatiques, incompatibles avec les principes fondamentaux d’un État libéral. La seule « révolution » que nous pouvons donc souhaiter voir advenir est celle qui nous délivrerait enfin une fois pour toutes de la tyrannie étouffante de l’expansionnisme étatiste, chose qui impliquerait alors une mue complète de notre État, dont le fonctionnement est encore trop marqué par les principes collectivistes, en un État authentiquement libéral.
Les « progressistes » auto-proclamés ne manqueront pas de voir dans ces lignes la marque d’un « conservatisme » étriqué et « réactionnaire ». Or quels sont les vrais progressistes et quels sont les vrais conservateurs ? L’essayiste américain Dinesh D’Souza a écrit qu’être « conservateur » (au sens américain du terme, c’est-à-dire l’opposé de liberal, qui désigne paradoxalement en anglais le soutien accordé à l’interventionnisme étatique), c’est vouloir préserver les acquis de la Révolution américaine – que, soit dit en passant, nombre de démocrates radicaux, adeptes du politiquement correct woke, s’efforcent actuellement de détricoter. Il serait peut-être enfin temps d’établir en France un véritable conservatisme de cette nature, c’est-à-dire un conservatisme entendant conserver précisément les acquis fondamentaux de notre Révolution, laquelle fut foncièrement libérale, en dépit de son dévoiement mortifère que constitua la dictature jacobine.
Ce n’est qu’en redécouvrant ces apports, ce n’est qu’en reprenant conscience de l’existence d’une riche et puissante tradition intellectuelle libérale française, remontant aux XVIIIe et XIXe siècles (Montesquieu, les physiocrates, Turgot, Condorcet, Sieyès, Jean-Baptiste Say, Germaine de Staël, Benjamin Constant, Frédéric Bastiat, Tocqueville, Gustave Le Bon, etc.), que les Français pourront alors peut-être renouer avec le goût de la liberté individuelle, et ainsi avancer dans la direction souhaitable du recouvrement de leur propre autonomie économique et culturelle. Mais ces derniers n’y arriveront pas s’ils continuent de croire que leur destin est entre les mains des dirigeants politiques, lesquels, ne l’oublions jamais, entendent accroître toujours davantage la sphère de l’État au détriment de celle des individus.
Article initialement paru sur le site de la Revue Politique et Parlementaire. Lien vers l‘article original.
- Sur les principes fondamentaux de la Révolution française, voir par exemple Aux sources du modèle libéral français, sous la direction d’Alain Madelin, Paris, Perrin, 1997. ↩



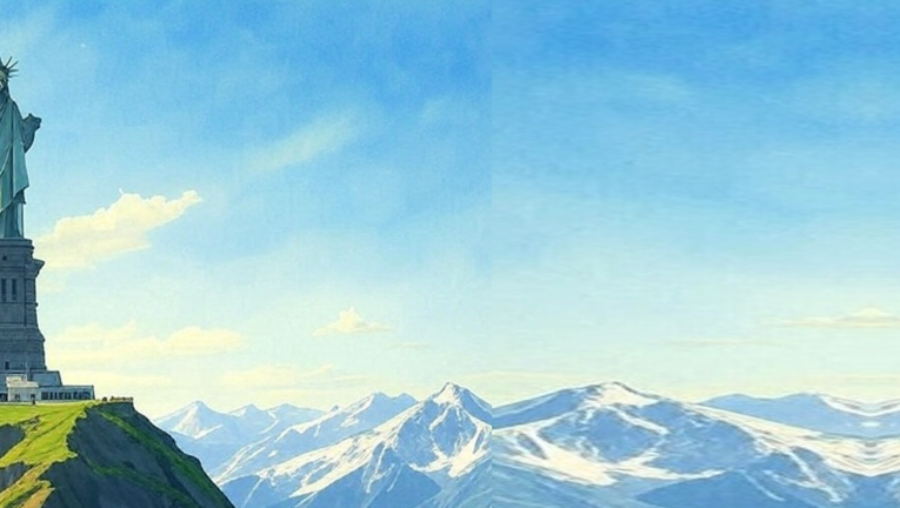

«C’est dans les sociétés anciennes, tribales ou féodales, que les individus, considérés comme la propriété du chef ou de la collectivité, dépossédés ainsi d’eux-mêmes, n’ont d’autre rôle que celui qui leur est imparti d’en haut, sans réelle possibilité pour eux de décider ou d’agir pour leur propre compte, en leur âme et conscience.»
C’est un poncif fabriqué par les révolutions successives. La réalité était beaucoup plus variable, le pouvoir étant limité géographiquement par la quasi absence de bureaucratie. En dehors de la zone d’influence directe du “chef autoritaire” il y avait de la place pour les libertés individuelles. Ce n’est pas quelque chose de nouveau pour les humains, les milliers de sociétés ont expérimentés mille façons de vivre ensemble.
A contrario aujourd’hui dans l’Etat-nation avec ses frontières et sa bureaucratie étendue, mon identité (donc ma réalité physique) ne dépend que d’un papier officiel. Sans ce dernier je ne suis rien. Même dans une démocratie libérale, je n’aurai que la liberté du poisson rouge dans son bocal. Il faudrait non seulement revoir la place de l’Etat mais aussi son essence si on veut parler libertés.
Vivre dans une démocratie libérale comme décrite dans cet article, où l’Etat est réduit strictement à ses fonctions régaliennes, veille sur la société et protège les droits naturels ne serait déjà pas si mal. Je ne vais pas faire ma fine bouche, si cela arrivait cela serait un des jours les plus heureux de ma vie.
Après on se battra pour l’abattre lol.
https://www.wikiberal.org/wiki/État_gendarme
Je parlais surtout de l’Etat-nation !
Nation comme collectif complètement virtuel et État comme souveraineté. Tout ce que j’aime…
Je suis plutôt d’accord avec l’article donc je ne vais pas paraphraser les idées de l’auteur, par contre avant la Révolution les choses n’étaient pas non plus dans l’obscurité totale avec un contrôle omniprésent, loin de là. De nombreux “anciennement sujets du roi” ont vu débarquer des représentants de l’Etat la toute première fois avec les troupes jacobines venues les mater. Les recherches de François Furet (un historien communiste devenu libéral) en atteste. Gustave Le Bon avance l’idée dans un de ses livres, que sans la révolution nous serions arrivé plus ou moins au même niveau de liberté politique (il parle à la fin 19ème/début 20ème) avec une monarchie qui aurait été obligée de se réformer et d’évoluer vers une forme constitutionnelle, ça nous aurait permis d’éviter les épuration, rébellions, instabilités institutionnelles et les ismes en tout genre qui ont pullulé après la Révolution et pendant tout le 19ème pour aboutir au final aujourd’hui avec une société complètement amorphe, défaite, clivée, étatisée et sortie de l’Histoire dans laquelle on serait bien en peine de trouver ce qu’il faut conserver et personnellement je suis plutôt un conservateur dans l’âme.
Judicieux rappel. Au temps où les mots ne veulent plus rien dire. Les progressistes de jadis, c’étaient les libéraux des Lumières, ceux à l’origine de la Déclaration de 1789.
Aujourd’hui, je ne sais par quelle entourloupe, ce sont des gauchistes plus ou moins radicaux qui se présentent comme tel. Or tout dans leurs manières et leurs idées – schlague et goulag – montre qu’ils n’ont RAB du libre choix des individus.