Saras Sarasvathy, à l’origine de la théorie entrepreneuriale de l’effectuation, vient de recevoir le prestigieux prix suédois « Global Award for Entrepreneurship Research ».
Organisé depuis 1996 par la Swedish Foundation for Small Business Research (FSF) et la Swedish Agency for Economic and Regional Growth, le prix récompense les chercheurs ayant apporté une contribution majeure à la recherche en entrepreneuriat. Elle rejoint ainsi de grands chercheurs comme Sidney Winter, Shaker Zahra, Kathleen Eisenhardt, Scott Shane, Israel Kirzner, William Gartner, William Baumol ou encore Zoltan Acs et David Audretsch. L’économiste français Philippe Aghion a reçu le prix en 2016.
Le prix couronne plus de vingt années d’efforts pour promouvoir une approche radicalement différente de l’entrepreneuriat. Mais sa signification va bien au-delà car l’effectuation, c’est avant tout une vision de l’action humaine et de la liberté.
Connaissez-vous Saras Sarasvathy ?
Née en Inde, elle est aujourd’hui professeur à Darden business school (Virginie, USA). Dans les années 1990, elle est à la tête d’une entreprise familiale qui fabrique des bidons en plastique pour l’industrie pétrolière. L’affaire est florissante jusqu’à ce que son usine soit détruite par des inondations. Elle venait d’y faire de gros investissements, et elle perd tout en une nuit (de façon intéressante et comme un pied de nez aux risk managers, on lui avait assuré qu’elle se trouvait dans une zone non inondable).
Après quelques semaines de sidération, elle finit par partir aux États-Unis, incitée par son frère qui y réside déjà, sans idée claire de ce qu’elle va faire. Par une suite de hasards et d’aventures toutes plus incroyables les unes que les autres, et que je vous raconterai un jour, promis, elle finit par atterrir dans le bureau de Herbert Simon pour y faire un doctorat. Herbert Simon est quelqu’un d’assez unique : décédé en 2001, il était le père de l’intelligence artificielle, mais aussi prix Nobel d’économie, et via Sarasvathy, l’inspirateur de l’effectuation. Rien que ça !
Sarasvathy part d’une question très simple, comme toutes les grandes questions de recherche : comment les entrepreneurs créent-ils de nouveaux produits, de nouvelles organisations et de nouveaux marchés ? La réponse traditionnelle, un éclair de génie puis une mise en œuvre via un plan, ne la satisfait pas. Elle va donc observer des entrepreneurs pour voir ce qu’ils font vraiment et comprendre comment ils raisonnent face aux problèmes classiques qu’ils rencontrent : comment on démarre, comment on trouve une idée, un produit ou un client, comment on prend une décision, etc.
Elle va mettre en avant cinq principes dominants dans ces décisions :
- Faire avec ce qu’on a
- Agir en perte acceptable
- Co-créer avec des parties prenantes
- Tirer parti des surprises
- Créer le futur qu’on veut
Ce sont ces cinq principes qui constituent l’effectuation.
L’effectuation révolutionne la pensée entrepreneuriale car elle ne s’inscrit pas du tout dans le paradigme dominant de l’économie néo-classique qui ignore tout simplement l’entrepreneur. La puissance de l’effectuation est qu’elle décrit ce qui est, ce que les entrepreneurs font, pas ce que nous aimerions qu’ils fassent. L’effectuation n’est pas prescriptive, elle ne dit pas « ne faites pas de prédictions », mais « vous n’avez pas besoin d’en faire ». Elle souligne le suffisant, pas le nécessaire.
Ce prix est important car comme toutes les ruptures, l’effectuation a eu du mal à faire sa place dans le champ académique. Malgré plus de 100 articles dans les meilleures revues d’économie, de management et de psychologie depuis 20 ans, les principes qu’elle met en avant suscitent les réserves de nombreux chercheurs, dont beaucoup restent ancrés dans un paradigme cartésien qui suppose que les états futurs de l’économie peuvent être anticipés à condition d’avoir une connaissance suffisante du présent. Qu’il n’y a pas d’incertitude, mais seulement de l’ignorance.
Le monde est continuellement en création par les choix humains
Face à un monde vu comme statique car connaissable, l’effectuation défend au contraire l’idée d’un monde dynamique et ouvert, complexe, baignant dans l’incertitude, et continuellement généré par les actions et les choix humains (outre les phénomènes naturels). Avec les systèmes humains comme les organisations ou les marchés, le futur est créé. Il ne préexiste pas. Il ne s’agit donc pas de découvrir, d’explorer ou de prédire le futur, ce qui est impossible, mais de le construire. Le futur est donc ouvert, perpétuellement en construction, et cette construction est le produit de l’action humaine créative. Cette action prend le nom d’entrepreneuriat, de science, d’art, de politique, peu importe. Au moment où j’agis, le futur n’est pas seulement inconnu, il est indéterminé, car il va résulter de la multitude de choix et d’actions faits au même moment par les autres acteurs en plus des miens.
Cette nécessité de voir le monde comme non déterministe et construit en permanence, et donc non prévisible, avait déjà été théorisée en sciences par un physicien pionnier, Ilya Prigogine, dès les années 1980. Ses travaux ont inspiré de nombreux économistes, mais le paradigme néo-classique est resté dominant, y compris en entrepreneuriat, jusqu’aux travaux de Sarasvathy.
La portée philosophique est importante : si le monde est incertain, il est ouvert. S’il est ouvert, il laisse la possibilité de l’action humaine créatrice. Autrement dit, l’incertitude est la condition de la liberté humaine, elle fait que l’être humain n’est pas enfermé dans un futur déjà écrit, et surtout écrit par d’autres. À ce sujet, l’effectuation met en avant la notion de contrôle non prédictif : si vous agissez pour changer votre contexte, vous n’avez pas besoin de faire de prédiction. De même, l’entrepreneur n’est pas celui qui corrige les « erreurs » des acteurs économiques, comme proposé par le grand chercheur en entrepreneuriat Israël Kirzner, car cela suppose un critère de vérité absolu, ce que rejette l’effectuation.
Dans le langage académique, l’effectuation promeut une vision « non téléologique » de l’action, c’est-à-dire non séparée de l’acteur. Tout part de l’être humain agissant et tout s’y ramène. Il n’y a pas besoin de vision lointaine, pas besoin d’objectif ambitieux, pas besoin d’idéal à satisfaire ni même de critère de performance. Toutes ces notions abstraites sont hors de l’humain et le transforment en moyen d’une finalité. L’effectuation renverse cela en faisant de l’humain agissant le point de départ et le seul critère d’action, et montrant comment les buts que l’on se fixe n’ont pas besoin d’être un point de départ, mais peuvent au contraire émerger de l’action elle-même. Vision, opportunité, marché, produits et services, objectifs, buts, organisations, tout cela est le produit de l’action humaine.
L’entrepreneuriat pour tous
De façon importante, la simplicité des principes de l’effectuation fait qu’ils sont applicables par tout un chacun. À rebours de l’entrepreneur conçu comme un deus ex machina ou un super-héros visionnaire et omnipotent, l’effectuation affirme que tout le monde peut agir de façon entrepreneuriale, entendue comme la possibilité d’être en partie maître de son destin.
En changeant la vision dominante de l’entrepreneuriat, l’effectuation libère ainsi l’action de nombreux individus qui pensaient, à tort, que l’entrepreneuriat n’était pas pour eux. Mais les travaux de Sarasvathy et des nombreux autres chercheurs à sa suite vont bien au-delà de la seule question de l’entrepreneuriat. Dans son discours de réception du prix, elle a d’ailleurs souligné combien les principes de l’effectuation s’appliquent à toutes les grandes questions des sociétés humaines: organisations, bien-sûr, mais aussi pays.
Comme toutes les grandes innovations, l’effectuation questionne les modèles mentaux dominants, et elle met donc du temps à s’imposer. La reconnaissance académique est désormais acquise par les multiples articles et numéros spéciaux, la diffusion des principes auprès des entrepreneurs progresse également rapidement, et le prix suédois vient couronner ces vingt années d’efforts d’une communauté internationale en plein développement.
Saras Sarasvathy n’est pas juste une très grande chercheuse, c’est aussi quelqu’un de très humain. J’ai la chance de travailler avec elle depuis plusieurs années sur un projet de recherche (avec mon camarade Dominique Vian). Combien de fois, en raccrochant après une session de travail, nous nous sommes dit « Eh bien nous sommes un peu moins bêtes qu’il y a 1 h 30 ». Saras est un esprit puissant – avec elle une discussion est une joute impitoyable sans concession, vous avez intérêt à être préparé – mais elle reste très humaine, accessible aussi bien par un grand chercheur que par un étudiant de première année (elle accueille en général ses étudiants chez elle à la fin du cours et c’est elle qui fait la cuisine). Je garde ainsi précieusement le message incroyable qu’elle m’avait envoyé lorsque j’avais eu un gros problème de santé il y a quelques années. Elle fait, vraiment, partie des gens qui rendent le monde meilleur.
Voilà… joignez-moi en félicitant Saras Sarasvathy, bien sûr pour son prix, pour son travail pionnier et sa défense infatigable de l’entrepreneuriat pour tous, mais surtout… pour qui elle est !
—


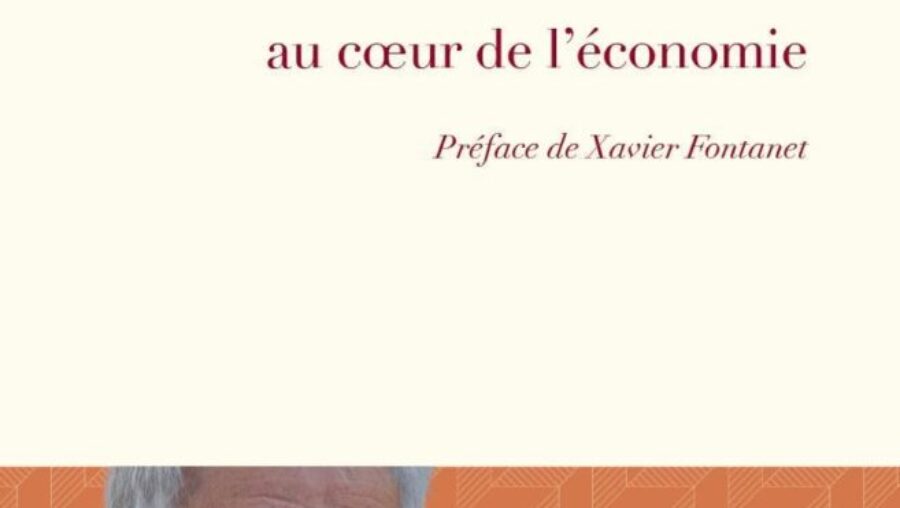
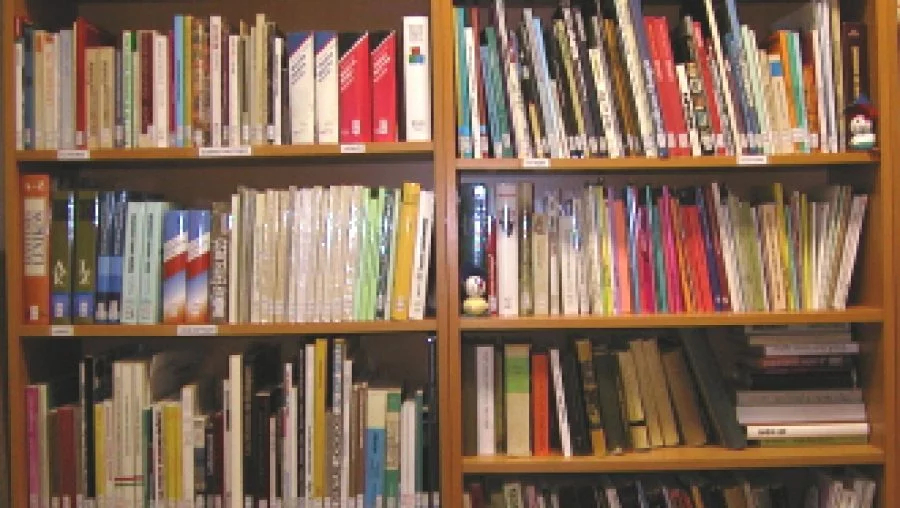

Laisser un commentaire
Créer un compte