À l’heure où l’Union de la gauche reprend tous les poncifs anti-marché qu’elle a dans sa manche pour améliorer le bien-être social (comme le contrôle des prix, l’augmentation du salaire minimum, etc.), il est temps pour les lecteurs et moi-même de repartir à la découverte de théories d’auteurs abandonnés, inexploités, et pourtant très pertinentes, pour comprendre les problèmes de notre pays.
Nous parlerons donc aujourd’hui de la théorie classique du chômage, et de son plus grand défenseur, l’économiste William Harold Hutt.
Les enseignements prékeynésiens sur la lutte contre la dépression affirment que le chômage (en tant que phénomène à court terme) et la dépression sont dus à une contraction du flux des salaires et des autres revenus par le biais d’une certaine désorganisation du système de fixation des prix. La désorganisation est imputée à un trop grand nombre de taux de salaire (et donc de prix finaux) fixés au-dessus des niveaux de compensation du marché, c’est-à-dire trop élevés par rapport au revenu ou en contradiction avec les attentes en matière de prix. William Harold Hutt, Keynesianism: Retrospect and Prospect, 1979.
Comprendre la théorie pré-keynésienne : l’économie de William Harold Hutt
La théorie de Hutt repose sur une réhabilitation de la loi de Say. Loin d’être une théorie nouvelle, Hutt considère perpétuer la tradition classique de la théorie du chômage, citant à l’appui l’économiste Frederick Lavington dans son livre The Trade Cycle :
L’inactivité de tous est la cause de l’inactivité de chacun.
De quoi faire dresser le poil de toutes les personnes qui ont tout fait pour répartir artificiellement l’emploi entre les travailleurs.
Toute offre de produits correspond à un pouvoir d’achat pour consommer d’autres produits non en concurrence avec ceux-ci. Ainsi, l’identité de Walras fait suite : l’offre agrégée de biens correspond à la demande agrégée de biens. J’invite le lecteur à lire mon article sur le sujet.
Le problème se situe ici du côté de l’offre et non de la demande. Alors que les approches keynésiennes considèrent la difficulté comme une incapacité à demander (un manque de demande globale), l’approche de Hutt soutient que c’est l’oisiveté ou une incapacité à offrir (au prix de compensation du marché) qui déclenche le processus de dépression.
Si, comme l’indique la loi de Say, la capacité à demander ne peut provenir que d’un acte d’offre préalable, blâmer l’insuffisance de la demande globale revient à contourner le problème. Le pouvoir de demander ne peut faire défaut que si, pour une raison quelconque, un actif productif n’a pas été fourni.
Étant donné le point de départ de Hutt selon lequel tous les actifs productifs sont désirables à un certain prix, l’explication la plus probable de la non-fourniture de travail est que quelque chose empêche le prix d’équilibre du marché d’être atteint. Le processus dépressif doit commencer par une barrière à la coordination des prix quelque part sur un marché d’intrants. Plus ces barrières sont répandues, plus la dépression s’installera rapidement lorsqu’un besoin d’ajustement à la baisse du prix des intrants se fera sentir.
La théorie de l’oisiveté
Qu’est ce que Hutt entend par oisiveté ?
Il y en a trois sortes :
- L’oisiveté préférée (les gens ne travaillent pas et ne cherchent pas de travail, toutes choses égales par ailleurs).
- La pseudo-oisiveté (quelqu’un qui ne travaille pas, mais use de ressources pour se réinsérer).
- L’oisiveté engendrée par les prix (price-driven idleness).
C’est cette dernière qui nous intéresse ici, car elle présente le plus grand intérêt théorique et politique. Elle regroupe un certain nombre de catégories propres à Hutt, mais toutes ont en commun le fait que l’oisiveté est créée lorsque certains ou tous les facteurs de production sont capables de maintenir de manière coercitive les salaires ou les prix au-dessus des niveaux de compensation du marché (leur prix d’équilibre). Hutt divise ces formes d’oisiveté en : oisiveté participante, oisiveté forcée, capacité retenue, oisiveté de grève et oisiveté agressive.
En résumé, quels sont les obstacles qui peuvent se mettre au travers de ce processus de marché qui vise à ajuster offres et demandes, entraînant des prix artificiellement plus élevés dans des secteurs particuliers ? Voici quelques exemples : la menace de grève (strike-threat system), les syndicats, la collusion entre entreprises, les licences professionnelles, l’imposition massive empêchant la constitution d’actifs, le salaire minimum, les numerus clausus, etc.
Si les travailleurs peuvent contraindre les producteurs à payer à tous les travailleurs embauchés un salaire supérieur à celui qui serait obtenu sur un marché concurrentiel, cela crée de l’oisiveté à la fois chez les travailleurs de l’industrie donnée qui ne sont pas embauchés au salaire supérieur au marché et chez les travailleurs d’autres industries qui sont licenciés en raison de la contraction des salaires et des flux de revenus qui en résultent. Les travailleurs ayant un certain pouvoir de monopole, probablement accordé à un syndicat en tant qu’agent de négociation collective soutenu par la protection de l’État, sont en mesure de retenir la capacité en forçant les salaires à dépasser les niveaux d’équilibre du marché.
Ces obstacles sont des retenues (withholdings) sur les capacités productives (withheld capacity) des individus, qui entraînent des défauts dans le système des prix. La protection des uns force un déplacement des ressources là où elles sont moins productives, voire les rend oisives. L’oisiveté persistera tant que les ressources seront fixées à des emplois sous-optimaux.
Le sursalaire des uns est le sous-salaire des autres
Nous pouvons dire que la main-d’œuvre est demandée pour toute activité lorsqu’un taux de salaire suffisant est offert pour acquérir toute offre réelle. Dans une économie coordonnée, le terme suffisant se réfère uniquement à l’avantage net des autres emplois disponibles pour les travailleurs dont les services sont recherchés. En toute circonstance, on peut dire qu’un taux de salaire est suffisant lorsqu’il est assez élevé pour retenir ou attirer les travailleurs potentiellement rentables dans cette activité.
Comme cela a été soulevé par William Harold Hutt, les demandes d’intrants et sortants des entreprises non-protégées étaient sérieusement limitées par le poids des entreprises protégées (entreprises où les syndicats sont généralement très présents). La théorie de Hutt peut également être considérée comme un complément intéressant à la théorie de la protection effective développée par Pascal Salin dans son livre Libre-Échange et protectionnisme, surtout car les industries défendues à l’aide du protectionnisme, affiché ou caché, sont bien souvent les mêmes qui comptent une forte influence des syndicats.
En somme, le sur-salaire des uns est payé par le sous-salaire des autres. C’est un constat aussi partagé par Hayek dans sa Route de la servitude : le niveau de vie des travailleurs protégés a été surélevé en diminuant celui des travailleurs non-protégés. De ce constat, Hutt montre que les faux prix des uns (fixés au-dessus du prix d’équilibre, le market-clearing price) entraînent l’oisiveté des ressources dans l’économie, une sorte d’équilibre de sous-emploi (Joan Robinson), ou plutôt d’emploi sous-optimal.
On pourrait dire que la demande de main-d’œuvre dans une profession quelconque est excédentaire lorsqu’un plus grand nombre de travailleurs pourraient être employés de façon rentable dans cette profession s’ils étaient disponibles à des taux de salaire réglementaires. Mais disons plutôt que le taux de salaire est déficient. En effet, cela signifie que le taux de salaire offert est insuffisant pour retenir ou attirer (d’autres emplois ou du chômage) toute la main-d’œuvre qui pourrait être employée de manière rentable dans cette activité au taux de salaire plus élevé.
C’est la façon la plus claire de décrire une situation dans laquelle il n’y a pas d’incitation à ce que les offres et les demandes potentielles deviennent des offres et des demandes réelles. Mais toute demande réelle de main-d’œuvre la retient ou l’attire toujours. Sinon, elle n’est pas demandée ! C’est l’illustration de l’équilibre de l’emploi sous-optimal.
« Ceci m’amène au point crucial de ma contribution. Il est concevable que les taux de salaire d’équilibre du marché soient bien inférieurs aux niveaux auxquels la main-d’œuvre oisive pourrait être utilisée de manière rentable si les autres travailleurs n’attendaient pas simultanément des taux de salaire supérieurs aux niveaux d’équilibre immédiats du marché. » William Harold Hutt, A Rehabilitation of Say’s Law
La théorie de l’oisiveté comme théorie du processus de marché
Dans son A Rehabilitation of Say’s Law, Hutt prend bien soin de rappeler que c’est toujours la valeur prospective du produit marginal (VPM) qui importe.
Les entrepreneurs ne peuvent pas savoir avec certitude quel sera le produit marginal d’un travailleur, ils doivent donc se fier à leurs anticipations en matière de productivité lorsqu’ils prennent des décisions salariales. Il se peut qu’au fil du temps, la VPM du travailleur se révèle plus élevée que prévu, mais les entrepreneurs ne sont pas en mesure de connaître le cours futur des événements du marché et ne peuvent fixer les salaires qu’en fonction de leurs anticipations pour le présent.
Hutt prend d’ailleurs une vision très autrichienne en s’intéressant au produit marginal prospectif, mais aussi grâce à son appréciation du processus d’apprentissage ou de tâtonnement par lequel les VPM sont découvertes sur le marché. L’entrepreneur huttien joue le rôle-alerte décrit par Israel Kirzner, et participe à un processus de découverte, d’apprentissage, permettant de coordonner les différents aspects de l’économie.
Hutt reconnaît d’ailleurs la supériorité de l’économie autrichienne sur l’économie marshallienne dans la description de ce processus dynamique. De plus, ce focus sur les valeurs prospectives marginales permet de comprendre mieux encore le rôle des pertes et des profits dans un système capitaliste, car les pertes permettent de revoir à la baisse là où les anticipations des VPM étaient surévaluées, pour rediriger les ressources vers d’autres domaines, où celles-ci ont été sous-évaluées. L’entrepreneur reste un spéculateur, en ce sens qu’il doit anticiper ce que sera le futur pour organiser son plan de production et s’assurer des profits.
Conclusion
Ce n’est pas un problème de demande effective, mais un problème de prix. Voilà le vrai multiplicateur. L’oisiveté des ressources par la fixation de faux prix dans l’économie entraîne un effet dépressif multiplicateur, loin de la vision mécanique du multiplicateur de Keynes.
Comme tout obstacle entraîne un effet multiplicateur négatif, la levée de ces obstacles entraîne un effet multiplicateur positif. Le retour à la normale des sur-salaires dégage des ressources vers les secteurs qui en ont besoin. Dans le même temps, le retour à la normale des sous-salaires entraîne le retour sur le marché des ressources qui restaient oisives. Si les syndicats réussissent à empêcher la baisse des salaires, l’oisiveté deviendra chronique.
Pour résoudre ces problèmes de faux prix, une seule solution : la réforme institutionnelle qui consiste à lever ces obstacles pour créer les incitations à la fixation des prix qui ajuste le marché. Nous sommes ici bien loin des propositions faites par les partisans de l’Union de la gauche, qui souhaitent monter le niveau du Smic, alors que c’est l’ensemble des prix de l’économie qui sont discoordonnés par l’ensemble des privilèges, patentes et autres acquis sociaux qui s’accumulent depuis des décennies.
Une place pour l’idée de demande effective ?
Cette coordination doit être aidée par une politique de flexibilité monétaire, c’est à dire qui stabilise le niveau de dépense nominale pour éviter les influences néfastes de l’inflation ou de la déflation monétaire. C’est le point de William Hutt, qui rejoint par cela les théoriciens du déséquilibre monétaire.
C’est ce que proposent les monétaristes de marché et les free-bankers. Selon Hutt, à l’époque où Say écrit, l’offre de monnaie augmentait en même temps que les besoins du commerce (Hutt). C’est aussi le point de vue du free-banker David Glasner, dans un article de son blog uneasymoney, W.H.H on Say’s Law and the Keynesian Multiplier. Pour Glasner, Say juge la loi des débouchés à une époque de liberté monétaire où les banques émettent autant de monnaie que ce qui est demandé par leurs clients, ni plus ni moins, et répondent aux fluctuations saisonnières de la demande de monnaie.
Celui-ci va d’ailleurs plus loin, en disant que la Loi de Say et le multiplicateur keynésien sont les deux faces d’une même pièce, celle du processus cumulatif wicksellien, une face étant dédiée à la théorie de Hutt, et l’autre à la Z-théorie de Leijonhufvud.

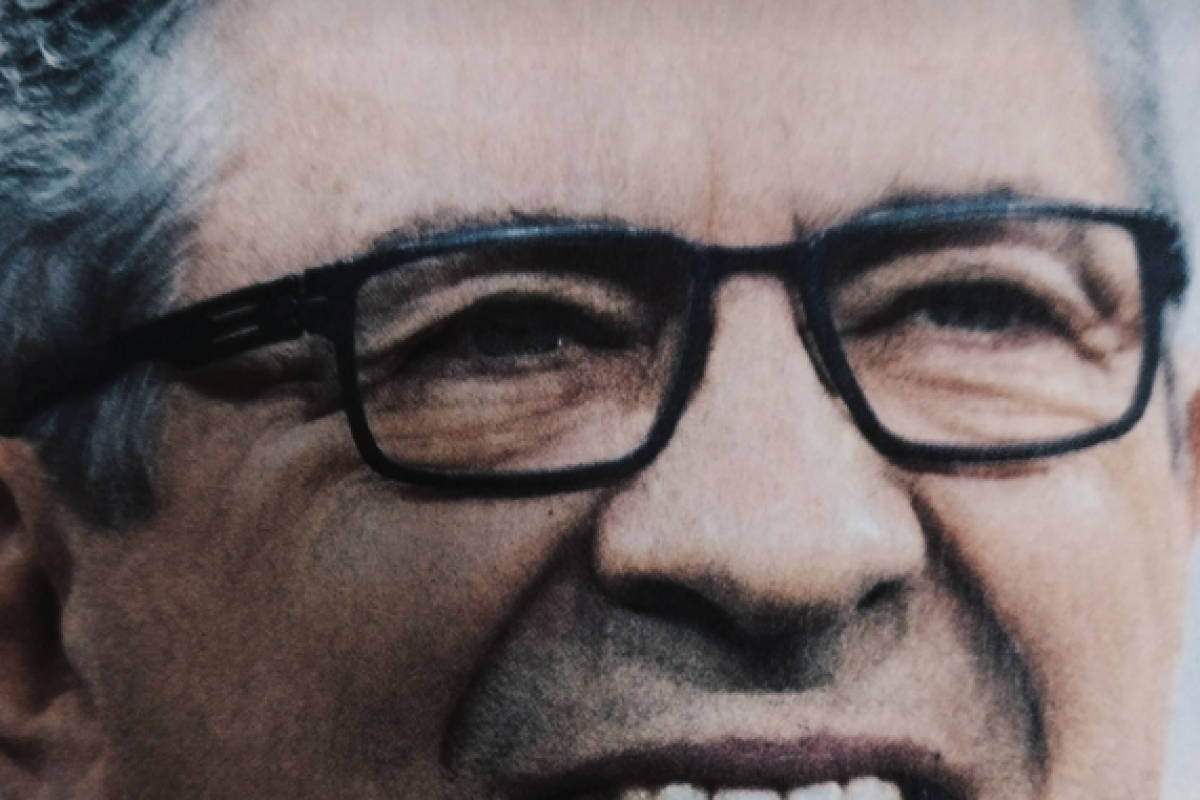

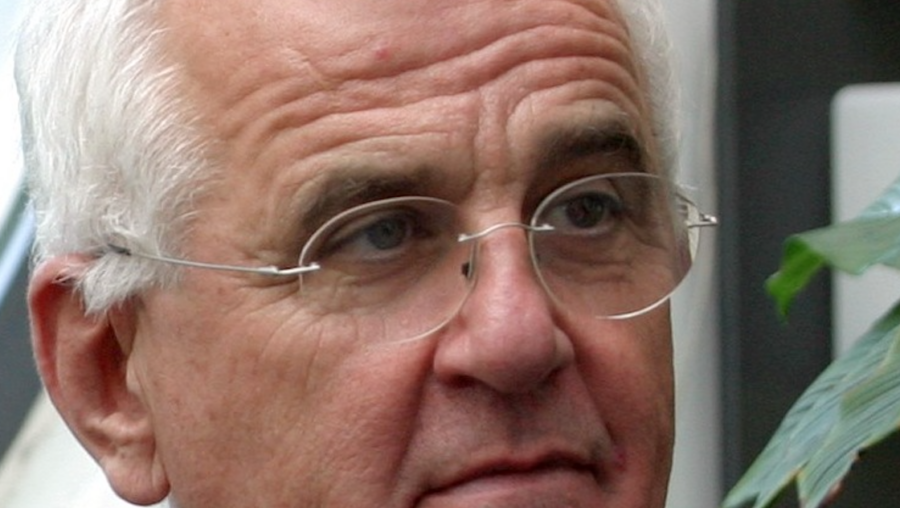

Macron avait donc raison de modifier le système des retraites des fonctionnaires