À la chute du Mur de Berlin et la dislocation de l’URSS, beaucoup ont cru à « La Fin de l’histoire », une thèse popularisée par Francis Fukuyama dans son essai éponyme et contredite par Samuel Huntington, son professeur à Harvard, dans Le Choc des civilisations. Pour autant, l’histoire est circulaire, et non linéaire, et la question qui occupe Anne Applebaum dans Démocraties en déclin est légitime : comment la démocratie peut-elle se retourner contre elle-même ?
Elle est bien placée pour en parler. Ayant étudié l’histoire à Yale, les relations internationales à la London School of Economics, cette journaliste américaine (Prix Pulitzer 2004 pour une histoire du Goulag, une histoire) a collaboré aux magazines britanniques The Economist et The Spectator et au Washington Post. Elle est à présent membre de la rédaction du magazine The Atlantic et senior fellow de l’Institut Agora de la John Hopkins University School of Advanced International Studies.
Mariée à un ancien ministre de la Défense et des Affaires étrangères de la Pologne, qui est désormais membre du Parlement européen (PPE), elle a été un témoin privilégié de l’ère Trump, du Brexit ainsi que des dérives politiques en Pologne et en Hongrie, des situations qui procèdent, selon elle, d’un même paradigme.
Les Anciens craignaient déjà que la démocratie n’aboutisse nécessairement à la tyrannie. Les fondateurs de la démocratie américaine s’en montrèrent conscients et installèrent un collège électoral (devenu entretemps un organe cérémonial sans réel pouvoir) afin que ses sages préviennent qu’un homme inapte, corrompu et plus doué pour l’intrigue que pour l’exercice de la plus haute fonction de l’État, ne puisse y accéder et n’en abuse.
Confusion et ordre
Il n’y a là rien de foncièrement de gauche ou de droite – et cela n’a d’ailleurs rien à voir avec une quelconque forme de conservatisme – fait observer Anne Applebaum, mais il faut bien constater que, confrontés à la confusion – à la complexité, dit-elle -, les gens s’en remettent volontiers à une forme d’autoritarisme pour rétablir l’ordre, rejetant dans un même mouvement le pluralisme des idées et le débat. Que le pouvoir autoritaire institué se réclame du marxisme ou du nationalisme, ce ne sont plus les idées qui priment, mais c’est une tournure d’esprit.
Aux despotes, il faut des comparses. Anne Applebaum renvoie à ce sujet au livre publié en 1927 par Julien Benda, La Trahison des clercs. Bien avant qu’Hannah Arendt ne s’y intéresse, Benda comprit qu’il n’importait pas de s’intéresser aux despotes, mais aux partisans de l’autoritarisme qu’il voyait se répandre en nuées partout en Europe, à gauche afin de promouvoir la lutte des classes à la façon du marxisme et à droite afin d’exacerber la passion nationale sous les atours du fascisme. Benda a accusé les intellectuels des deux bords, qu’il qualifia de clercs par référence ironique au clergé, de trahir leur tâche principale, la recherche de la vérité.
C’est à tort que l’on se souvient de Lénine pour les convictions marxistes qu’il affichait. L’idéologie n’était qu’un prétexte. Ce sont sa méthode d’accès au pouvoir et l’organisation politique qu’il mit en place pour s’y maintenir qui inspirent les régimes illibéraux à parti unique d’aujourd’hui et ces modalités s’accommodent d’une multitude d’idéologies. Le marxisme-léninisme renversa l’ordre aristocratique mais ne lui substitua pas un modèle social basé sur le talent et le mérite : les faveurs du régime n’allèrent pas aux plus doués ni aux plus assidus, mais à ceux qui se montraient les plus loyaux vis-à-vis du régime, une aubaine pour ceux que leur médiocrité empêchait de se distinguer.
Ressentiment et envie
Hannah Arendt a fustigé l’attirance exercée par les régimes autoritaires sur les gens éprouvant du ressentiment, de l’envie ou un sentiment d’injustice de la part du « système » à leur égard dans Les Origines du totalitarisme. La pire forme en est, écrit-elle, citée par Anne Applebaum, celle qui « remplace invariablement tous les vrais talents, quelles que soient leurs sympathies, par ces illuminés et ces imbéciles dont le manque d’intelligence et de créativité reste la meilleure garantie de leur loyauté ».
Qu’en découlent le népotisme, la captation de l’appareil de l’État, la corruption, peu importe, pourvu que disparaisse cette notion honnie de libre compétition, politique, économique ou autre, laquelle n’a, de fait, jamais profité aux moins performants !
Les autoritarismes d’aujourd’hui seraient-ils moins exigeants, comme le prétend Anne Applebaum, que ne le furent ceux que décrièrent Orwell, Koestler et d’autres, en ce que ceux d’hier pratiquaient le Grand Mensonge, le culte de la personnalité, l’éducation forcée, un contrôle total et la terreur tandis que leurs formes contemporaines se contenteraient d’un medium-size lie (un demi-mensonge, l’« hyperbole véridique ») comme expression d’une réalité alternative ?
L’attrait de ces demi-mensonges destinés à discréditer l’establishment réside dans leur simplicité. Ce sont, par exemple, la fable de Trump selon laquelle son prédécesseur n’était pas né aux États-Unis ; les contrevérités ayant émaillé la campagne du Brexit de Johnson et de ses narcisses à propos des réfugiés et des transferts financiers à l’UE ; la théorie conspirationniste à propos de la mort de l’ancien président polonais dans la tragédie aérienne de Smolensk. La récompense ? Le pouvoir !
L’auteur rapporte un entretien avec le politologue Stathis Kalyvas, professeur à Oxford, selon lequel « le moment libéral d’après 1989 était l’exception ». L’unité serait une anomalie ; la polarisation, la règle, de même que le scepticisme à l’égard de la démocratie libérale ; et l’attrait de l’autoritarisme serait éternel. L’équilibre est fragile.
Mais, le camp du Bien n’a-t-il pas été perverti par le recours démagogique de ses élites aux métaphores égalitaristes et écologistes, de manière à s’assurer le pouvoir, et trahi par ses clercs, le précipitant dans une forme d’autoritarisme en réaction duquel ont surgi les populismes ?
Meilleurs voeux de Nouvel An à toutes et à tous ! Si vous avez aimé lire cet article sur les démocraties en déclin, aidez Palingénésie à accroître sa notoriété en le transférant à vos amis et aux membres de votre famille et en les invitant à s’inscrire sur palingenesie.com dans l’espace prévu à cet effet (suivre le lien ou voir sur la page d’accueil et sous chaque article). Merci d’avance pour votre précieux soutien.




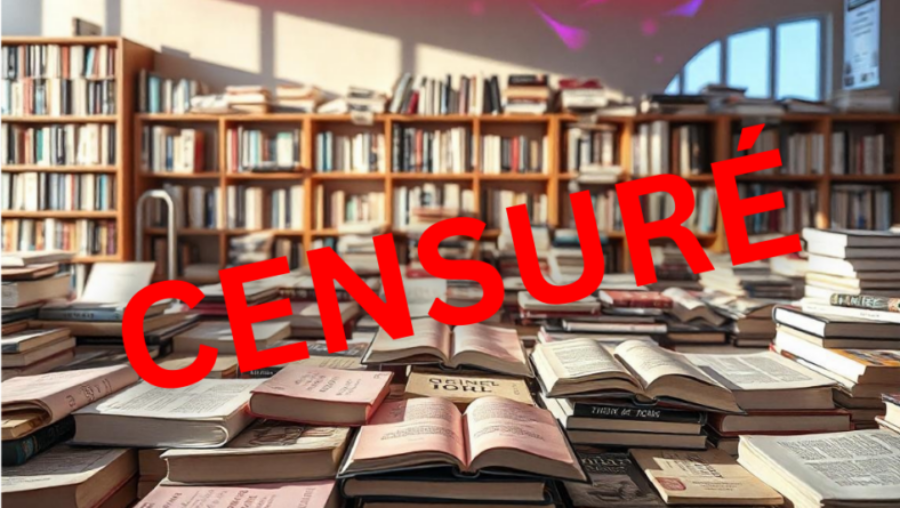
Oui, nos démocraties dérivent vers un totalitarisme soft dont l’UE qui est un poisson pilote en la matière, le pouvoir étant entre les mains de”sachants” non élus imbus de leur bon droit et méprisant pour les peuples !
En France, le saint simonien Macron et ses gentils affidés sont sur la même ligne.
Si les nations et leurs résidents ne réagissent pas, ils seront privés de leurs droits!
“la John Hopkins University”
Il s’agit de la Johns Hopkins University, avec un ‘s’.
https://www.jhu.edu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Johns_Hopkins