Par Philippe Silberzahn.
Les périodes de ruptures et d’incertitude comme celle que nous vivons actuellement amènent immanquablement à se poser la question de nos modèles mentaux, c’est-à- dire de nos croyances sur le monde, et au-delà, de notre identité : qui sommes-nous ? Comment nous définissons-nous ?
C’est vrai pour les individus et pour les organisations, mais c’est également vrai pour les sociétés et même les civilisations. C’est ce qu’illustre l’ouvrage From Plato to Nato (de Platon à l’OTAN), écrit par un historien danois, David Gress, à propos de l’Occident.
Modèle mental du monde
Comme nous le montrons avec Béatrice Rousset dans notre ouvrage Stratégie modèle mental, un modèle mental est une façon de se représenter le monde. Ce sont les histoires qu’on se raconte sur la façon dont il fonctionne.
Les modèles mentaux existent au niveau individuel, collectif et sociétal. C’est une notion fondamentale car c’est sur la base de modèles mentaux que l’on agit, mais nous avons rarement conscience de ceux-ci car nous les voyons non pas comme des modèles mais comme des vérités universelles, des évidences.
Ce qui compte avec un modèle mental n’est pas sa vérité : par définition tous les modèles sont faux, puisqu’ils ne sont que des approximations basées sur des croyances ; ce qui compte est leur efficacité. Que ce soit pour un individu, une organisation ou une société, être pris dans un mauvais modèle mental génère certains problèmes qu’un autre modèle éviterait.
La notion d’Occident : un modèle idéal contesté
La notion d’Occident peut sembler évidente, mais elle est pourtant récente.
Elle date du début du XXe siècle et provient de la re-création du mythe grec par les penseurs allemands à la fin du XIXe siècle. Le besoin de définir l’Occident nait de la catastrophe de la Première Guerre mondiale puis de la guerre froide.
Émerge alors ce que Gress nomme la Grande narration. Selon cette narration, l’Occident est l’héritier en droite ligne d’un idéal, celui du monde classique grec puis romain, avec en apogée la création de l’OTAN en 1949 consacrant la trinité du système occidental : liberté, raison et prospérité, d’où le titre de l’ouvrage de Gress De Platon à l’OTAN.
Tout ce qui n’entre pas dans le modèle, les tribus germaniques, la religion chrétienne, entre autres, est ignoré. Le modèle est idéal, et donc a-historique.
Mais Gress observe que la Grande narration pose problème.
Par son idéalisme, elle établit en effet une fausse dichotomie entre certains principes absolus, existant en dehors de l’Histoire, et une réalité bien éloignée de cette perfection, caractérisée par l’inégalité, les préjugés, l’exploitation et la guerre.
Cette dichotomie impose un fardeau de justification à l’Occident et à sa forme politique la plus importante, la démocratie, dont les défenseurs sont toujours obligés d’expliquer comment la réalité diffère de l’idéal et de voir cette différence comme un problème à résoudre par la volonté politique – la volonté de quelques leaders éclairés.
En bref, une définition de l’Occident comme un idéalisme platonicien place la barre tellement haut que la réalité ne peut sembler que décevante.
Ainsi défini, l’Occident invitait toutes les critiques qui n’ont pas manqué, qu’elles viennent des héritiers de Rousseau – l’homme est né libre et partout il est dans les fers – puis de Marx, que des conservateurs, notamment religieux, jusqu’aux écologistes qui émergent à partir des années 1960 et aux chantres des valeurs asiatiques comme le dirigeant de Singapour, Lee Kuan Yew.
Alors que les limites de la narration étaient évidentes, celle-ci a pu tenir jusqu’en 1989, date à laquelle l’effondrement de sa raison d’être, l’URSS, les a mises à nu. À partir de 1989 elle est à repenser entièrement.
Un modèle alternatif : l’Occident comme produit d’une synthèse historique
Face à la faillite de la Grande Narration, Gress propose donc un modèle mental alternatif selon lequel l’Occident est le produit d’une histoire, d’un long processus. C’est une réalité, pas une idée abstraite.
Définir l’Occident, c’est avant tout partir d’une réalité, de ce qui lui a donné naissance. L’identité occidentale en général ne doit ainsi pas être comprise principalement dans l’abstrait (la Liberté), mais comme un ensemble de pratiques et d’institutions qui ont évolué, non pas uniquement de la Grèce, mais de la synthèse difficile et conflictuelle des trois cultures classique, chrétienne et germanique qui a pris forme entre le Ve et le VIIIe huitième siècle de notre ère, c’est-à-dire entre la chute de l’Empire romain, l’émergence de la chrétienté et l’Empire carolingien.
Dans ce modèle, la liberté, par exemple, ne surgit pas ex nihilo au siècle des Lumières après la longue nuit du Moyen-Âge, mais est le produit contesté de siècles de conflits entre la liberté grecque (tout citoyen participe à la vie de la cité), la liberté romaine (aristocratique), la liberté chrétienne et celle de l’Église, la liberté héroïque des tribus germaniques auxquelles viendra s’ajouter la liberté individuelle qui émerge à la Renaissance mais qui était présente dès la Bible.
L’Occident est donc le fruit institutionnel et politique de divers conflits et interactions critiques : de la Grèce avec Rome, du christianisme et de l’idéal de liberté héroïque importé par les tribus germaniques et de l’Empire romain. Ces conflits n’ont pas eu lieu de façon abstraite ou entre penseurs.
Ils étaient pleins d’une passion destructrice et créatrice et, souvent, de cruauté liée à la lutte pour le pouvoir. À l’Occident comme un idéal, Gress propose de substituer l’Occident comme un processus de synthèse toujours renouvelé.
Comme cet exemple le montre, beaucoup de choses que nous considérons comme évidentes sont en fait des modèles mentaux. Ce sont des constructions humaines, elles n’ont rien de naturel.
On peut tirer deux enseignements de cet exemple.
Le premier est que l’histoire qu’on se raconte, c’est-à-dire le modèle mental que l’on construit sur une réalité, peut être stérile et contre-productif, ou au contraire être fertile et ouvrir des possibilités.
Le second enseignement est que défendre un idéal et viser à un modèle universel est un exercice dangereux car un modèle universel est toujours fragile, étant condamné à la perfection.
La leçon de l’Occident c’est précisément de n’avoir jamais été, en réalité, un idéal, mais d’être un objet en construction, produit d’une suite ininterrompue de conflits, conflits qui perdurent aujourd’hui, et qui ont fait qu’aucune partie à ces conflits n’a jamais totalement gagné – ni l’Église, ni les princes, ni les bourgeois ; le paradoxe de l’Occident est qu’une bataille millénaire pour le pouvoir et la domination a produit la liberté au milieu de la violence ; que le système proprement occidental, c’est un système bâti tant bien que mal pour gérer les conflits profonds à coups d’essais et d’erreurs, parfois tragiques.
Le résultat est que l’Occident possède une identité propre, résultant de cette longue histoire et de cette capacité à gérer ses conflits, mais qui repose sur une réalité multiple et tumultueuse qu’il n’y a aucune raison de ne pas assumer et encore moins de nier.
Comme nous le soulignons dans Stratégie modèle mental, aucun individu, aucune organisation ni aucune société ne peut en effet affronter les défis du changement sans une conscience de son identité et une acceptation de celle-ci, c’est-à-dire sans un examen approfondi des modèles mentaux sur lesquels cette identité est fondée.
À l’heure des grandes ruptures qui remettent en cause certains des modèles sociétaux les plus solidement établis depuis parfois fort longtemps, l’ouvrage de Gress montre que nous avons désormais intérêt à prendre l’habitude de conduire cet examen de façon systématique si nous ne voulons pas en rester prisonniers.
—




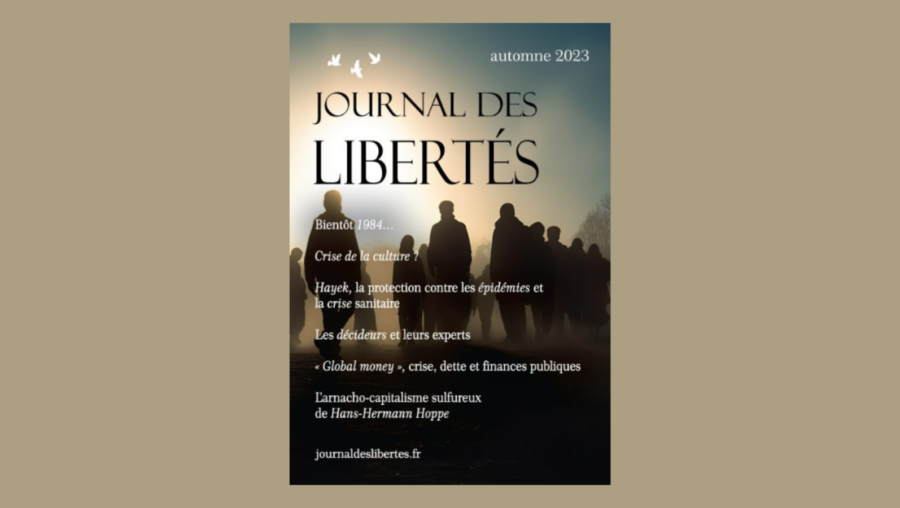
Excellent ! C’est ce que je pense sans jamais avoir réussi à l’exprimer aussi clairement. L’occident (l’europe à ses fondements) est un espace géographique et politique divisé qui a permis et permet toujours une concurrence entre modèles mentaux différents même si après 1989 ils forment ensemble un embryon de modèle mental continental. C’est là le secret de l’occident !
Réflexion roborative qui donne envie de lire cet historien danois. Cette notion de modèle renoue en fait avec les mythes (au sens antique).
Sur le même thème, mais intégrant toute l’histoire jusqu’à aujourd’hui en passant par le christianisme et les réformes papales du Moyen Âge, je signale le livre de Philippe Nemo : https://www.yvesmontenay.fr/2017/06/13/qu-est-ce-que-l-occident-de-philippe-nemo/