Même si tout le monde semble d’accord pour dire que la concurrence est un pilier du capitalisme et de la richesse des nations, cette notion subit des critiques nombreuses, perfides et injustes, jusqu’à traverser un chemin de croix qui rappelle les tourments épouvantables de la pauvre Justine dans le magnifique livre de Sade Les Infortunes de la vertu.
Elle subit trois types de remises en question de la part de théories et politiques qui prônent :
- Sa réduction, dans les cas où “trop de concurrence” est néfaste
- Sa suppression pure et simple et son remplacement par des dispositifs publics, parapublics ou subventionnés par la puissance publique, sous des motifs plus ou moins fallacieux (théorie des monopoles naturels)
- Son intensification quand elle n’est pas assez vivace
La troisième catégorie est particulièrement paradoxale. Il s’agit d’une partie des politiques de la concurrence.
Ces politiques ont deux aspects.
L’un est salutaire : limiter les interventions de la puissance publique qui fausseraient la concurrence (règles européennes sur la limitation des aides d’État, etc.) ; nous n’en parlons donc pas ici.
L’autre est dangereux pour la concurrence, alors même qu’il prétend la sauvegarder : ce sont les “politiques antitrust” (terme utilisé aux États-Unis, mais ces politiques existent aussi en France et en Europe). Elles sont composées de lois et de décisions administratives qui prétendent imposer un surcroît de concurrence au marché libre quand celui-ci aboutirait à la réduire : par le contrôle des concentrations et par les règles sur les monopoles, les abus de positions dominantes, contre les cartels, les ententes, le dumping, etc.
Elles connaissent aujourd’hui un nouvel intérêt, dans le contexte de l’émergence de géants du numérique (GAFA et BATX), qui ont acquis en un temps record une influence exceptionnelle sur l’économie.
Ces politiques antitrust aboutissent à renforcer les pouvoirs de la puissance publique et lui permettre de piloter l’activité économique au nom même du marché libre, ce qui semble contradictoire. Il est donc étonnant de voir que beaucoup de libéraux les soutiennent.
Mais comme l’écrivait Ayn Rand dans La Grève :
« Les contradictions n’existent pas. Chaque fois que vous pensez que vous êtes confrontés à une contradiction, vérifiez vos prémisses. Vous constaterez que l’une d’elles est fausse. »
Pour vérifier la prémisse des politiques antitrust, nous procéderons en deux temps :
- Justifications théoriques et modalités des politiques antitrust
- Critique des politiques antitrust
Justifications théoriques et modalités des politiques antitrust
Justifications théoriques
La théorie traditionnelle de la concurrence est la théorie néoclassique (théorie de la concurrence pure et parfaite), qui imagine un monde idéal sous certaines conditions : homogénéité des produits, libre entrée et libre sortie sur le marché, information parfaite, mobilité des facteurs de production, atomicité.
L’idée principale est que, dans ce monde théorique, aucun acteur n’a suffisamment d’influence pour influencer les prix.
La conséquence est un optimum social, une situation optimale au sens de Pareto : on ne peut améliorer la situation d’une personne sans dégrader celle d’une autre. Les profits tendent vers zéro et tout le monde est content.
Mais les économistes constatent que, dans la réalité, les conditions posées par cette théorie ne sont pas vérifiées. L’information n’est pas parfaite, il n’y a pas d’atomicité, il existe de prétendues imperfections du marché, etc. Donc l’optimum prévu par la théorie n’est pas atteint car certains acteurs acquièrent assez de puissance pour influencer les prix. C’est ainsi que surviennent des monopoles ou des oligopoles qui abusent de leur position pour imposer des prix trop élevés. Des cartels et autres ententes entre entreprises peuvent faire de même. Tous ces acteurs peuvent aussi faire du dumping pour éviter l’entrée sur le marché de nouveaux concurrents, etc.
Il faut donc que l’État et ses différentes entités nationales et supranationales interviennent en votant des lois, en créant des bureaucraties spécialisées et en prenant des décisions au cas par cas pour limiter ces effets pervers.
Modalités
Les politiques antitrust sont nées aux USA avec le Sherman Act en 1890. En Europe, le traité de Rome inclut des dispositions de cette nature, qui ont ensuite été renforcées par un gigantesque corpus juridique.
Elles se traduisent par deux types d’actions :
- Préventive : contrôler les concentrations en les soumettant à autorisation administrative (pouvant aboutir à un refus ou à acceptation conditionnée à des changements de périmètres : vendre certaines filiales, etc.)
- Répressive : infliger des amendes ou imposer le démantèlement des entreprises ne respectant par les lois antitrust.
L’exemple le plus connu est la Standard Oil, démantelée en 1911 après avoir été fondée en 1870 par Rockfeller. Dans les années 1990 et 2000, Microsoft a été harcelé en permanence par les autorités européennes, et Google a récemment écopé d’une grosse amende infligée par ces mêmes autorités.
Critique des politiques antitrust
La critique colbertiste et souverainiste des politiques antitrust plaide généralement pour faciliter l’émergence de “champions” nationaux ou européens. On examine ici la critique libérale, plus complète et plus pertinente. On trouvera d’excellentes synthèses de cette critique dans les ouvrages de Dominick Armentano et de Pascal Salin.
Les politiques antitrust reposent sur une erreur de méthodologie
Poser des conditions irréalistes dans une théorie décrivant un monde idéal, puis se fonder sur le fait que ces conditions ne sont pas remplies dans la réalité, pour ainsi justifier des interventions publiques pour forcer le réel à correspondre à cette situation, est profondément absurde.
La théorie néoclassique de la concurrence pure et parfaite est cohérente dans sa logique interne, mais elle n’a aucun intérêt pratique, car elle ne permet pas de comprendre le monde tel qu’il est. Elle n’est pas une stylisation utile du réel, ce que devrait être toute bonne théorie. On pourrait tout aussi bien s’amuser à prouver mathématiquement que le monde serait optimal si les jambes des humains mesuraient 4 mètres, constater que ce n’est pas le cas, et s’en prévaloir pour permettre à l’État de financer des échasses et sanctionner ceux qui refuseraient d’en porter.
La théorie de la concurrence pure et parfaite est une vision mécaniste et inhumaine du monde : y sont absents le temps, l’incertitude, le risque, la subjectivité, le rôle de l’entrepreneur (qui est considéré dans cette théorie comme un simple salarié comme un autre, puisque les profits tendent vers zéro). On dirait une vision désincarnée, planiste, soviétique. Et de fait, c’est une théorie qui aboutit à des pouvoirs de pilotage et de planisme étatique.
Elles aboutissent à des concepts indéfinissables
La segmentation d’un marché étudié pour l’application des lois antitrust est nécessairement arbitraire : en fonction de la manière dont on déterminera les périmètres du marché, on sera toujours certain d’arriver à une situation de monopole (ex : si j’ouvre une pizzeria dans ma rue, faut-il considérer le marché des pizzerias de ma rue, des restaurants de ma rue ? des magasins de ma rue ? des pizzerias de Paris ? des restaurants de Paris ? etc.).
À l’origine, le concept de monopole était très précis, puis il a été utilisé de manière de plus en plus vague. Autrefois, c’était un privilège exclusif attribué par la couronne royale britannique pour la production d’un bien ou service donné. Seule cette définition est satisfaisante d’un point de vue scientifique : les seuls monopoles qu’on puisse considérer de manière rigoureuse sont les monopoles publics. Et tous les travers attribués aux monopoles en général leur sont bien attribuables (tendance à augmenter les prix et baisser la qualité).
La notion de prix de monopole (prix imposé par un “monopole”, qui diffère du prix théorique qui prévaudrait dans une situation de concurrence pure et parfaite, et qui permet donc au monopole d’accaparer le “surplus du consommateur”) est, de la même manière, une notion totalement floue et impossible à définir concrètement. C’est une des contributions du magistral Man, Economy and State de Rothbard (chapitre 10).
Les décisions d’allocation de production et de prix des “monopoles”, oligopoles, cartels et ententes ne peuvent être distinguées conceptuellement des décisions internes de toute entreprise entre ses différents produits et leurs prix respectifs. (cf. Rothbard). Les lois antitrust sont fondées sur une vision anti-scientifique du monde.
S’agissant des cartels, ce sont des structures intrinsèquement instables, qui ne se maintiennent jamais dans la durée car un ou plusieurs participants finissent toujours par rompre secrètement l’accord (en revanche, les cartels publics comme l’OPEP se maintiennent plus longtemps, avec des conséquences désastreuses pour les économies).
Les politiques antitrust aboutissent à des situations absurdes
Elles nuisent au consommateur en l’empêchant de profiter de l’innovation, des baisses de prix et des économies d’échelle que seules de grosses structures peuvent produire.
Elles nuisent aux entrepreneurs et aux chefs d’entreprise en créant une forme d’arbitraire totalement en décalage avec l’État de droit : l’administration se voit confier des pouvoirs de sanction extrêmement rigoureux, pour des infractions qui ne peuvent pas être définies à l’avance de manière précise. Ainsi, l’entrepreneur ne sait jamais s’il est en train de violer la loi ou non. Il est présumé coupable. Si ses prix sont trop élevés, il risque de commettre un “abus de position dominante” ; s’ils sont trop bas, on dira qu’il fait du dumping ; s’ils sont dans la moyenne de la concurrence, on pourra l’accuser d’entente.
Ces politiques conduisent à une extension sans limites de la sphère publique : une fois qu’elles ont permis d’empêcher l’émergence d’acteurs assez gros pour financer de la recherche fondamentale, de la science, de la philanthropie, de la création artistique, de la sauvegarde du patrimoine, de l’exploration spatiale, etc. l’État a beau jeu d’expliquer que l’humanité est trop égoïste et que le marché est incapable de financer ces activités, et qu’il faut donc des lois, des impôts, des ministres et des bureaucraties pour le faire…
Le politique, partout, tout le temps
Les politiques antitrust sont souvent la résultante du clientélisme politique :
Les premières décisions antitrust, au début du XXe siècle, ont été prises sous la pression de groupes de petites entreprises paniquées par l’émergence de gros acteurs à la suite de la révolution industrielle, alors-même que ces gros acteurs étaient avantageux pour les consommateurs, comme l’ont prouvé de manière empirique des études bien des années (cf. Thomas Di Lorenzo). Cela rejoint les analyses de Hayek sur la complexité des sociétés modernes et sur la présomption fatale des autorités publiques qui se croient omniscientes alors qu’elles n’ont jamais les données nécessaires pour prendre des décisions de pilotage économique pertinentes.
Ce n’est qu’après, dans les années 1930, qu’un déluge de pseudo justifications théoriques est venu soutenir les politiques antitrust, dans le contexte d’une phobie générale anti big business, après la crise de 1929, avant d’être totalement réfutées par l’école autrichienne dans les années 1940-1960.
Aujourd’hui aussi, certains acteurs économiques qui ont été incapables de s’adapter à la révolution numérique (presse, notamment), voient dans les politiques antitrust une aubaine inespérée pour freiner l’essor des géants du numérique.
Il faut réhabiliter une théorie plus réaliste de la concurrence et de l’action publique
La réalité, c’est que la recherche d’une position monopolistique est l’objectif naturel, évident, légitime et systématique de tout entrepreneur. Aucun entrepreneur ne consentirait tous les sacrifices nécessaires à son aventure entrepreneuriale s’il n’espérait tirer des profits de la position avantageuse qu’il aura acquise par ses efforts. Le profit est la rémunération du risque qu’il a pris (et le profit est un moteur de toute action humaine, comme l’a montré Mises dans L’Action humaine : toute action est la recherche d’une amélioration subjective de sa situation personnelle par la définition d’objectifs et la mise en oeuvre de moyens choisis, dans un contexte d’incertitude sur l’avenir).
En revanche, sur le long terme, aucune entreprise ne peut se maintenir durablement en abusant outrancièrement de ses consommateurs (en leur mentant, en les volant, en imposant des prix insoutenables, en diminuant trop la qualité, etc.) : elles peuvent faire l’objet d’actions judiciaires fondées sur le droit des contrats, elles peuvent aussi être boycottées par le public, et elles peuvent être concurrencées par de nouveaux concurrents, attirés par les perspectives de profit offertes par ces situations excessives. Mais nul ne prétend que ces ajustements puissent se faire de manière instantanée (contrairement aux critiques caricaturales du libéralisme).
Par ailleurs, quand ils traînent vraiment ou qu’ils ne se produisent jamais, c’est très souvent à cause d’interventions publiques indirectes qui empêchent la concurrence de se développer : fiscalité générale confiscatoire et droit du travail délirant qui écrasent les petites entreprises, capitalisme de connivence et politiques monétaires qui avantagent les grandes structures, existence de brevets (monopoles artificiels créés par la puissance publique, qui ont plus d’inconvénients que d’avantages pour la collectivités ; (cf. analyses de Rothbard, et également Stephan Kinsella, sur la propriété intellectuelle), etc.
Autre élément à considérer : dans la foulée des travaux précurseurs de Ronald Coase sur la firme, on sait qu’il existe une limite naturelle au-delà de laquelle une entreprise n’a pas d’intérêt économique rationnel à croître car les coûts de coordination internes deviennent plus élevés que les économiques de transactions justifiant l’existence-même de la firme. Si, malgré tout, la firme croît au-delà de cette limite, c’est en général parce qu’elle bénéficie d’avantages directs ou indirects fournis par la puissance publique, qui lui permettent d’outrepasser cet inconvénient et d’absorber ces coûts additionnels.
La seule définition pertinente de la notion de concurrence est donc la suivante : situation du marché caractérisée par une absence de barrières légales à l’entrée (la notion de barrière à l’entrée n’a aucun sens si on ne la restreint pas au caractère légale — comme pour le monopole).
Les politiques antitrust ne sont pas davantage valides face aux géants du numérique
Comme à chaque révolution technologique, les pro-antitrust commencent leur argumentation par : “cette fois-ci c’est différent”. Pour eux, la technologie est tellement nouvelle que le marché libre va nécessairement s’effondrer que seul l’État peut nous sauver.
Pourtant, les critiques des politiques antitrust sont parfaitement valables dans le cas des GAFA et BATX.
Ces géants rendent des service inouïs à l’humanité (diffusion générale de l’information, gains d’efficience à tous les niveaux de l’économie, gains de pouvoir d’achat, disruption de vieux marchés sclérosés, effort de recherche massifs totalement hors de portée de beaucoup d’État, philanthropie, etc.) : sont-ils évalués honnêtement par les critiques des GAFA ?
Si on les accuse de tous les maux, c’est parfois pour dissimuler les méfaits de la puissance publique (surveillance de masse par les administrations, y compris dans des pays supposés libres).
S’ils abusent vraiment du consommateur, des concurrents finissent par les menacer. Si ce n’est pas le cas, c’est parce que la puissance publique empêche cet ajustement naturel de multiples manières (cf. supra).
Si les GAFA rachètent à prix d’or leurs concurrents potentiels, ce n’est pas forcément un mal ; c’est une manière de faire de la croissance externe, et aussi de stimuler l’innovation, qui finit par bénéficier au consommateur.
Postuler que ces rachats finiront par tuer définitivement toute concurrence est parfaitement arbitraire : c’est supposer a priori qu’aucune technologie ne pourra émerger en leur échappant. Cette croyance est réfutée dans les faits par l’apparition et la diffusion des technologies particulièrement fertiles et prometteuses issues de Bitcoin (cryptomonnaies, blockchain, decentralized autonomous organizations, smart contracts, etc.), en cours de progrès fulgurant et de passage à l’échelle (lightning network), qu’aucun bureaucrate n’avait prévu, et qui permettent d’imaginer de nouveaux modèles économiques de valorisation des données personnelles remettant en question le cœur du business des GAFA.
Les projets démiurgiques de transformation de l’humanité de certains acteurs privés grâce à l’intelligence artificielle dépassent largement le cadre de l’économie politique pour entrer dans la science-fiction. On peut simplement se poser cette question : si ces projets doivent se développer, faut-il qu’ils soient monopolisés par des États, c’est-à-dire par les structures qui ont ravagé le XXe siècle par les guerres mondiales, les génocides et le goulag ? (l’argument colbertiste aboutit par ailleurs à empêcher tout démantèlement des GAFA pour ne pas laisser le monopole de l’intelligence artificielle aux Chinois).

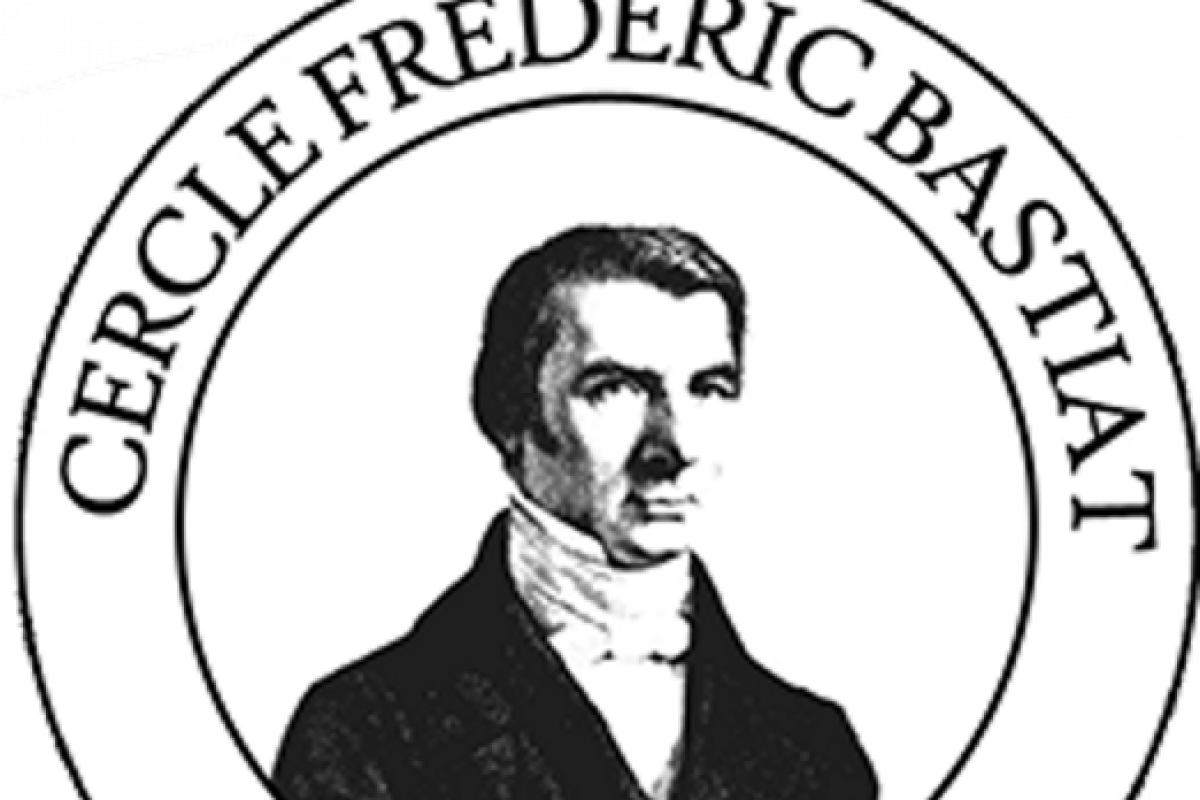



Une conférence qui m’a fait changer d’avis sur le sujet à propos des GAFA.
Les libéraux devraient toujours garder à l’esprit cette citation d’Ayn Rand.
Faire comme pour les “babyBells” ?
Tout bonnement EXCELLENT, 38′ de pur plaisir.
Article comme on les aime. Merci.