Par Johan Rivalland.
Après avoir examiné récemment la note de Simone Weil sur la suppression générale des partis politiques, commençons à présent par nous demander si, avant d’en venir là, la politique a encore un sens. C’est la question que pose Hannah Arendt à travers les quelques fragments d’une « Introduction à la politique » qu’elle a laissés à sa mort et qui constituent un projet inachevé.
Politique et liberté
Pour commencer, Hannah Arendt rappelle que la méfiance à l’égard du politique est très ancienne. Elle remonte au moins à Platon, et sans doute même avant.
La polis concerne l’organisation de la vie commune des hommes, même si les fins poursuivies peuvent varier d’une époque à une autre ou d’un endroit à un autre. Le monopole de la violence, suivant l’idée émise par Madison, est ainsi accordé à l’État, qui a pour rôle essentiel d’empêcher la guerre de tous contre tous. Tout en devant se contrôler lui-même (lire, à ce sujet, l’intéressant article de Jean-Philippe Feldman paru dans le volume n°1 du Journal des Libertés paru cet été au sujet de Benjamin Constant et des Constitutions).
Selon l’idée de Madison, « si les hommes étaient des anges, il n’y aurait besoin d’aucun gouvernement ».
La conception d’Aristote, que nous avons gardée, provient selon Hannah Arendt, d’un malentendu. En effet, dans la société esclavagiste de l’Antiquité grecque, c’est la libération qui permettait la polis, et non la liberté qui était une fin.
Au sens grec, le politique doit donc être compris comme centré sur la liberté, la liberté étant elle-même entendue de façon négative comme le fait de ne pas gouverner ni être gouverné, et, positivement, comme un espace qui doit être construit par la pluralité et dans lequel chacun se meut parmi ses pairs.
Ainsi, c’est à une réflexion autour de l’évolution de l’idée de liberté et de celle de politique que nous convie Hannah Arendt, mettant en lumière ce qui s’inscrit dans une continuité et ce qui, à l’inverse, rend différentes les conceptions de fond qui mènent à l’organisation de nos sociétés.
Violence et politique
Ce qui a bien changé, ce sont bien plutôt les domaines en vue desquels la politique est apparue comme nécessaire. La sphère religieuse retomba dans l’espace privé tandis que la sphère de la vie et de ses nécessités – que l’Antiquité tout comme le Moyen Âge avaient considéré comme la sphère privée par excellence – recevait une nouvelle dignité et pénétrait dans l’espace public sous la forme de la société.
Dès lors, ces changements de paradigme amènent la philosophe allemande à étudier le rôle devenu prédominant de la violence, passée de la sphère privée à celle du politique et dérivant sur les grandes guerres du XXe siècle, la montée en puissance de la bombe atomique en constituant l’aboutissement ultime.
Une forme de monopole de la violence, induite par ce déplacement de la sphère privée à la sphère publique qui induit une modification du sens de la politique, dont on peut se demander si elle a encore un sens.
S’ensuit une critique et une mise en garde contre le caractère destructeur des guerres et des révolutions. En particulier, Hannah Arendt présente l’idéal socialiste d’un stade final de l’humanité dépourvu d’État, c’est-à-dire débarrassé de la politique chez Marx, comme absolument effrayant. Or, ce sont ces guerres et révolutions qui ont jalonné le XXe siècle et en ont constitué les expériences politiques fondamentales. Et c’est cette identification de l’action politique à l’action violente qui induit qu’elle est désormais dépourvue de sens.
En effet, les objectifs de conquête, de domination, ou de destruction dans le cas des révolutions, ne correspondent plus aux fins qui étaient celles de la politique jusque-là.
« Nous devons donc distinguer en politique entre le but, la fin et le sens », écrit Hannah Arendt. Ce qui débouchera sur une série de questions complexes guidant la suite de son raisonnement. Questions qui, dit-elle, n’appellent pas de réponses, mais mettent en cause notre manière d’aborder et concevoir la politique, en raison de la confusion qui règne dans la distinction que l’on en fait. Témoin cette idée paradoxale qu’avait Robespierre de vouloir contraindre les hommes à la liberté, affirmant qu’au « despotisme des rois s’oppose la tyrannie de la liberté ». Et qui débouche sur une inversion de l’idée de Clausewitz selon laquelle la guerre n’est rien d’autre que la poursuite de la politique par d’autres moyens.
Hannah Arendt, La politique a-t-elle encore un sens ?, Carnets de l’Herne, avril 2007, 102 pages.

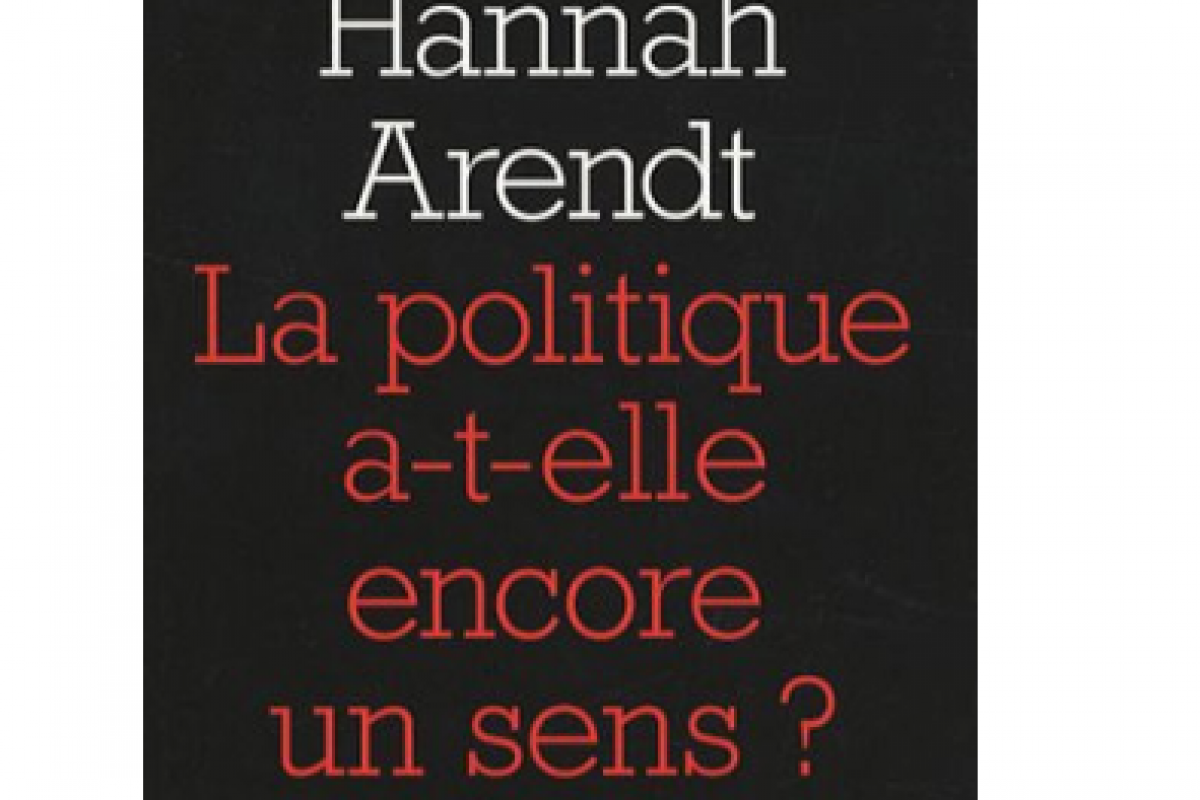
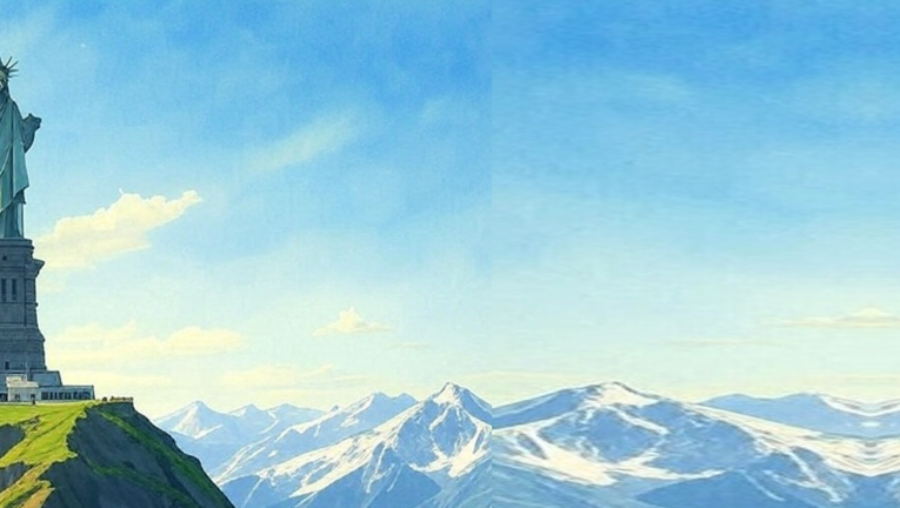


Y a-t-il un test de QI pour cette engeance ? et tout à l’avenant . . .