Par Alain Mathieu.
Les exemples de pays développés qui ont réussi des réformes sont nombreux. Au moins neuf pays européens en font partie. Bien qu’aucun pays ne ressemble à un autre, on peut en tirer des leçons pour la France, en particulier si l’on s’intéresse aux pays dont la réussite économique est supérieure à la nôtre.
D’après la Banque mondiale, qui publie un classement des pays suivant leur compétitivité, cinq pays européens sont en 2017 parmi les sept premiers pays du monde : la Suisse (N°1), puis les Pays-Bas, l’Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni. La France est 21ème dans ce classement.
La Suisse n’avait pas besoin de réformes, ayant mis en place au XIXe siècle le référendum d’initiative populaire, qui est un frein aux dépenses inutiles des élus, et l’ayant complété il y a quelques années par le « frein à l’endettement » qui oblige la fédération, les cantons et les communes à revenir à l’équilibre quand ils sont en déficit.
D’autres pays avaient besoin de réformes pour redevenir compétitifs et les ont réalisées. Plusieurs institutions en ont tiré les leçons : l’OCDE a analysé « Les facteurs déterminants de la réussite des réformes structurelles » ; France Stratégie (l’ex- commissariat au Plan), la « Réduction des dépenses publiques : les leçons de l’expérience » ; l’Inspection générale des Finances, « Les stratégies de réformes à l’étranger ». Ces trois études sont disponibles sur internet.
La réussite des réformes selon l’OCDE
« Les facteurs déterminants de la réussite des réformes structurelles (retraites, droit du travail, dérèglementation du commerce) ». L’OCDE a étudié vingt grandes réformes dans dix pays. Cinq de ces réformes ont échoué (dont le CIP – « SMIC-jeunes » – de Balladur en 1994), cinq n’ont été que partiellement mises en œuvre, et dix sont considérées comme réussies (dont celle des retraites de Fillon en 2003).
La principale cause des échecs ou demi-échecs, notamment le CIP de Balladur, les retraites en Italie et aux États-Unis, le commerce de détail en Allemagne, la dérèglementation des loyers aux Pays-Bas et en Espagne, est l’absence de cohésion et de détermination du gouvernement. Par exemple le gouvernement Balladur de 1994 était divisé entre un ministre du Travail chiraquien et un ministre des Finances balladurien.
Le deuxième facteur déterminant pour la réussite d’une réforme est l’existence d’un mandat électoral. Il arrive que réussisse une réforme « furtive », comme celle des retraites du secteur privé mise en place par Balladur dans un décret d’août 1993. Deux des dix réformes réussies étudiées par l’OCDE sont dans ce cas. Ce sont des réformes relativement mineures concernant la règlementation du commerce en Espagne et en Allemagne. Les autres réformes réussies avaient été annoncées lors de campagnes électorales.
Le troisième facteur est une communication efficace : les objectifs doivent être clairs, la réforme doit être précédée par une analyse faite par un organisme indépendant, la gestation doit être longue, particulièrement pour les réformes sur les retraites, qui n’ont d’effet positif qu’à long terme.
Enfin les réformes doivent être mûres dans l’opinion. Des échecs antérieurs peuvent causer cette maturation, ce qui laisse un certain espoir aux Français pour la prochaine réforme des retraites, pour la sélection à l’entrée des universités, et peut-être même pour le SMIC- jeunes.
La réduction des dépenses selon France Stratégie
« Réduction des dépenses publiques : les leçons de l’expérience ».
Entre 1990 et 2007, 17 pays ont réduit leurs dépenses publiques. La réduction moyenne a été de 7 % du PIB en cinq ans, six pays ayant même baissé de 10 % en cinq ans : Canada, Pays-Bas, Finlande, Irlande, Suède, Slovaquie.
Les principales réductions ont porté sur les rémunérations publiques, les prestations sociales, le logement.
Pour les réussir, France Stratégie fait les recommandations suivantes :
- Associer aux décisions des fonctionnaires et des consultants. L’avis des citoyens peut aussi être sollicité (par exemple les 100 000 propositions d’économies recueillies via Internet par le chancelier de l’échiquier anglais en 2010).
- Ne pas fixer a priori aux administrations des objectifs chiffrés, mais attendre leurs propositions ; puis tout décider et les annoncer ensemble.
- Agir vite.
- Éviter de faire en même temps d’autres réformes.
- Éviter de sanctuariser certains domaines. Les ministres et élus locaux acceptent plus facilement des baisses si tous leurs collègues sont concernés. Cependant certaines sanctuarisations sont parfois annoncées : au Royaume-Uni la santé publique et l’aide extérieure ; en Finlande la recherche ; au Canada la justice. Mais il faut éviter qu’il y en ait beaucoup.
Les stratégies de réforme à l’étranger pour Inspection générale des Finances
« Les stratégies de réformes à l’étranger » : 13 pays ont été étudiés, notamment avec l’assistance des ambassades de France dans ces pays.
L’utilisation de la révolution numérique
L’automatisation des tâches administratives permet des réductions d’effectifs ; la qualité des services peut être améliorée (délais ; déplacements supprimés grâce à Internet) ; l’automatisation des tâches des administrations permet une plus grande délégation au secteur privé (bureaux de tabac, commerces, banques, notaires, etc) ; la plus grande transparence permet un contrôle plus précis par les citoyens, la comparaison des performances entre administrations locales (par exemple une comparaison du coût des différentes missions encore plus détaillée que celle des Argus des communes, départements et régions publiés par Contribuables associés) et donc une forme de concurrence stimulante entre elles.
L’Italie a été dynamique dans ce domaine numérique : les rémunérations des cadres publics et des consultants y sont publiées, comme les CV des dirigeants, les adresses email et numéros de téléphone de tous les agents, les taux d’absentéisme par administration, les indices de satisfaction des administrés. Les relevés de notes scolaires et les certificats de maladie sont communiqués par Internet. 60 000 reti amici (points de vente privés) y remplacent des administrations. L’Italie ne compte que 3,5 millions de fonctionnaires.
Aux Pays-Bas il n’y a qu’un guichet électronique pour les entreprises. Les achats publics sont faits avec des catalogues et appels d’offre électroniques. Les plaintes des particuliers sont faites en ligne. Des dépenses standard par nature (écolier, santé, social, etc) permettent de comparer les performances des collectivités locales. Les Pays-Bas ne comptent que 850 000 fonctionnaires (soit l’équivalent de 3,3 millions pour la France).
Au Royaume-Uni toutes les dépenses publiques de plus de 10 000 livres et les rémunérations des cadres sont publiées.
Au Danemark, une seule déclaration sociale. La comparaison des coûts entre régions et entre communes est pratiquée.
La décentralisation et la clarification des compétences des collectivités locales
Aux Pays-Bas, les communes ont une compétence exclusive sur les aides sociales, le logement, la sécurité, l’éducation, les transports, la santé, l’environnement, la culture. Les services de l’État y sont répartis dans des agences (dont les comptes sont fiables car certifiés, et qui, comme les entreprises, utilisent une comptabilité analytique de leurs dépenses). Ils ont un opérateur unique de paie (hors fonctionnaires de Défense).
Au Danemark, tout le social est de la responsabilité des communes, la santé aux régions. Les comtés ont été supprimés.
L’alignement du public et du privé
Dans les domaines des retraites, le droit du travail, les relations avec les administrés.
La baisse du nombre de fonctionnaires.
Pays-Bas : – 20 % ; Finlande : – 15 % ; Royaume-Uni : – 10 % ; Canada : – 19 % au niveau fédéral. Les secteurs les plus affectés : conception, fonctions supports, contrôle, logement, affaires étrangères, social.
Aux Pays-Bas des objectifs de réduction chiffrés sont donnés pour quatre ans à chaque ministère. Les montants des crédits de formation affectés aux différentes administrations y dépendent de la mobilité de leurs agents.
Dans la plupart des pays, il y a peu de personnel à statut : en Suède, 10 % des effectifs ; en Italie, 15 % ; au Royaume-Uni, 9 %.
La baisse des dépenses sociales
Aux Pays-Bas la franchise annuelle des soins de santé a été augmentée, comme le ticket modérateur des visites médicales ; les loyers des HLM ont été augmentés ; les indemnités de chômage et la durée d’indemnisation ont été réduites ; des bourses pour étudiants ont été remplacées par des prêts ; l’âge de départ à la retraite sera porté à 66 ans en 2020.
De même en Allemagne l’âge de départ à la retraite, les remboursements d’assurance- santé, les indemnités de chômage ont été changés.
Au Danemark les allocations d’État aux chômeurs varient suivant l’efficacité des communes pour le replacement des chômeurs.
Quelques leçons supplémentaires pour la France
Quand on compare les finances publiques de la France à celles de son principal concurrent, l’Allemagne, on constate que les charges fiscales et sociales sur les entreprises françaises sont supérieures de 8 à 9 % du PIB à celles des entreprises allemandes (41 % des salaires pour les cotisations patronales, au lieu de 20 % en Allemagne ; de nombreux impôts sur les entreprises n’existent pas en Allemagne – taxe professionnelle, apprentissage, salaires- ou sont à un taux plus faible – taxe foncière, impôt sur les bénéfices des sociétés).
Cet excédent de charges sur les entreprises est dû à des dépenses publiques françaises plus élevées :
+ 5,6 % du PIB pour les rémunérations publiques ; + 6,5 % pour les prestations sociales (retraites 3 %, chômage 1,3%) ; + 1,5 % pour le logement ; + 0,7 % pour la culture.
Pour s’approcher de la « convergence » avec l’Allemagne prônée par nos dirigeants politiques, il faudrait réduire fortement le nombre de nos fonctionnaires : nous en avons 3 millions de plus que l’Allemagne, l’Italie, les Pays-Bas, à population comparable. Un gel des embauches publiques, qui sont de 440 000 par an, serait nécessaire. Ce fut la première décision de Margaret Thatcher après son élection comme Premier ministre. L’Italie l’a pratiqué pendant trois ans, avec quelques dérogations autorisées par le ministre de la Fonction publique, décisionnaire (ce qui freinait les envies d’embauches de ses collègues).
La baisse du nombre de fonctionnaires favorise les créations d’emplois dans le secteur privé, comme l’a constaté le Royaume-Uni entre 2010 et 2015 : 500 000 fonctionnaires de moins et 2 000 000 emplois privés de plus. Pour diminuer les dépenses sociales, le gouvernement Cameron a instauré un plafond d’allocations par ménage (500 livres par semaine) et mis les allocations familiales sous condition de ressources.
Comme le propose Contribuables associés, on pourrait réduire les dépenses publiques, notamment pour le logement, la politique de la ville, les aides à l’emploi, l’écologie, le financement des syndicats. Un meilleur contrôle des dépenses pourrait être assuré si un véritable référendum d’initiative populaire était possible et si la Cour des comptes dépendait du Parlement comme au Royaume-Uni. La vente des HLM, comme au Royaume-Uni ou en Allemagne, procurerait des recettes.
Des réformes importantes ne seront possibles en France que si nos syndicats perdent leurs moyens de les bloquer, et donc si notre législation sur le droit de grève est alignée sur celle de nos voisins : vote des grèves à bulletins secrets ; interdiction des grèves de solidarité ou politiques ; un véritable service minimum pour les services publics ; la suppression de l’irresponsabilité des syndicats en cas de grève illégale.
« Notre pays est mûr pour de grandes réformes » dit Alain Juppé. C’est en effet ce que disent aux sondeurs 69 % des Français. Il ajoute : « Nous avons tout essayé sauf ce qui marche partout ailleurs ».
Effectivement, un vote populaire sur un programme clair, un gouvernement uni et déterminé, l’absence de budgets « sanctuarisés », la rapidité de la mise en œuvre et l’absence de retour en arrière, une réglementation précise du droit de grève sont des conditions nécessaires du succès.
Dans la course entre les nations, si la France pratiquait ce qui a marché à l’étranger elle ne serait plus le « cheval avec un jockey obèse » (Xavier Fontanet, ancien président d’Essilor).
—


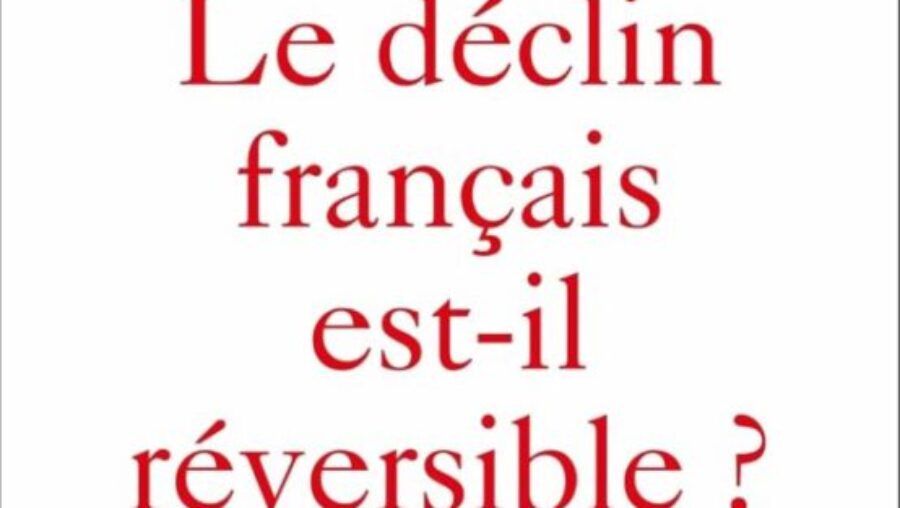


Etude intéressante sur les réformes structurelles: https://core.ac.uk/download/pdf/6389452.pdf
Cette étude rappelle l’importance de coordonner les réformes structurelles. D’abord, déréglementer le marché des biens puis déréglementer le marché du travail.
Or, tout le monde semble oublier cela. Personne ne fait cela