Par Anthony Hussenot.
Un article de The Conversation

Le travail collaboratif tel que celui pratiqué par de nombreux coworkers, se caractérise par des modes de collaboration non hiérarchiques et ouverts. Cette évolution du travail conduit à comprendre l’organisation comme un processus continu de construction des conditions des activités en cours.
Découpler l’organisation et l’entreprise
Une idée communément admise consiste à définir l’entreprise, l’administration ou l’association (etc.) comme une organisation. C’est ainsi que l’on dit que l’on naît, que l’on grandit et que l’on travaille dans des organisations. La maternité, l’école, l’entreprise en seraient les principaux exemples.
Cette définition très commode a permis à des générations de managers de circonscrire l’organisation de leurs activités aux murs de l’entreprise. Cependant, à l’heure du travail collaboratif que l’on peut observer dans les tiers lieux et dans certaines entreprises dites libérées, la confusion entre organisation et entreprise ne semble plus pertinente. Pour comprendre les modes de travail et de collaboration actuels, il nous faut découpler organisation et entreprise.
Le cas des coworkers est un exemple intéressant de ce découplage. On estime selon une étude réalisée par La Fonderie – île de France et portant sur la fréquentation en 2014, que 48 % des coworkers travaillent en free-lance. Leur activité consiste donc à travailler sur des projets variés avec d’autres coworkers ou des salariés d’entreprises. L’organisation de leur activité ne peut bien évidemment pas être définie par leur entreprise – ils exercent le plus souvent avec un statut d’autoentrepreneur – ou par l’espace de coworking, qui ne fait que délivrer un service support.
En effet, si l’on a cru un moment que le coworking pourrait être compris comme un phénomène communautaire que l’on pouvait délimiter à l’espace de coworking, l’expérience de terrain confirme rarement cette idée. Pour qu’une communauté se forme, il faut qu’il y ait un bien commun supérieur qui unit les membres.
Or, selon l’étude conduite par La Fonderie – île de France, 71 % des coworkers passent 1 jour par semaine ou moins dans un espace de coworking. La majorité d’entre eux ont donc peu de chance de se sentir dans l’obligation d’œuvrer pour un bien commun ou le bien des autres membres.
Bien que des recherches récentes ont montré que les espaces de coworking sont des lieux d’intermédiation d’innovation ouverte, l’organisation des activités des coworkers implique souvent diverses parties prenantes qui ne sont pas membres de ces espaces. L’espace de coworking ne renseigne donc pas sur les modèles organisationnels des activités de ceux qui y travaillent.
Cela ne veut nullement dire que les personnes travaillent de façon isolée. Au contraire, les coworkers consacrent beaucoup de temps au développement de leur réseau dans et au dehors de l’espace de coworking, car celui-ci est la ressource essentielle pour réaliser des projets. D’ailleurs, la mobilité et la reliance sont deux caractéristiques essentielles du travail collaboratif.
Le travail collaboratif comme processus de définition de nouvelles catégories et rôles
Si l’organisation ne peut pas être résumée à l’entreprise, alors comment la définir ? Le travail collaboratif nous invite à appréhender l’organisation davantage comme un processus en continu de définition et de mise en relation d’acteurs et de technologies.
Pour chaque projet, les coworkers sont obligés de définir des nouvelles formes de coordination. Il en est de même pour les rôles qu’ils jouent ou les relations hiérarchiques qui doivent être réinventées, le plus souvent, à chaque nouveau projet.
En d’autres termes, l’organisation à l’ère du travail collaboratif est un processus d’organe-isation ; c’est-à-dire un processus de définition des outils et instruments qui permettront de mener à bien le projet. Comme le rappel Albert David, organe vient du grec ancien órganon et signifie outil ou instrument.
Cela fait d’ailleurs écho à la philosophie d’Henri Bergson (cf. L’évolution créative), pour qui les organes sont simplement toutes ces « utilités » que nous définissons afin de rendre la réalité intelligible. En étant engagés dans des activités faiblement routinisées, les coworkers sont donc conduits à inventer en continu des nouveaux organes, c’est à dire des événements, catégories et rôles (etc.) qui permettent de mener à bien leur activité.
Le travail collaboratif et l’émergence de nouveaux modèles organisationnels
Les modèles pyramidaux et bureaucratiques avaient figé la notion d’organisation. L’organisation pouvait légitimement être définie comme une structure donnée. Le manager était alors le garant du respect des règles imposées par la structure. Cette conception est aujourd’hui remise en cause et de nombreuses évolutions actuelles visent à se passer de toute forme de management imposée.
Pour les coworkers, cette autonomie est une revendication explicite. C’est également une tendance que l’on observe parmi les salariés et managers. L’holacracy, qui repose sur la définition de rôles propres à chaque activité, est un exemple de cette tendance en entreprise.
En dépassant les frontières de l’entreprise, l’organisation des activités dans lesquelles les coworkers sont engagés ne peut plus être définie en fonction du lien de subordination. En d’autres termes, le coworker en situation de management n’a pas pour responsabilité les activités de ses salariés – le plus souvent il n’en a pas – mais toutes les parties prenantes au projet. Cela peut inclure des salariés d’entreprises partenaires, d’autres indépendants et parfois même des particuliers dans le cas de modèles d’affaires collaboratifs.
Ainsi, en définissant des relations hiérarchiques propres à chaque projet et des modes de collaboration ouverts, les coworkers invitent à repenser l’organisation. Souvent nomade, toujours connecté car ayant besoin de nombreuses collaborations pour (sur)vivre, le travailleur collaboratif est avant tout un créateur de nouveaux modèles organisationnels ouverts et sans cesse en évolution.
—

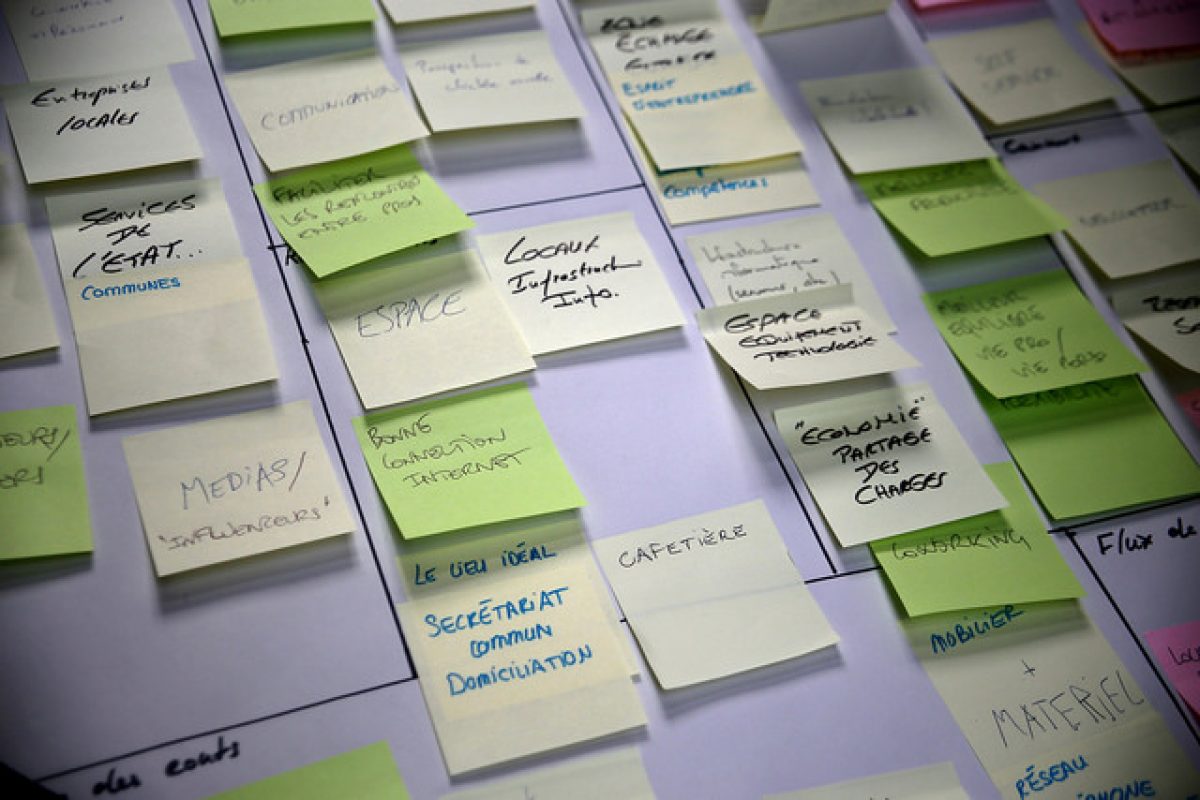
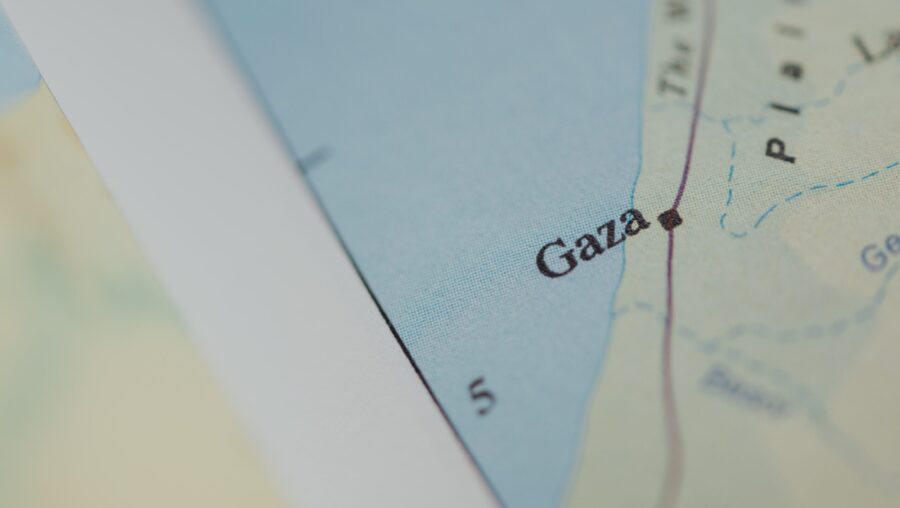
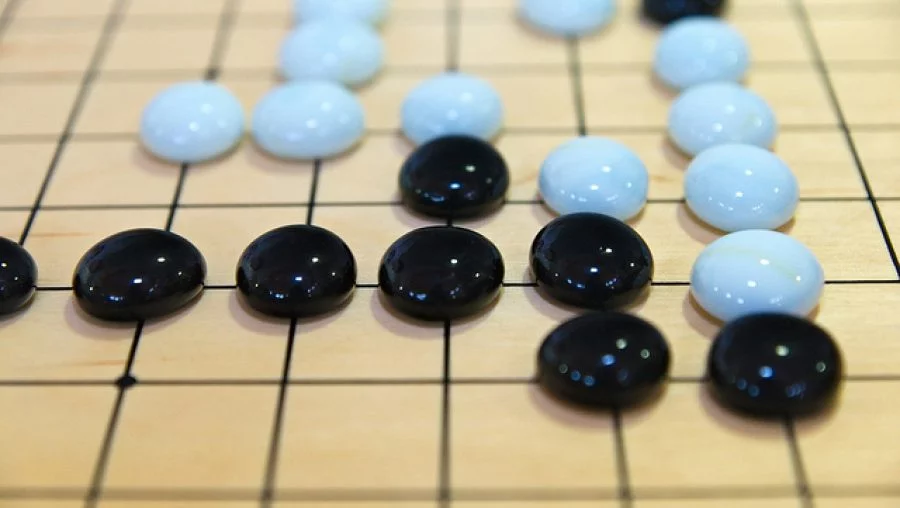
Le travail collaboratif tel que défini par l’auteur tend vers une modélisation nouvelle de l’organisation de l’entreprise.
Conférer plus de responsabilités, plus de possibilités d’initiatives à tout un chacun nécessite un haut niveau de compétences permettant de redéfinir “la culture d’entreprise”.
Le travail collaboratif n’est pas nouveau! Les normes ISO 9001 sont basées sur cette réalité et une entreprise est organisée en processus transversaux ( avec l’objectif de satisfaire les parties prenantes). La performance d’une entreprise passe par ce type d’approche qualité.