En proposant d’opter pour la TVA sociale, l’Afep et le Medef suggèrent en fait d’accélérer l’étatisation de la Sécurité sociale. Leur logique aboutirait à un État providence décourageant le travail.
Par Alain Madelin et Jacques Bichot

L’Association française des entreprises privées (AFEP) et le MEDEF ont pris position pour ce qui se veut une forme de TVA sociale. À savoir le transfert d’une large partie des cotisations patronales sur la TVA et la CSG par des prélèvements fiscaux. Pour l’AFEP, « un passage de la TVA à 21 % dégagerait une recette supplémentaire de 13 milliards qui permettrait d’alléger d’autant la part des cotisations sociales ». Le MEDEF irait jusqu’à 70 milliards de réduction des cotisations patronales (7,5 points) et salariales (4,5 points), remplacées par des impôts (2 points de CSG et TVA à 25 %).
Ces propositions procèdent d’une absence de vision concernant la place de la protection sociale dans une économie d’échanges. Le patronat semble avoir renoncé à l’idée des « assurances sociales » et se rallier à contretemps à celle d’un État Providence. La couverture maladie ne procéderait plus d’une assurance de type mutualiste, où chacun cotise (au prorata de ses moyens) pour être remboursé des soins dont il a besoin, mais d’une sorte de national health service financé par l’impôt. La branche famille ne servirait pas à financer l’investissement dans la jeunesse, sans lequel il n’y aurait pas de retraites par répartition, mais finirait au regard de toutes les propositions de partage sous conditions de ressources qui fleurissent aujourd’hui par grossir encore la part de la redistribution dans le modèle social français.
Ces perspectives vont à la fois dans le sens de l’étatisation de la sécurité sociale et dans celui d’un affaiblissement de la compétitivité de la France. Celle-ci dépend en partie du coût du travail, mais elle reposera de plus en plus sur notre capacité à mobiliser les énergies créatrices. Et ce qui stimule les travailleurs, ce n’est pas la redistribution, c’est l’échange. « Je suis bien payé parce que je travaille bien ; ergo je travaille bien pour être bien payé » : ce n’est pas le seul ressort de l’économie, mais c’en est un en l’absence duquel on s’enfonce dans la croissance molle, le surendettement et le sous-emploi.
Or le patronat souscrit à une conception de la rémunération limitée au salaire net. Selon celle-ci les cotisations sociales et la CSG ne servent pas à acheter un service, mais constituent un « prélèvement obligatoire » dont l’impôt pourrait fort bien se charger, puisqu’il sert à fournir un service public gratuit. Alors que les assurances sociales pourraient faire partie intégrante de l’économie d’échanges, l’AFEP et le MEDEF facilitent leur glissement, déjà bien avancé, vers la sphère étatique : ce monde où les paiements ne donnent aucun droit, et où les prestations sont indépendantes des contributions.
Un tel système social rend, au niveau individuel, le travail de moins en moins utile, puisque les besoins essentiels sont satisfaits par un État Providence. La stratégie gagnante est celle du passager clandestin. Le refus de travailler à un prix raisonnable est une attitude logique, puisque travailler signifie se faire prendre sans contrepartie une grande partie de ses gains, tandis qu’en ne travaillant pas, ou de temps en temps seulement, on est pris en charge aux frais de la princesse – c’est-à-dire de ceux qui persistent à travailler. Dans ces conditions, le travail ne peut qu’être excessivement cher. Les organisations patronales tirent donc contre leur camp.
Pour que l’offre de travail ne soit pas freinée, il faut donner au travailleur l’intégralité, ou presque, de ce qu’il coûte à l’entreprise, charge à lui de payer sa protection sociale de base comme il paye sa protection complémentaire. Pour commencer, transformons donc les cotisations patronales de sécurité sociale en cotisations salariales. Cela peut être fait facilement, sans modifier ni le coût du travail, ni le salaire net, ni les ressources des organismes sociaux. Les salariés prendraient conscience de ce qu’est leur véritable rémunération et de ce que leur coûte la sécurité sociale. Si bien que le jour où, par exemple, ils deviendraient libres de choisir leur assurance maladie comme leur complémentaire santé, ils se rappelleraient qu’ils ont appris à compter.
Si l’assurance maladie s’apparente à l’assurance dommage, l’assurance vieillesse relève de la branche vie : il s’agit d’investir aujourd’hui pour disposer d’un revenu dans quelques décennies. Quel investissement ? Les fonds de pension comptent sur les entreprises qui fonctionneront dans l’avenir : ils placent les cotisations reçues dans des actions et obligations. L’assurance vieillesse, elle, compte sur les futurs travailleurs – les enfants, qu’il faut former. Est-ce avec les cotisations vieillesse qu’on va investir dans cette formation ? Non, puisqu’elles sont reversées aux retraités. Ce sont les sommes destinées aux prestations familiales et à la formation qui jouent le rôle des cotisations aux fonds de pension. Il faut réparer l’erreur d’aiguillage qui a transformé nos retraites par répartition en un système Madoff distribuant allègrement de faux droits.
Un patronat ayant le sens des réalités s’attacherait donc à proposer une réforme de la couverture maladie, pour la rendre pleinement assurantielle ; et de l’organisation des échanges entre générations successives, pour faire des retraites un système financier à vrais droits (des droits gagnés en investissant). À gauche comme à droite beaucoup sont d’accord avec la proposition qu’a fait jadis le CNPF : des retraites à la carte, par points, avec neutralité actuarielle ; que le patronat en profite pour lancer un chantier digne de lui !
La France a besoin d’organisations patronales qui dialoguent avec les syndicats et les pouvoirs publics pour inventer l’échange social de l’avenir. Renoncer aux faux semblants tels que la distinction entre cotisations patronales et salariales, et affronter loyalement le problème du coût du travail, ou tendre leur sébile au maître de la TVA, ces organisations ont un choix à faire !
—-
Sur le web

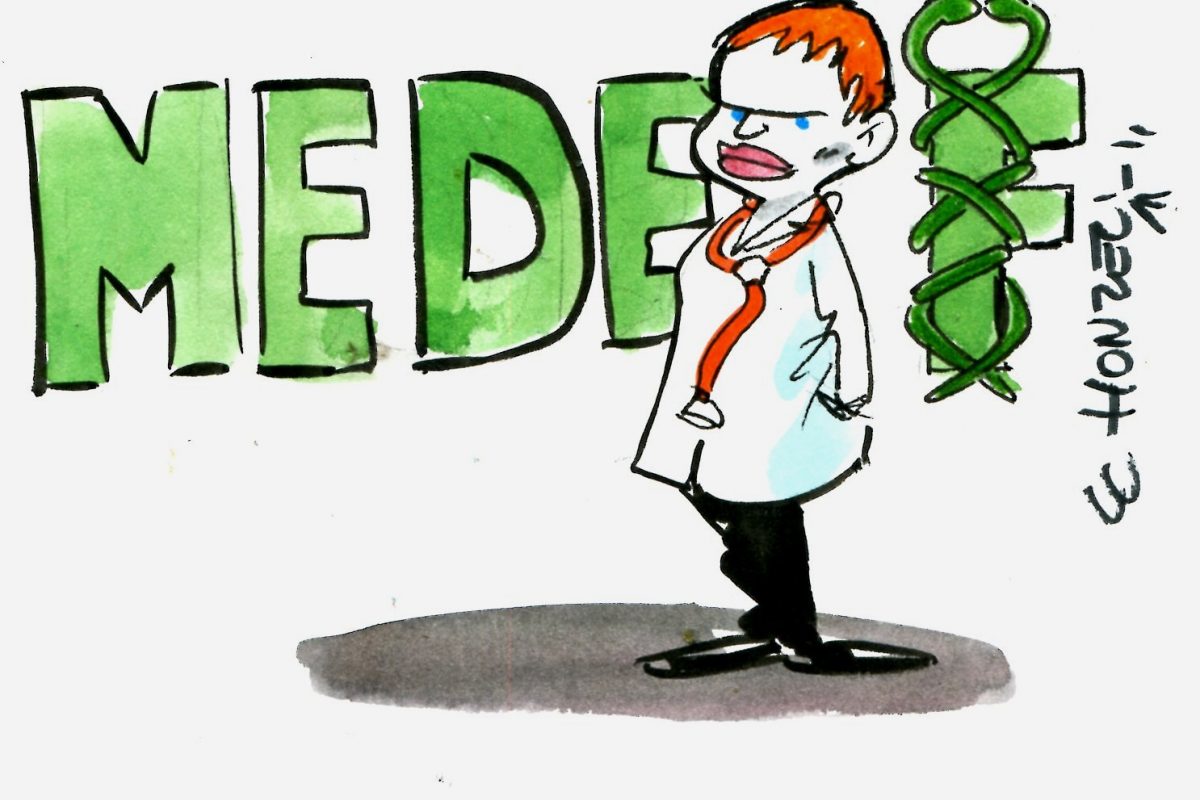


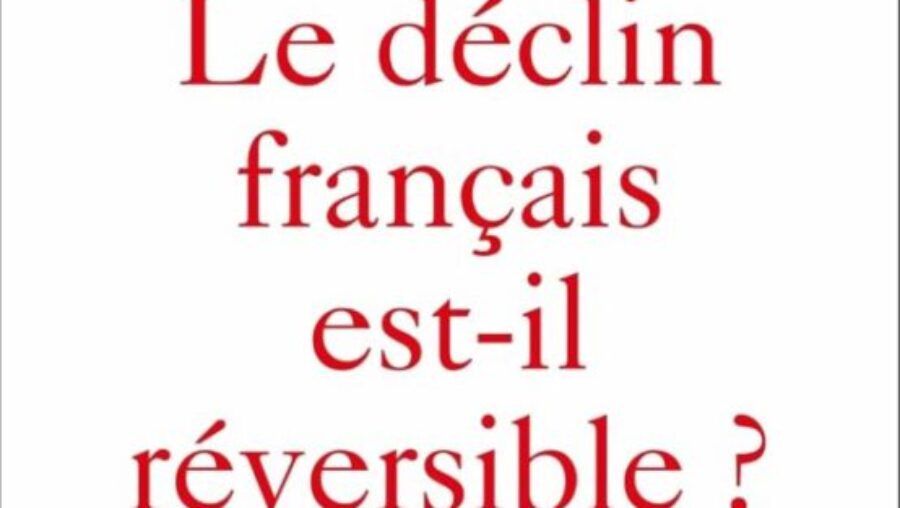
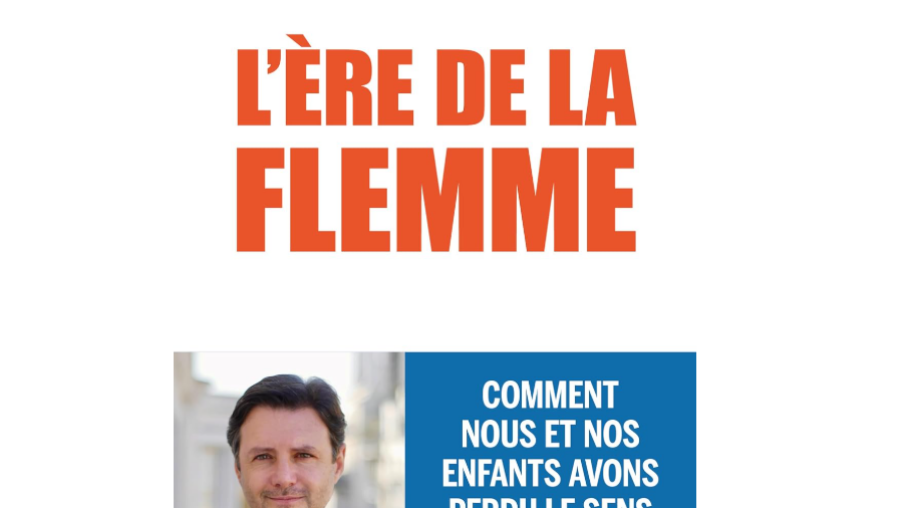
ce qui coute cher au travail, ce n’est pas le travail, c’est ce que le capital prends au travail!
Pouvez-vous préciser votre pensée ?
Le problème réel en France, c’est que les charges sociales sont inégalement réparties entre les entreprises. Elles pèsent essentiellement sur celles qui ont une main-d’œuvre importante…
voir : http://2ccr.unblog.fr/2012/01/21/moins-tu-es-riche-plus-tu-payes/
Où sont les libéraux dans ce pays? 12 députés UMP et 1UDI étaient présents lors du vote pour généraliser le tiers payant: une honte!
Lisez “Chirurgie chronique d’une mort programmée où je dénonce les dérives de notre système de soins
Cordialement