Anatole Leroy-Beaulieu (1842-1912), directeur de Sciences Po à la Belle époque, frère d’un économiste fameux, est surtout connu pour son ouvrage L’Empire des Tsars et les Russes. Le centenaire de la Révolution française en 1889, lui avait inspiré divers textes réunis sous le titre La Révolution et le libéralisme. Essais de critique et d’histoire, publiés en 1890.
En voici quelques extraits significatifs sur les liens entre libéralisme et démocratie qui n’ont rien perdu de leur pertinence.
Placer face à face l’individu et l’État, l’individu pourvu théoriquement de tous les droits, et l’État pratiquement omnipotent, c’était condamner la France à osciller de l’anarchie au despotisme.
À propos de l’ouvrage de Taine sur les Origines de la France contemporaine
L’un des malheurs de la Révolution est d’avoir été faite par des hommes sans éducation politique, dominés par l’esprit littéraire ou par l’esprit scientifique, et croyant, de bonne foi, tout résoudre avec des généralités oratoires ou des formules mathématiques.
Non seulement la Révolution s’est présentée au nom de la Raison, mais, comme nous en avons déjà fait la remarque, elle n’est guère au fond qu’une déification de la Raison, un effort pour substituer dans le gouvernement des choses humaines, si ce n’est dans la conscience, le règne de la Raison au règne de Dieu et des autorités se réclamant de la loi divine.
Les principes abstraits de la Révolution
Spectacle singulier et instructif ! les laborieuses constructions de la Révolution, ses nombreuses constitutions politiques, échafaudées coup sur coup avec la présomption de l’inexpérience, se sont toutes écroulées. Au milieu de toutes ces destructions et ces ruines, une seule chose est demeurée debout, et c’est précisément cette base spéculative, objet de tant de dédains, ce sont ces principes de 1789, devenus comme le roc sur lequel repose toute notre société moderne
[…]
C’est ce qui explique la diffusion presque instantanée des idées de la Révolution d’un bout du monde civilisé à l’autre, et comment on leur pourrait appliquer ce que Lafayette disait de son drapeau. Si ses principes ont si vite fait le tour du globe, c’est précisément qu’étant abstraits, ils pouvaient presque également s’adapter à tous les peuples.
Le despotisme de l’État
La Révolution concevait la souveraineté à l’antique, comme illimitée, par suite l’État comme omnipotent ; et toutes les ressources de l’État, elle se croyait le droit de les mettre au service de ses idées, comptant qu’avec un pareil instrument, rien ne saurait lui résister, et que la nation se moulerait docilement dans le moule gouvernemental. Pour elle, comme pour les anciens, la liberté consistait à posséder une part de souveraineté. Elle ne se doutait pas que la liberté réelle de l’individu se trouverait ainsi noyée dans la souveraineté idéale de la collectivité ; elle ne prévoyait point que, sous l’étendard de la liberté elle allait relever un autre despotisme, d’autant plus intolérant et d’autant plus absolu que, étant censé procéder de la volonté générale, il admettrait moins de résistance.
[…]
Au lieu d’innover, la Révolution n’a fait ici qu’emprunter au passé, et cet emprunt est le point le départ de toutes ses imitations de l’ancienne monarchie dictature de l’État, centralisation outrée, tutelle administrative.[…]
La Révolution n’a fait que déplacer le siège de la souveraineté, que le transporter d’un seul à tous, du roi au peuple. L’omnipotence, que l’un réclamait au nom de Dieu et de la tradition, elle l’a dévolue à l’autre au nom de la raison et de la volonté nationale, restaurant au profit du nouveau souverain jusqu’au crime de lèse-majesté, sans s’apercevoir qu’elle rétablissait d’une main l’absolutisme qu’elle prétendait détruire de l’autre ; qu’en reconnaissant l’infaillibilité politique des masses ou des majorités, elle risquait d’aboutir, de nouveau, au règne de la force, à l’oppression des droits de la conscience, proclamés en 1789.
La France ne pouvait pas imiter l’Angleterre
Ainsi, faisons-nous tous, malgré nous, lorsque nous nous affligeons de voir toute l’ancienne France s’écrouler avec l’Ancien Régime. Que de choses nous eussions voulu en sauver ! mais aristocratie, royauté, corporations, tout se tenait, tout devait être entraîné dans la même chute, sans qu’il fût possible de rien arracher à l’écroulement général.
Pour imiter l’Angleterre, il ne suffisait pas à la France d’avoir, comme à l’état brut, les matériaux des institutions britanniques ; il lui eût fallu le sens pratique, l’esprit politique anglais, avec le goût des traditions et le respect des autorités établies, deux choses qui lui faisaient entièrement défaut, et que l’éducation de l’Ancien Régime n’était pas faite pour lui donner.
Les mécomptes du libéralisme
La démocratie était la seule souveraine dont le libéralisme pût préparer le règne. Il ne s’est pas toujours aperçu qu’il travaillait pour elle. Après lui avoir frayé les voies du trône, il s’en est parfois repenti, il a refusé de la reconnaître, il a essayé de lui disputer l’empire, sans autre succès que de se rendre suspect. Quelque défiance qu’elle lui inspire, la démocratie est sortie du libéralisme, c’est le fruit de ses œuvres, et il n’en pouvait naître autre chose. Il aurait beau la renier, c’est l’enfant de sa chair et de son sang, mais un enfant qui, tout en gardant l’empreinte de ses traits, ne lui ressemble guère.
Fille indisciplinée, passionnée, remuante, impatiente de toute règle, présomptueuse et arrogante, elle est loin d’écouter docilement les froides leçons de son père ; elle ne se fait pas scrupule d’être rebelle à ses maximes ; elle est portée, en grandissant, à ne voir en lui qu’un mentor gênant. Le libéralisme a découvert peu à peu que, tout en se réclamant à l’occasion du nom de liberté, la démocratie était d’instinct autoritaire, et que, ne pouvant toujours mettre son tempérament d’accord avec le principe de liberté, elle préférait plier ce dernier à son tempérament
[…]
Toute la théorie du libéralisme moderne se résumait dans les deux mots de liberté et d’égalité : la démocratie s’est fait gloire de la conserver ; mais, sans bien s’en rendre compte, elle a renversé l’ordre des deux termes de la formule et s’est attachée de préférence au second. La notion de liberté est, pour elle, passée au deuxième rang, ou, ce qui revient au même, elle l’a entendue d’une tout autre manière, dans un sens grossièrement positif, réaliste, matériel, dans un sens plus économique que politique, comme l’affranchissement du joug de la pauvreté et du travail […]
Le gouvernement des partis
La nation, être impersonnel et multiple, n’a pas une volonté ; elle en a, d’ordinaire, plusieurs en contradiction entre elles sur le même objet. La nation ne pense point, n’agit point, ne vote point en bloc ; elle est partagée en opinions diverses, en factions opposées qui ont chacune leurs tendances, leurs passions, leurs préjugés, leurs intérêts distincts. Dès qu’il est libre, un pays se trouve coupé en partis, sortes d’armées civiles sans cesse en campagne, qui, toutes, ont le même objectif, la conquête du pouvoir : victorieuses, elles s’y enferment et s’y retranchent comme dans une forteresse, en barrant les avenues et en murant les portes ; vaincues, elles ne reculent devant aucune violence, ou aucun stratagème, pour en reprendre possession
[…]
C’est alors surtout que, au nom de la liberté et des droits du peuple, une moitié de la nation est exposée à être foulée par l’autre ; c’est alors que le gouvernement des partis se montre le plus inique.
La démocratie tend à renforcer l’État
De même qu’elle tend à en changer la forme, la démocratie tend à modifier le rôle de l’État, à en élargir les attributions. Cette extension des fonctions de l’État a beau se couvrir parfois du nom usurpé de liberté, elle est en opposition manifeste avec l’esprit et les doctrines du libéralisme. Tandis que ce dernier prétendait restreindre au minimum, et, parfois, jusqu’à l’excès, l’ingérence de l’État, les nouvelles tendances démocratiques sont portées à l’étendre démesurément. Le libéralisme cherchait à agrandir le champ où les citoyens se pouvaient mouvoir librement, la démocratie travaille à le rétrécir.
Plus soucieuse des intérêts de la communauté que des droits de l’individu, elle menace de sacrifier l’individu et la famille à la collectivité, État ou Commune ; elle ne se fait pas scrupule de recourir à la contrainte d’imposer l’obligation légale, là où le libéralisme se faisait honneur de s’en remettre à l’initiative privée. C’est ce qu’un penseur anglais dénonçait naguère comme la servitude prochaine : The coming slavery1
[…]
Le triomphe même de la démocratie rend le libéralisme plus nécessaire, car, si elle n’était pas conquise à la liberté, comme autrefois les barbares l’ont été au christianisme, la démocratie nous vaudrait le despotisme le plus ignorant et le plus brutal qu’ait jamais vu le monde.
En dehors des solutions libérales, la démocratie ne peut nous offrir que le choix entre deux sortes de tyrannie, presque également pesantes et également humiliantes la tyrannie des masses, tyrannie de l’État ou de la Commune représentés par des assemblées omnipotentes ; — ou la tyrannie d’un dictateur, d’un maître civil ou militaire, incarnant la force populaire.
- Référence à Herbert Spencer ↩

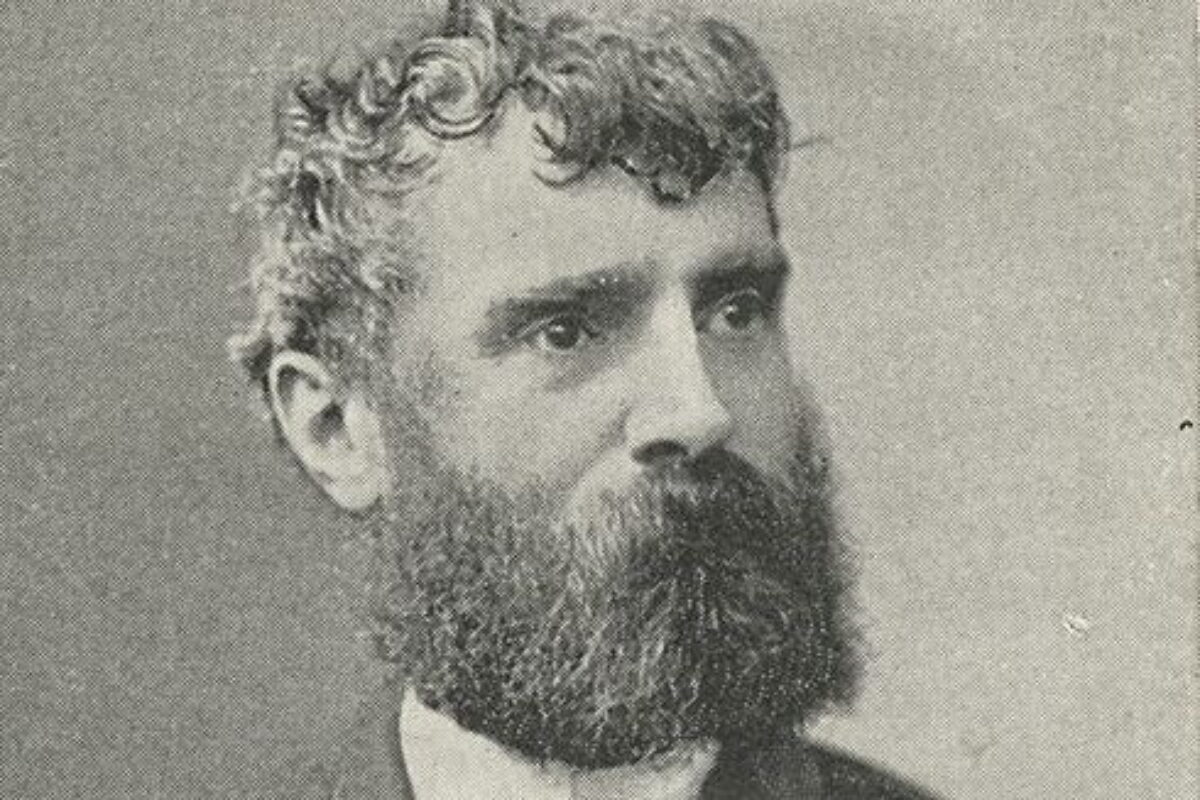


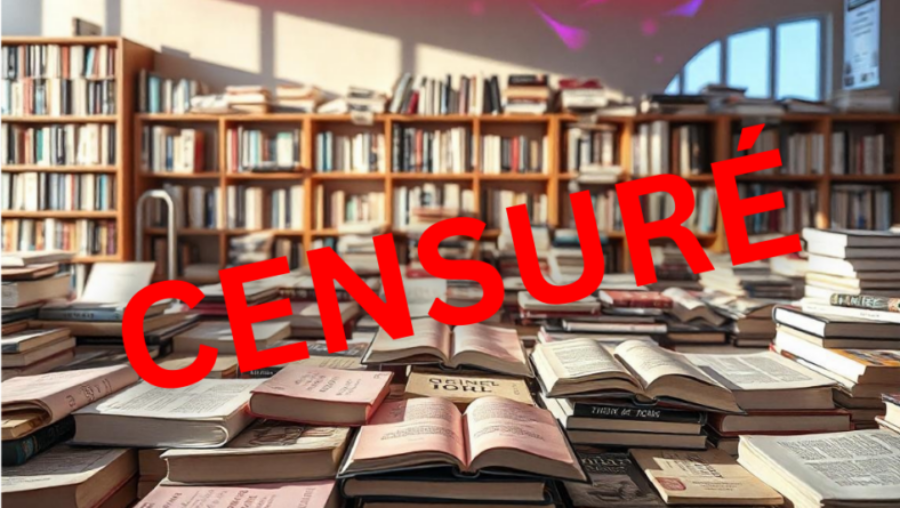
Anatole Leroy-Beaulieu est un auteur que j’ignorais totalement avant ma lecture de Contagions d’Alain Besançon, et quelle surprise !!! Magnifique, et ses textes sont facilement accessible sur internet : bonne lecture