Par Julien Plouchard.
C’est dans l’émotion des semaines qui suivirent les attaques terroristes d’Al-Qaida sur le sol américain le 11 septembre 2001 que les États-Unis adoptèrent le Patriot Act, lequel mettait en place au nom de la guerre contre le terrorisme une société sous la surveillance d’un État policier et réduisait les libertés au nom de la sécurité. Cette loi a déjà vingt ans…
Le Patriot Act, une loi d’exception qui s’inscrit dans la durée
À la suite des attentats à la bombe du World Trade Center en 1993 et d’Oklahoma City en 1995, l’Antiterrorism and Effective Death Penalty Act promu par le sénateur républicain Bob Dole bénéficiant d’un large soutien bipartite et signé par le président démocrate Bill Clinton en 1996, annonçait par certaines de ses dispositions le Patriot Act.
En raison de ses centaines de victimes l’attentat d’Oklahoma City a déclenché une émotion populaire considérable et poussé les parlementaires à adopter une loi qui restreignait les libertés au profit de la sécurité.
L’Antiterrorism Act a limité l’habeas corpus avec la réduction des droits des condamnés à mort et la sévérité accrue des condamnations fédérales. Les partisans de la loi arguaient que celle-ci empêchait la multiplication des appels par les condamnés alors que ses adversaires insistaient sur l’impossibilité pour les condamnés à mort de pouvoir faire appel de leur peine.
Le caractère traumatique des attentats du 11 septembre 2001 poussa les parlementaires américains à adopter rapidement une loi antiterroriste votée par une écrasante majorité du Congrès et signée par le président républicain George W. Bush le 26 octobre 2001, à savoir le Patriot Act.
Cette loi d’exception a permis aux agences gouvernementales américaines d’obtenir des informations dans le cadre d’une enquête relative à des actes de terrorisme. Elle a gommé la distinction juridique entre les enquêtes menées par les services de renseignement extérieur comme la CIA ou la NSA et les agences fédérales responsables des enquêtes criminelles sur le sol américain comme le FBI dès lors qu’elles impliquaient des terroristes étrangers.
Cette loi autorisait en particulier les services de sécurité à accéder directement aux données informatiques des personnes comme des entreprises.
Le Patriot Act ne devait durer à l’origine que quatre ans. Les partisans de la loi ont fait pression pour la reconduire. Parmi les seize dispositions du Patriot Act, quatorze ont été rendues pérennes en 2005. En 2012, le président démocrate Barack Obama a signé le Patriot Sunsets Extension Act, une prolongation de quatre ans de trois dispositions clés de la loi :
- les écoutes téléphoniques itinérantes,
- les recherches dans les dossiers commerciaux,
- la surveillance des « loups solitaires ».
Le USA Freedom Act de 2015 a à son tour prolongé une partie des dispositions du Patriot Act jusqu’en 2019. À cette occasion, des modifications ont été apportées comme l’interdiction pour la NSA de poursuivre son programme de collecte de données de masse. Cette révision législative était la réponse politique au scandale public lié aux révélations faites par Edward Snowden en 2013 sur la réalisation gouvernementale d’enregistrements téléphoniques.
En 2020, une nouvelle version du Patriot Act est entrée en vigueur. Au Sénat, le républicain Mitch McConnell a fait adopter la possible collecte par le gouvernement américain de données de recherche et de navigation sans justification. C’est ainsi que la version actuelle du Patriot Act en vigueur jusqu’en 2023 est plus proche de celle, initiale sous George W. Bush que celle allégée sous Barack Obama.
Le Patriot Act, une loi objet de critiques
Cette loi a été l’objet de vives critiques des organisations de défense des droits de l’Homme comme l’American Civil Liberties Union en raison de son caractère liberticide. Les libertés auraient été réduites au profit de la sécurité. Il est vrai que les droits à la liberté d’expression, à la vie privée et à un procès équitable ont été amoindris.
L’ACLU a été de la plupart des combats contre le Patriot Act. Plusieurs plaintes ont été déposées contre la loi, et des tribunaux fédéraux ont statué qu’un certain nombre de dispositions étaient inconstitutionnelles. L’utilisation accrue des National Security Letters par les agents du FBI pour accéder à des documents téléphoniques, électroniques et financiers sans autorisation judiciaire a été une pratique souvent attaquée. L’affaire DoJ vs ACLU de 2004 a permis de montrer la violation par cette disposition de la loi du premier amendement de la Constitution lequel garantit la liberté d’expression.
De fait, plusieurs décisions de justice ont pu annuler certaines dispositions de la loi jugées excessives. En 2004, des agents du FBI ont fouillé le domicile de Brandon Mayfield, emprisonné pendant deux semaines en raison de son implication suspectée dans les attentats à la bombe de Madrid. Mayfield a porté par la suite l’affaire devant la justice. En 2007, la juge Ann Aiken a conclu que la loi était inconstitutionnelle du fait d’une perquisition excessive et violant donc le quatrième amendement de la Constitution qui exige un mandat.
De son côté, la Cour suprême a statué sur le cas United States vs Antoine Jones en 2012. Ce propriétaire de boîte de nuit a été lié à un trafic de drogue via un dispositif de traçage placé sous sa voiture par les forces de l’ordre sans mandat. La condamnation initiale a été annulée en appel. Dans son arrêt, la Cour suprême a conclu qu’une surveillance accrue des suspects permise par une législation telle que le Patriot Act violait les droits constitutionnels de l’accusé.
Ces différentes affaires judiciaires ont mis en exergue le caractère excessif de certaines dispositions du Patriot Act et les cours américaines ont eu l’occasion de rappeler que la liberté devait rester la norme.
Force est de constater qu’en dépit d’un contexte sécuritaire propice à la mise en œuvre de lois d’exception telles que le Patriot Act, des contre-pouvoirs comme les associations de défense des droits de l’Homme et les cours de justice ont pu par leurs actions et décisions limiter partiellement les atteintes aux libertés contenues dans le Patriot Act
La Constitution, loi suprême des États-Unis, permet ainsi de maintenir le caractère libéral du régime politique américain et ce en dépit d’une législation sécuritaire.



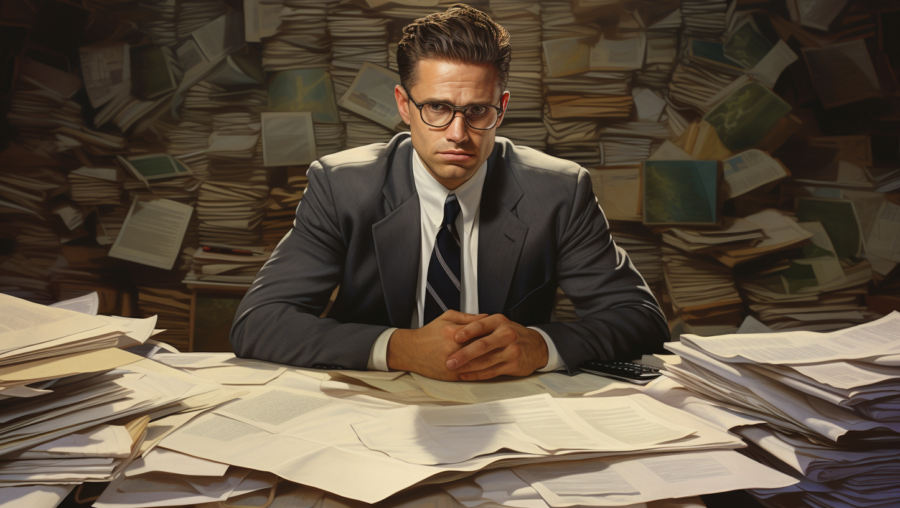

Pas en ce moment en tout cas!