Par
L’agitation autour de la réouverture des terrasses de cafés, ou les atermoiements suscités par le coup d’arrêt porté aux rassemblements festifs en tout genre, rappelle l’importance de ces lieux de fêtes et de rencontre. Ceux-ci font également l’objet de spéculations, et même de peurs qui, d’une manière ou d’une autre, pèsent sur les restrictions qui les traversent actuellement.
L’une de ces peurs sociales est celle liée à l’alcoolisation de la jeunesse, et des jeunes femmes en particulier. Mais contrairement aux idées reçues, les travaux sociologiques depuis une vingtaine d’années montrent à la fois la grande responsabilité de ces jeunes consommateurs, y compris dans les épisodes d’ivresse importante, mais aussi les convergences contrastées entre alcoolisation des hommes et des femmes.
Dangereuse jeunesse ?
Dès lors qu’il est question de fête et d’alcool, sont fréquemment pointés du doigt deux publics : les « jeunes » de manière générale et les femmes en particulier. Le bingedrinking (ou alcoolisation massive et rapide), au cœur de l’actualité festive depuis le tournant des années 2000 est ainsi fréquemment présenté comme leur nouveau – voire unique – modèle de consommation.
Cette association entre alcoolisation problématique et jeunesse remonte plus loin encore, aux années 1980, et succède dans les représentations médiatiques à l’alcoolisme ouvrier. Nouvelle classe dangereuse, la jeunesse contemporaine est désignée comme incontrôlable et immature.
Pourtant, et alors que ces consommations d’alcool sont fréquemment présentées sous l’angle de la prise de risque délibérée et inconsciente, plusieurs recherches attestent au contraire de dispositifs de contrôle collectif et d’autocontrôle, qui ne sont toutefois pas sans faille.
De nombreuses jeunes femmes ne s’autorisent par exemple ces alcoolisations massives que dans des groupes qu’elles estiment sûrs, ou en évitant certains lieux. Dans les collectifs de jeunes fêtardes, les femmes les plus enivrées font d’ailleurs l’objet d’une attention particulière, quand elles ne sont pas prises en charge et veillées par le groupe.
Ces consommations sont présentées par le monde adulte comme une réponse aux supposées monotonies sociales et à la perte d’idéaux ou de repères. Ce mythe de la jeunesse à la dérive prend ainsi fréquemment la forme de faits divers dramatiques. Et dans ce cadre, les mentions fréquentes des sexualités à risques ne sont pas anodines : l’alcoolisation comme la sexualité renvoient à d’importantes angoisses du monde adulte vis-à-vis de sa jeunesse.
Sous de nouveaux habits, des peurs anciennes
Les jeunes femmes sont l’objet d’une attention toute particulière. Au Royaume-Uni, la figure de la ladette (féminisation du terme argotique lad – gars) s’est ainsi imposée ces dernières années, s’accompagnant le plus souvent de l’image de la drunkeness in a dress (littéralement : « alcoolisation en robe »). Dans cette représentation, les consommations des femmes se rapprocheraient de celles de hommes pour devenir problématiques.
Cette représentation n’est pas sans écho de notre côté de la Manche et ce qu’il faut bien appeler une panique morale ne fait que réactiver, sous de nouveaux habits, des peurs anciennes.
Dans les médias populaires, la représentation problématique de la « fille moderne » pendant l’entre-deux-guerres en Angleterre n’est pas sans rappeler la ladette contemporaine : une consommatrice excessive d’alcool ayant une attitude tapageuse.
En France, dès les années 1960, l’augmentation de la consommation d’alcool chez les femmes était déjà un sujet d’inquiétude et prenait sens dans le contexte des craintes plus larges liées aux transformations de la place des femmes dans la société.
Et là encore, cette augmentation était considérée sous ses auspices moralisatrices, soulignant leur possible déchéance ou leur perte de respectabilité. Consommatrice d’alcool, comme l’homme, la femme n’était supposément plus à même d’assurer les tâches qui lui étaient traditionnellement attachées au sein du foyer.
La consommation globale d’alcool baisse en France
La mise en parallèle de ces représentations sociales avec les réalités sociologiques de ces consommations est riche d’enseignements. Si la plupart des observateurs s’accordent à reconnaître une relative homogénéisation des pratiques de consommation d’alcool en Europe, et en particulier chez les jeunes, et une convergence entre les hommes et les femmes, ces tendances doivent toutefois être considérées avec précaution.
Ainsi, la consommation globale baisse en France, y compris chez les jeunes, au point d’avoir été divisée par deux entre 1960 et 2018. Comme le rappelle une étude de l’Insee, depuis 1960, la consommation de boissons alcoolisées par habitant a fortement diminué, en particulier celle de vins courants et de cidres.
Et nos pratiques de consommation se sont largement modifiées. À l’échelle européenne, l’observation de ces tendances est d’ailleurs révélatrice. Les pays relevant du pourtour méditerranéen comme la France ou l’Italie, historiquement caractérisés par une consommation intégrée à la vie quotidienne, modérée mais fréquente (et que certains chercheurs nomment wet drinking culture) font ainsi face à une diminution globale de leurs consommations, qui sont de moins en moins quotidiennes. Les pays du nord de l’Europe (dry drinking culture), où l’alcool est plus épisodique mais consommé en de larges quantités, voient à l’inverse leurs consommations globales augmenter.
Réouverture des terrasses : un espace de liberté
Chez les plus jeunes générations, ces convergences relatives sont davantage marquées et se présentent sous la forme d’un hédonisme calculé où le flirt avec les limites, corporelles notamment, rend compte de tensions entre discipline et divertissement. En dépit des apparences, les ivresses importantes ne sont ainsi et le plus souvent pas effectuées n’importe où, ni avec n’importe qui par ces jeunes consommateurs. L’ébriété n’est ainsi pas sans règle.
Le développement dans les centres-villes d’une économie de la nuit encourage d’ailleurs cet imaginaire marqué par la prise de risque et le refus des responsabilités : par opposition au monde du travail ou des études, aux structures censément contraignantes, les conduites nocturnes offriraient un espace de liberté et d’évasion, voire un exutoire.
Il n’est ainsi pas étonnant que la réouverture prochaine des terrasses – mais aussi le prolongement du couvre-feu et donc la possibilité de s’approcher d’une vie nocturne – fassent l’objet d’une telle attente. Ils représentent cet imaginaire de liberté largement malmenée ces derniers mois.
—![]()


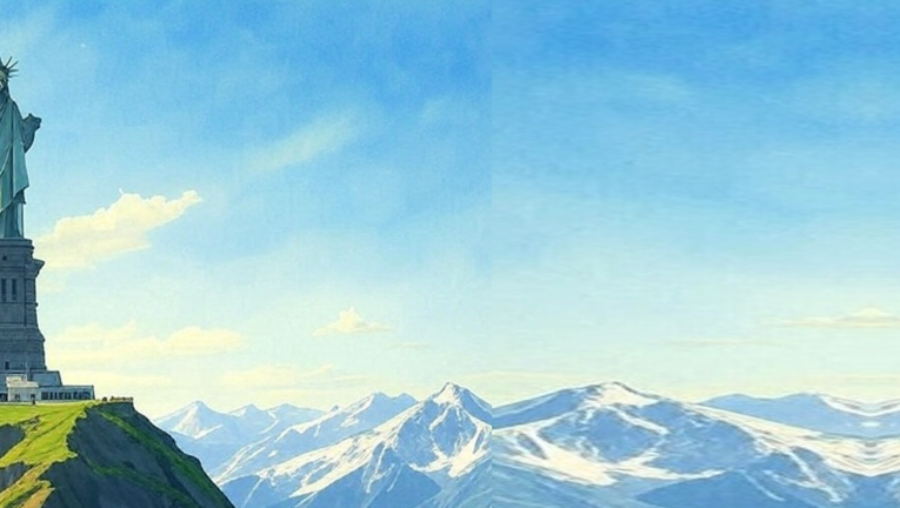


Pour l’instant la seule peur que je constate, elle est du ressort des enfermistes, ces collapsologues de la médecine, qui croient dur comme fer, que le moindre relâchement dans nos comportements va faire exploser l’épidémie cet été.
Je ne vois pas l’intérêt de cet article.
Moi non plus!
Moi non plus, et pourtant la réouverture des terrasses rappelle le malaise provoqué par des débits de boissons peu valorisants et c’est une vieille histoire.
Dans mon enfance, je plaignais les adultes. Je regardais la déchéance humaine au travers des vitres des bistros remplis d’hommes avinés dans la fumée des cigarettes. Sur les trottoirs, fréquents étaient ceux qui titubaient, parfois ils vociféraient ou se battaient. J’entrais dans les maisons (à cette époque, les enfants étaient comme l’eau, ils allaient partout) et je trouvais des femmes qui pleuraient dans leur cuisine. Parfois, de désespoir, l’une d’entre elles allait s’asseoir par terre, sur le trottoir d’en face, les pieds dans la rigole, regarder derrière la vitre leur homme s’enivrer. Jusqu’à ce que, emplie d’une rage froide, elle entre pour balayer tout le comptoir d’un revers de mains et menacer le patron : “Vous n’avez pas le droit de continuer à servir un homme ivre”, tonnait-elle d’une voix blanche. Silence de plomb dans le fracas des verres brisés, les hommes laissaient passer l’orage, les yeux baissés. Dies Irae. Deus était Dea à mes yeux grand ouverts.
Alors aujourd’hui, comparativement, tout est luxe, calme et volupté. Evidemment, je rêve d’un jour où tous ces gens en terrasse auront autre chose à consommer que les rivières de bière qui coulent dans leurs verres : des infusions d’herbes subtilement composées, de l’eau de source pour accompagner des nourritures spirituelles autrement exaltantes… Mais en attendant, quel progrès de ne plus voir l’alcool comme le fléau qu’il était il n’y a pas si longtemps!
Donc cet article me semble assez tordu pour finir par dire une évidence : que l’alcool dans l’espace public n’est plus un problème. Cela laisse supposer que les gens ont appris à en gérer la dangerosité… Peut-être pour renouer, dans une phase d’évolution ultérieure, avec un rituel potentiellement bénéfique où l’alcool serait reconsidéré comme une drogue qui peut ouvrir l’esprit. Sachant qu’il suffirait parfois d’une seule expérience de légère ivresse dans une vie pour en éprouver le caractère initiatique unique. Ce qui nous conduit aux antipodes de l’abrutissement des beuveries.
Pour l’instant, les bières qui coulent à flots sur des terrasses dépourvues de charme se situent à mi-chemin du pire et du meilleur de l’usage de l’alcool. C’est un progrès. Suivant cette tendance, le temps n’est pas loin où les gens se lasseront de cette consommation industrielle pour trouver mieux à partager.
Le rapport entre terrasse et alcoolisme ? Aucun. Les prix ne le permettent plus !
Les températures ambiantes non plus malgré “le réchauffement climatique”!
A titre personnel, étant considéré comme jeune (en études supérieures), je constate plus de « dry drinking culture » dans les environnements étudiants types grandes écoles que la « wet drinking culture ». Il y a aussi de la « dry-wet drinking culture » c’est à dire des étudiants qui se prennent des cuites très régulièrement. De plus, faisant beaucoup de sport, il me serait impossible de boire régulièrement même en faible quantité et c’est pour ça que c’est plutôt une fois par mois ou tous les deux mois, mais de manière plus conséquente, sans aller jusqu’au point où le lendemain sera difficile quand même.
Il me semble que depuis de nombreuses années, l’alcoolisation des jeunes se passe plutôt dans les grosses fêtes du WE, dans des lieux pas toujours prévus pour de tels rassemblements, mais rarement aux terrasses des bistrots. Surtout quand cette alcoolisation est plutôt nocturne! Vous allez souvent vous en demi saison, vous alcooliser en terrasse, jusqu’à 3h du mat avec une doudoune?
“L’une de ces peurs sociales est celle liée à l’alcoolisation de la jeunesse, et des jeunes femmes en particulier.”
Est-ce que ça existe ça “une peur sociale”? qui a peur que l’ouverture spécifiquement des terrasses aggrave l’alcoolisation des “catégories sociales” sus-citées?
Si le nombre de cas n’augmente pas, cela confirmera toute cette mascarade covidienne 😉
Je suis assez consterné par le fait que l’aspect public de la santé, avec tout ce que ça a d’invasif, est devenu le crédo d’absolument tous les courants politiques (à l’exception du libéralisme mais ce dernier est epsilonesque en France).
Tou t est sante publique. La consommation alimentaire, les moeurs sexuelles, la consommation d’alcool, le stress au travail, les maladies banales comme la grippe saisonnière, les blessures sportives etc… Si on parle d’un problème de santé c’est un problème de santé publique. C’est comme si le mot santé n’existait plus par lui même… Bientôt à la Saint Sylvestre on ne dira plus “bonne année bonne santé!” mais “Bonne année, bonne santé publique!”
C’est conternant! La santé est justement quelque chose de privé. Je n’ai pas envie que ma santé soit publique et que d’autres viennent y mettre leur grain de sel. Je n’ai pas envie que la santé des autres soit mon problème, j’en ai déjà bien assez avec la mienne.