Par Nicolas Marques.
Un article de l’Institut économique Molinari
Les dépenses publiques sont passées de 45,2 % du PIB en 1978 à 55,6 % en 2019 (Figure 1). Cela représente une hausse de 10,4 points. Cette augmentation a été concentrée sur 3 périodes de crises : 1978-1985 (+7,1 points), 1989-1993 (+5,7 points), 2007-2009 (+4,6 points). Sur la longue période, elles augmentent significativement de façon tendancielle, ce qui bat en brèche l’idée d’une austérité budgétaire française.
En parallèle, les recettes publiques ont augmenté significativement par rapport au PIB. Elles sont passées de 43,4 % du PIB en 1978 à 52,6 % en 2018. Cela représente une hausse de 9,2 points. Cette augmentation a été concentrée sur 3 périodes : 1978-1985 (+5,9 points), 1992-1996 (+3 points) et 2010-2016 (+3,2 points).
Les épisodes précédents de crise avaient été soldés pour partie par un envol de la fiscalité et, pour partie, par une décrue des dépenses post-crise. C’est ce qui avait permis de retrouver des déficits de l’ordre de 1,8 % en 1989 et de 1,3 % en 2000. Mais le dernier épisode, consécutif à la crise de 2007-2008, est différent.
Les dépenses publiques ont de façon classique augmenté brusquement entre 2007 et 2009 (+4,6 points de PIB en 2 ans). Mais elles sont restées à un niveau très élevé depuis. Elles ont diminué bien moins vite que ce qu’on observait dans les précédents cycles français, ce qui là encore bat en brèche l’idée d’une austérité budgétaire française.
Pour éviter que cette augmentation durable des dépenses ne génère des déficits au-delà des normes européennes, les pouvoirs publics ont augmenté massivement la fiscalité en 2011, 2012 et 2013 avec un point de plus par an. Cet épisode est à l’origine du sentiment de ras le bol fiscal, largement répandu dans la population française depuis.
L’analyse comparée par rapport à l’UE confirme le choix atypique de la France.
Nos voisins n’ont pas fait le choix d’une augmentation des dépenses publiques aussi significative et durable que la France. Ils ont réduit significativement leur fiscalité dans la période récente.
Depuis le creux de la crise, les dépenses publiques ont baissé 3 fois moins vite en France que dans l’UE. Elles ont peu reflué lors de la reprise de 2009 à 2019 (-1,6 %), alors qu’elles baissaient significativement dans l’UE (-4,4 %).
La France a fait l’impasse sur la traditionnelle phase post-crise de réduction des dépenses publiques (Figure 2). Elle a tenté de résorber ses déséquilibres en augmentant les prélèvements obligatoires. Les recettes publiques ont augmenté deux fois plus vite en France que dans l’UE (+2,6 % vs +1,4 %).
L’ajustement post-crise français a reposé aux deux-tiers sur des hausses de fiscalité, la baisse des dépenses ne comptant que pour un tiers.
L’UE a fait dans son ensemble une démarche diamétralement inverse, avec un ajustement reposant aux trois-quarts sur la baisse des dépenses publiques et pour un quart sur la hausse de fiscalité.
Plus de chômage et de déficits, le choix français est loin d’être gagnant.
Avant même que la crise de la Covid-19 n’éclate, la France avait moins bien récupéré ses marges de manœuvre financière que le reste de l’UE. Fin 2019, le déficit public était de 3 points de PIB, contre 0,8 point en moyenne dans l’UE.
Un autre effet pervers du mauvais choix de politique publique français est que la création d’emplois n’est jamais repartie à la hausse significativement. En France, entre 2009 et 2019 le chômage n’a reculé que de 7 %, en passant de 9,1 % à 8,5 %. Dans le même temps, le chômage reculait de 29 % dans l’Europe, en passant de 8,9 % à 6,3 %.

—




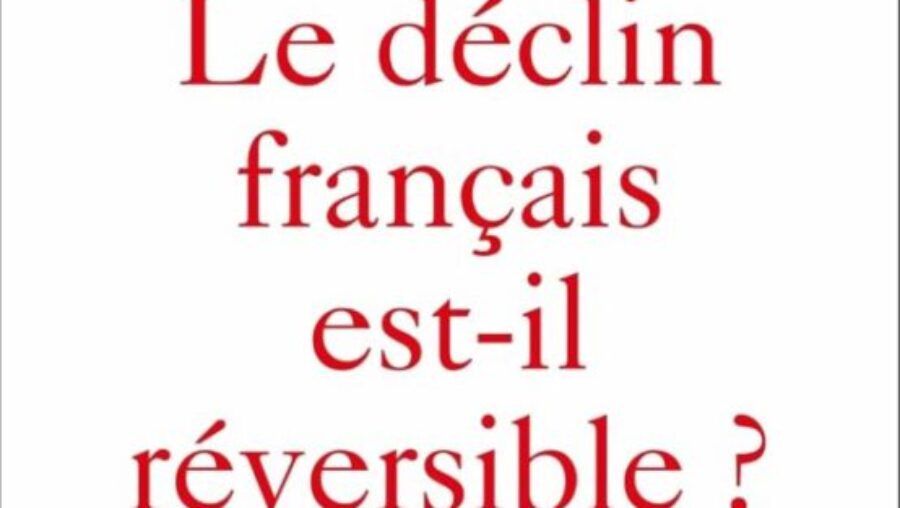


Il y a maldonne sur le titre,je dirai plutôt frénésie fiscale!
la France et son système social que le monde entier nous envie…..il faut bien que le dit système soit payé par les uns pour que les autres en bénéficie ;
Oui: Le monde des va nu pieds nous l’envie. Le monde des entrepreneurs fuie ce système.
Pourquoi choisir un titre qui induit en erreur ? Dire que l’austérité fiscale est un mal, cela revient à faire croire que si l’Etat avait fortement accru la fiscalité, les choses iraient mieux. J’espère que ce n’est pas ce que l’auteur veut nous faire croire.
Et encore, on sait que les stats du chômage sont bidouillées puisque les emplois aidés et stages de formation ne sont pas comptés. Le chômage est plus élevé que les 8,5% annoncés! Il faut compter le nombre d’emplois par rapport à la population!
on peut ajouter que l’évaluation du PIB est largement sujet à caution, puisqu’elle inclue les dépenses de l’Etat…