Par Trevor Smith.
Il y a quelques semaines de cela, je me suis rendu devant le tribunal d’instance d’Asnières-sur-Seine : dans le cadre d’un contentieux avec un site marchand, je venais demander le remboursement d’une commande jamais honorée. Me défendant moi-même et mon contradicteur n’étant pas présent, mon dossier fût parmi les derniers à passer, me permettant d’assister à une matinée entière d’audience.
Le tribunal d’instance est une juridiction de premier degré, composée d’un seul juge, assisté d’un greffier. Il traite toutes les affaires civiles pour lesquelles la demande porte sur des sommes inférieures à 10 000 euros : les sujets peuvent donc être extrêmement divers.
Du crédit à la consommation au loyer non payé
Au cours de la matinée, les premiers cas, soit une douzaine de dossiers, ont concerné des litiges relatifs au crédit à la consommation : de l’électroménager ou des meubles achetés à crédit par des personnes qui n’étaient plus en mesure d’honorer leurs échéances. Un seul avocat représentant un établissement de financement spécialisé a enchaîné à lui seul sept ou huit affaires. Au vu de ses échanges avec le juge, il était un habitué du tribunal.
Systématiquement, le magistrat a recalculé les échéances et contrôlé le respect de la procédure légale, n’hésitant pas à renvoyer plusieurs dossiers incomplets à des audiences ultérieures. Dans la plupart des affaires les défendants n’avaient pas pris la peine de se déplacer : on peut se douter de la décision à intervenir dans ce cas… Sinon, le juge les interrogeait sur leurs possibilités de remboursement de façon à pouvoir modifier l’échéancier si cela paraissait possible. Son objectif ne semblait pas tant de juger les affaires que d’aménager le remboursement en accord avec les établissements de financement.
Ensuite ce fut le tour des litiges entre propriétaires et locataires, également une dizaine de dossiers : des loyers non payés et parfois des appartements mal entretenus voire transformés en taudis (photos à l’appui !) ; quelques avocats représentant les offices HLM des communes environnantes pour faire prononcer des expulsions ; et des propriétaires modestes pas beaucoup plus riches que leur locataire, qui comptent sur leur loyer pour compléter leurs revenus, souvent limités à une pension de retraite.
Le juge mène encore une fois la discussion pour étudier les sources de revenu (officielles ou non) du locataire, tenter de mettre en place un échéancier ou à défaut débattre d’une date d’expulsion pouvant satisfaire toutes les parties. Il n’est pas tant là pour « dire le droit » que pour essayer au mieux de l’adapter à des situations de vie compliquées.
Pour finir, quelques litiges de la vie de tous les jours : une voiture censément réparée par un garage mais qui ne fonctionne pas bien longtemps, des commandes passées sur Internet jamais livrées, un versement de pension alimentaire non réalisé… Avec encore une fois, si les deux parties sont présentes, le souhait de trouver une solution négociée.
Une juridiction à part
Le tribunal d’instance, c’est donc la juridiction de la vraie vie, celle du voisin de palier qui peine à finir le mois. Pas d’effets de manche ou de joutes oratoires ici, mais des personnes qui viennent se défendre elles-mêmes, la représentation par un avocat n’étant pas obligatoire et étant souvent hors de portée financièrement.
Ce ne sont certainement pas des juristes, un certain nombre d’entre eux ont même une maîtrise très parcellaire du français. On peine à expliquer clairement son cas et quelles sont ses demandes précises, on profère éventuellement quelques grossièretés, on se fait rappeler à l’ordre par le magistrat parce que l’on porte une casquette…
Pour chacun d’entre eux, le juge cherche à expliquer en mots simples les procédures légales et les risques juridiques qu’ils encourent. Avec toujours le souhait, si la personne a pris la peine de se déplacer, de comprendre sa situation et ce qu’elle souhaite pour trouver une solution en accord avec l’autre partie. D’ailleurs, avant de saisir le tribunal d’instance, il faut tenter une médiation avec un conciliateur de justice : le juge n’est là qu’en dernier ressort, ce qui ne l’empêche pas de tenter sa chance également à la négociation.
Être magistrat dans une telle juridiction est certainement un métier très complet qui nécessite aussi bien de comprendre et dire le droit dans des spécialités juridiques variées que de pouvoir le retranscrire le plus clairement possible à des non-initiés. Le juge est presque davantage pédagogue que juriste… et davantage conciliateur que magistrat.
La fin annoncée des tribunaux d’instance
Le projet de loi de réforme de la justice porté par Nicole Belloubet prévoit la fusion des tribunaux d’instance et des tribunaux de grande instance, ainsi que la suppression du statut de juge d’instance. On peut légitimement s’interroger sur le traitement de ces petits contentieux à l’avenir, alors même que les tribunaux d’instance présentent aujourd’hui des statistiques flatteuses : une durée moyenne de traitement des dossiers de 5 mois et un taux d’appel quasi-inexistant, de l’ordre de 5 %.
Qu’en sera-t-il demain ? L’accès à la justice des citoyens modestes restera-t-il aussi aisé que possible, a fortiori en zone rurale si le tribunal se trouve désormais à une heure de route ? Ou parmi les populations les plus éloignées du formalisme du droit car ne maîtrisant pas le français ou le mode de fonctionnement juridique ? Les justiciables souhaitant régler des petits contentieux pour lesquels la saisine d’un tribunal ne semblera pas rentable au vu des enjeux, continueront-ils à se tourner vers la justice ?
Ou bien préféreront-ils se faire justice eux-mêmes, par exemple pour expulser un mauvais locataire, jugeant le mode légal définitivement moins efficace et rapide ? L’actualité des derniers mois nous a prouvé que la tentation pouvait être grande de ne pas utiliser les moyens prévus par la loi…
Les lecteurs réguliers de ces colonnes le savent, équilibrer les comptes publics est une nécessité absolue en France, et en faisant disparaître les tribunaux d’instance, le gouvernement espère faire des économies de bouts de chandelles, certes, mais des économies tout de même.
Mais quand le budget du ministère de la Justice s’élève à seulement 7 milliards d’euros, (moins que le ministère de la Culture), soit 123 euros par habitant, contre 166 en Allemagne et 223 au Royaume-Uni, la priorité devrait-elle être de tailler encore dans les missions régaliennes de l’État, déjà fort mal assurées en France ? On peut se permettre d’en douter.

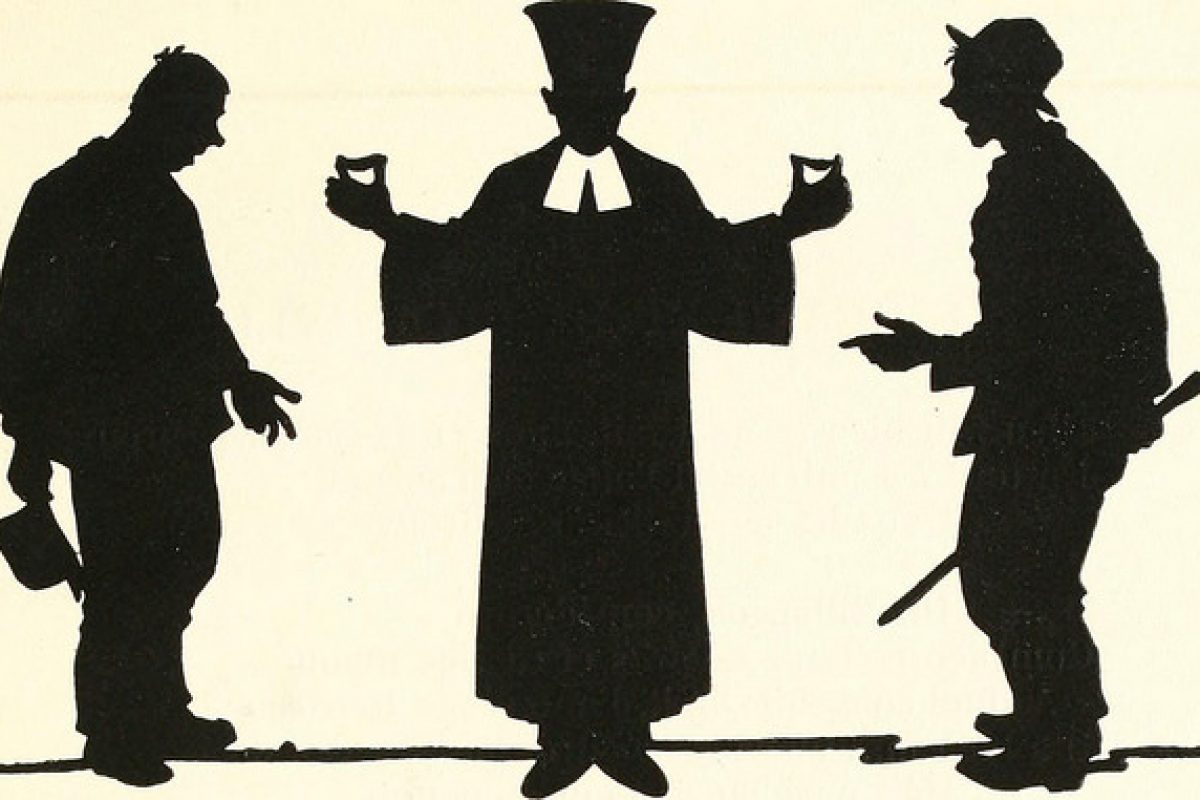


On sacrifie l’essentiel pour pouvoir encore plus
spolierredistribuer afin d’entretenir son cheptel d’électeurs.la JUSTICE n’existe pas ,elle est faite par des individus dont leurs carrières dépendent des élus en place!!! dont certains sont mégalo. .le pouvoir d’un individu sur les autres est machiavélique. …
ex:une mère de famille en 1er jugement:vole 2 boite de cassoulet pour donner à manger à ses enfants 4 mois de prisons ferme.en 2 ème jugemement 4 mois de prisons avec sursis ….un représentant du peuple qui plus est ministre des finances …parjure à l’assemblée nationale pour fraude fiscale et blanchiment d’argent..et qui a peur d’aller en prison 4 ans dont 2 avec sursis …sans commentaire…mais si c’était le seul!!!!!