Par Laurent Pahpy.
Un article de l’Iref-Europe
Retrouvez les premières parties de cet article ici et ici.
Un ministère de l’Agriculture obsolète qui suradministre
Rares sont les secteurs qui sont autant réglementés et contrôlés que l’agriculture. Son ministère et la myriade d’organismes publics et parapublics subventionnés et/ou directement sous sa tutelle, ne laissent qu’une marge de manœuvre très limitée aux exploitants.
L’État et l’UE, via l’Organisation commune du marché (OCM) de sa Politique agricole commune (PAC), contrôlent, règlementent et subventionnent toutes les activités économiques associées à l’agriculture : la vente de terres, le droit de cultiver, la manière de produire, la quantité et la qualité des productions. Dans certains cas, les cahiers des charges des appellations ou des labels d’État imposent des contraintes supplémentaires.
Bien que l’agriculture soit devenue une des compétences partagées avec l’UE depuis le traité de Rome de 1957, le ministère de l’Agriculture n’a pas disparu. Le nombre de fonctionnaires y reste considérable alors que la population agricole a fortement baissé.
On en dénombre plus de 16 000 en France, hors recherche et formation, à comparer avec les 900 fonctionnaires au ministère fédéral de l’Agriculture allemand. En prenant en compte les agences administratives (ANSES, ASP, FranceAgriMer, INAO, SAFER) on obtient un ordre de grandeur d’environ un fonctionnaire pour vingt exploitations.
Le contrôle des activités
L’ensemble de cette technostructure est organisé pour planifier et contrôler les activités des agriculteurs et notamment les volumes et la qualité des productions.
Les quantités des productions agricoles peuvent être légalement limitées et contrôlées par différentes politiques publiques européennes, nationales et/ou corporatistes.
Un de nos récents rapports a analysé ces politiques dans le secteur du vin. Cette étude montre comment l’Organisation commune du marché (OCM) de la viti-viniculture a limité artificiellement l’offre avec la mise en place de droits de plantation et des campagnes d’arrachage ou de distillation subventionnées sous la pression de certains lobbies français afin de maintenir leurs rentes et des prix élevés.
Ce contrôle de l’offre persiste aujourd’hui au travers des autorisations de plantation. Cette politique est encore partiellement appliquée à d’autres secteurs comme le lait et le sucre malgré l’assouplissement des restrictions avec la fin des quotas laitiers depuis 2015 et des quotas sur le sucre en 2017.
La loi encadre très précisément les relations entre agriculteurs et acheteurs avec des contrats-types pour de nombreuses productions.
La qualité des productions agricoles est elle aussi strictement réglementée par l’UE et l’État. Dans ce même rapport sur la viticulture, nous avons montré comment des pratiques culturales et œnologiques ont été imposées dans toute l’Europe grâce au lobbyisme parfois violent exercé par les syndicats de viticulteurs (blocage physique des importations aux frontières et dans les ports).
La définition de la qualité des produits passe aussi par le système de certification monopolistique régi par l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO).
Les Indications et les Appellations géographiques contrôlées ou protégées (IGP/AOC) permettent à des corporations de producteurs d’établir des monopoles intellectuels limitant la concurrence et l’innovation sur un territoire donné (voir rapport de l’IREF).
D’autres réglementations sont établies pour des raisons prétendument sanitaires, sociales, éthiques, environnementales ou concurrentielles. Un rapport du Sénat concède que les agriculteurs sont « au bord d’une overdose normative » qui nuit à leur compétitivité.
Le principe de précaution
Les droits français et européen reposent sur une réglementation précautionniste de l’ensemble des activités agricoles plutôt que sur le principe de responsabilité individuelle.
Selon cette vision du droit, il est préférable de faire confiance à des représentants politiques et à des technocrates édictant a priori des restrictions plutôt qu’à la liberté contractuelle, la concurrence normative et la responsabilité civile et pénale des agriculteurs pour établir les normes qui régissent les relations entre tous les acteurs de la filière (producteurs, distributeurs, fournisseurs, consommateurs …).
Les réglementations sur l’épandage des produits phytopharmaceutiques (interdite lorsque le vent est supérieur à 19 km/h) et la taille des cages des poules sont non seulement des contraintes pour l’exploitant mais elles impliquent des formalités et de très nombreux contrôles extrêmement coûteux pour le contribuable.
Un rapport public du Sénat dénombre jusqu’à dix acteurs différents pouvant exercer leurs contrôles : l’agence de services et de paiements (ASP), FranceAgriMer, l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS), la direction départementale des territoires (DDT), la direction départementale en charge de la protection des populations (DDPP), la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF), la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL), la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et la mutualité sociale agricole (MSA).
Il faudrait ajouter à cela les déclarations aux douanes, les contrôles fiscaux et ceux de certaines interprofessions. Ce rapport reconnaît le poids des contraintes associées aux normes publiques :
La réglementation est perçue [par les agriculteurs] comme changeant sans arrêt, ce qui, sans être une caractéristique générale, n’est pas faux dans certains domaines. L’agriculteur même normalement informé, redoute, malgré toute l’attention qu’il peut porter au sujet, d’être pris en défaut car il craint que sa connaissance du sujet en contrôle ne soit pas bien à jour.
Selon le rapport du Sénat, certains agriculteurs renoncent à assurer l’entretien des cours d’eau qu’ils réalisaient pourtant depuis des générations tant les formalités administratives sont devenues complexes.
Un sondage estime que les agriculteurs passent en moyenne près de 9 heures par semaine à traiter leurs démarches administratives pour 57 heures de travail hebdomadaires.
Ces réglementations peuvent aussi servir des intérêts politiques au détriment du secteur agricole. Le récent débat public concernant le glyphosate démontre que certains politiciens peuvent utiliser la réglementation pour satisfaire des pressions électoralistes et les lobbies de l’agriculture dite biologique au mépris de la science et de l’État de droit.
L’UE, l’État français et notamment son ministère de l’Agriculture ont acquis un pouvoir démesuré sur les agriculteurs. L’analyse historique et politique des réglementations montre que ces dernières sont trop souvent le fruit de pressions syndicales, corporatistes ou électoralistes qui nuisent à la compétitivité du secteur tout en déresponsabilisant et infantilisant les producteurs. Au vu des compétences européennes et de l’évolution du poids de l’agriculture dans l’économie, l’UE et l’État devraient réduire significativement leurs périmètres d’intervention dans ce secteur et se limiter aux services administratifs propres à toute activité économique. Cela implique une réduction significative de la taille du MAAF, voire sa suppression à moyen terme.
Il est indispensable de repenser la création de normes en responsabilisant l’agriculteur tout en réduisant la réglementation. Il serait pertinent d’adopter la politique consistant à supprimer préalablement deux ou trois réglementations existantes pour toute nouvelle réglementation décidée par l’UE ou l’État. Le droit coutumier, la responsabilité civile et pénale et la concurrence normative ne devraient pas être négligés pour allier compétitivité et gestion des nuisances environnementales associées à l’agriculture.
Afin de compléter l’analyse de l’interventionnisme public dans l’agriculture, nous analysons en détail ses diverses subventions en partie 4, le contrôle des structures et de la transmission en partie 5 ainsi que certains organismes parapublics en partie 6 (chambres d’agriculture), 7 (interprofessions) et 8 (MSA).
Article initialement publié en mars 2018.
—


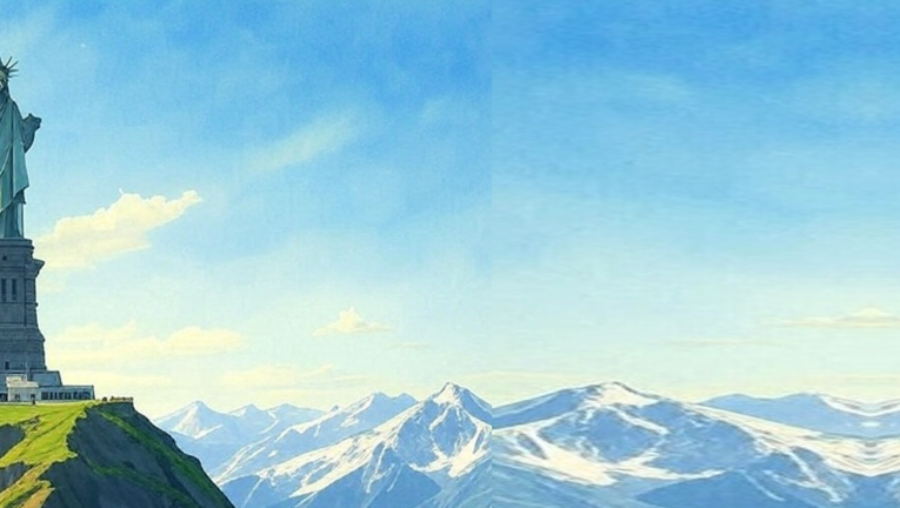


Bonjour, la question (en titre) semble sans réponse???
la réponse qui suinte de l’analyse sera probablement : dégraissons le “dinosaure”
Compte tenu du nombre de tiques sur la Bête; il est normal qu’elle se meure. Mais à la différence des Tiques, les fonctionnaires s’auto alimentent et prospèrent même sur un cadavre. Et la contamination s’étend à bien d’autres secteurs..
Tous les remugles règlementaristes du communisme soviétique (kolkhozes = coopératives obligatoires) entravent la paysannerie française y compris le maléfique crédit agricole !