Par Alain Goetzmann.

Il y a quelques semaines, Steve Blanck, l’un des fondateurs du Lean Start-Up, a publié dans le Quotidien du Peuple, un article dont je vous propose une synthèse.
Il y constate qu’au XXIème siècle, il est de plus en plus difficile, pour les grandes sociétés, d’engager des mutations disruptives. Les grandes ruptures des dernières années sont nées chez Tesla, Uber, Airbnb, Netflix, Google ou Facebook, entreprises qui n’existaient pas, il y a 15 ans.
Pourquoi les grandes entreprises ratent-elles le coche ?
Premièrement, elles fonctionnent dans une optique de maximisation de la valeur pour l’actionnaire. Leurs objectifs premiers sont le retour sur investissement et la valorisation boursière, ce qui est difficilement compatible avec un engagement à long terme dans l’innovation.
Deuxièmement, les dirigeants de ces grandes sociétés sont, en général, issus des secteurs de la finance, de la logistique ou de la production. Parfaits pour faire exécuter le modèle d’affaire existant dans l’entreprise, ils ne sont évidemment pas des révolutionnaires dans l’âme.
Intel constitue un exemple frappant de cette évolution. Ses deux derniers P-DG ont délivré beaucoup plus de profits qu’aucun de leurs prédécesseurs mais, malgré des dépenses de R & D importantes, celles-ci ont surtout été consacrées à optimiser les prix de leurs puces. Du coup, son leadership dans l’industrie se délite. Intel a raté deux virages importants : la migration rapide des PC vers les mobiles et la satisfaction des besoins en transfert de big data vers le cloud pour lesquels ils semblent aujourd’hui mal préparés. Ils viennent donc de licencier 12000 salariés, 11 % de leurs effectifs et ce n’est sans doute pas fini.
Troisièmement, dans l’explosion des nouvelles technologies, des plates-formes et des révolutions de marchés intervenues au cours des 15 dernières années, les grandes entreprises sont victimes de la lourdeur de leurs processus. Elles ont du mal à suivre la révolution des bio-technologies, de la santé prédictive, de l’intelligence artificielle et du basculement des grands marchés, tout particulièrement vers l’Asie.
Quatrièmement, les start-ups, qui sont les vrais responsables de ces disruptions, fragilisent désormais les grands groupes pour une autre raison majeure : leur financement. Jusqu’en 1975, quand l’argent était rare, seules les grandes entreprises avaient les moyens de consentir aux importantes dépenses de Recherches et Développement. Aujourd’hui, les capitaux-risqueurs sont à l’affût de toute idée initiée par les start-ups – et l’imagination est sans limite – car le retour sur investissement est devenu énorme grâce aux introductions en bourse ou à leur cession potentielle à un grand groupe.
Libérées de tout objectif de retour sur investissement à court terme, les start-ups ne sont pas embarrassées des modèles d’affaire conventionnels. Leur unique objectif est de faire aboutir leur projet. Pour y parvenir, sans brûler inconsidérément le cash fourni par les capitaux-risqueurs, elles agissent dans l’urgence et n’attendent pas forcément toutes les informations pour prendre une décision. Plus proches du client, elles appréhendent beaucoup mieux ses besoins et pivotent régulièrement pour adapter leur offre. Elles sont agiles et savent motiver leurs fondateurs et collaborateurs.
C’est donc un nouveau monde des affaires qui se dessine aujourd’hui : de grandes entreprises capables de gérer et de faire évoluer des activités existantes, domaines dans lequel elles sont plutôt bonnes et des start-ups reposant sur l’entrepreneuriat pour révolutionner les marchés.
Finalement, les deux se complètent. L’exemple ultime ? Google a déjà acheté plus de 160 sociétés au cours des 10 années passées.
—

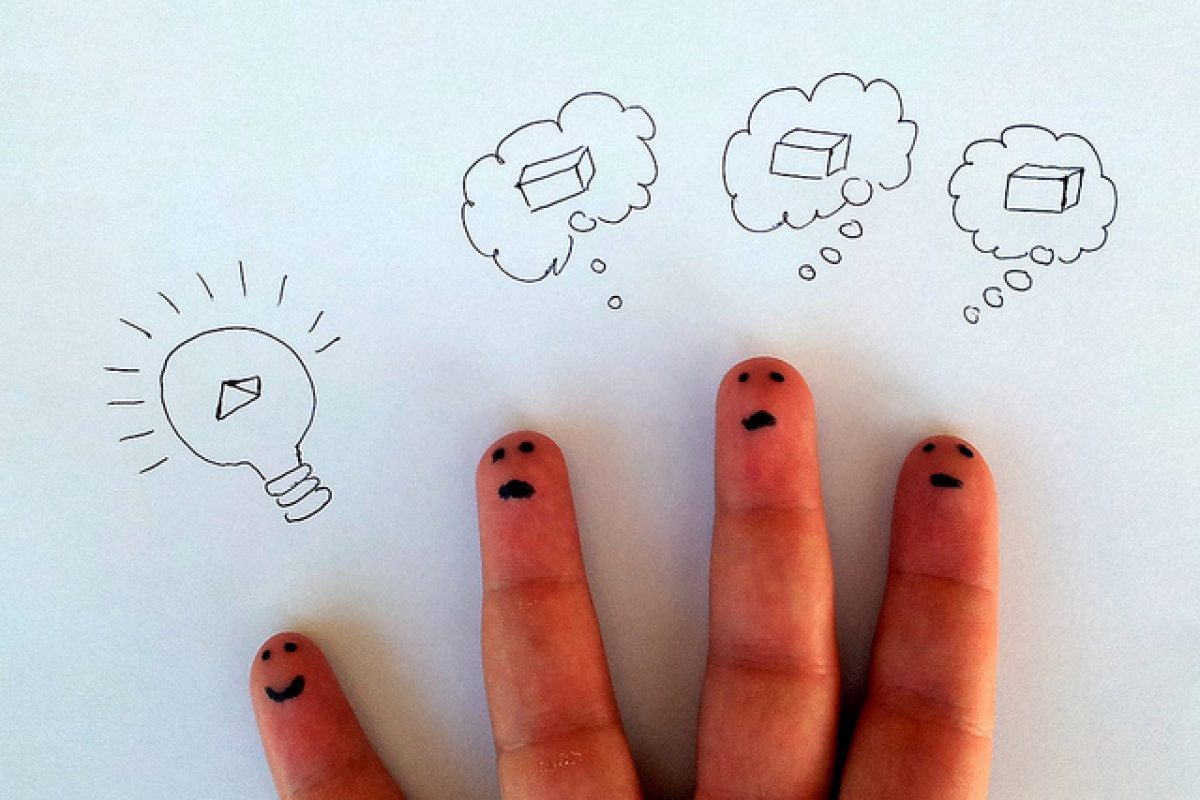



“les dirigeants des grandes sociétés sont, en général, issus des secteurs de la finance, etc… Parfaits pour faire exécuter le modèle d’affaire,..ne sont évidemment pas des révolutionnaires dans l’âme”… Hein ? Quoi ? les bras m’en tombent, tellement le propos est simple et stupide !
“les start up qui ne sont pas embarrassées par les modèles d’affaires, qui ont pour unique objectif de faire aboutir leur projet, sans brûler inconsiderablement le cash des CR”… ah bon ? Les start up sont assimilées à des “organismes de charité” ?
J’arrete… revoyez votre analyse car cet article, au temps des notes à l’école vous aurait probablement pas valu plus que 0.
Pourriez-vous expliquer très en profondeur votre propos ? Développez votre propos critique au lieu de juger.