Par Jean Senié.
 Souvent décrit comme le parangon de la chambre conservatrice obnubilée par des problèmes liés à la ruralité, le Sénat n’a pas bonne presse. Ce désamour – il serait peut-être plus juste de parler de désintérêt – ne date pas d’aujourd’hui. C’était déjà le cas sous la Troisième République où se reposait de manière périodique la question de son utilité, cache-sexe pudique pour évoquer sa possible suppression1. C’est justement sur la période troublée de l’entre-deux-guerres que Gisèle Berstein, spécialiste de la Troisième République2, a décidé de porter la focale. Elle livre ainsi une étude historique sur le Sénat sous la Troisième République qui constituera à l’avenir un outil indispensable pour tout lecteur désirant s’intéresser à la vie politique et institutionnelle de cette période3.
Souvent décrit comme le parangon de la chambre conservatrice obnubilée par des problèmes liés à la ruralité, le Sénat n’a pas bonne presse. Ce désamour – il serait peut-être plus juste de parler de désintérêt – ne date pas d’aujourd’hui. C’était déjà le cas sous la Troisième République où se reposait de manière périodique la question de son utilité, cache-sexe pudique pour évoquer sa possible suppression1. C’est justement sur la période troublée de l’entre-deux-guerres que Gisèle Berstein, spécialiste de la Troisième République2, a décidé de porter la focale. Elle livre ainsi une étude historique sur le Sénat sous la Troisième République qui constituera à l’avenir un outil indispensable pour tout lecteur désirant s’intéresser à la vie politique et institutionnelle de cette période3.
Une approche exhaustive
L’ouvrage se divise en trois parties. La première est consacrée aux sénateurs et à leur carrière, ce qui implique aussi un éclairage sur les partis présents au Sénat. La seconde décrit le fonctionnement de l’institution en précisant à chaque fois les compétences des commissions. On notera ici, mais cette remarque vaut pour l’ensemble du livre, l’important travail d’exhumation des archives de la part de l’auteur qui alterne judicieusement l’usage des comptes-rendus des débats par le Journal officiel et celui des archives des commissions sénatoriales. La troisième partie est consacrée aux grands thèmes qu’ont eu à traiter les sénateurs entre 1920 et 1940 et que l’auteur ramène à trois grands traits, à savoir la défense d’une République laïque, l’affirmation d’une politique libérale tempérée par un État modérément interventionniste et les questions de la défense du territoire national.
La défense de la République laïque se cristallise au moment des débats autour des modalités de la réintégration de l’Alsace Lorraine et de la reprise des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Le Sénat étant majoritairement peuplé de radicaux imprégnés des idéaux laïcs cristallisés au moment de la lutte autour de la loi de séparation de l’Église et de l’État, ces questions sont particulièrement sensibles. Pour autant, sur ces sujets, les sénateurs font preuve de modération, conscients qu’ils ne doivent pas rouvrir les plaies dans un contexte national encore difficile. Gisèle Berstein fait d’ailleurs remarquer que cette aptitude à la conciliation fonde l’essence même de la pratique politique des sénateurs.
Sur le plan économique et politique, les sénateurs se tiennent à distance de toute atteinte à la propriété individuelle et défendent l’intervention de l’État mais pour des sujets bien ciblés. Cela explique l’opposition progressive des sénateurs radicaux aux gouvernements Blum pendant le Front populaire. Cela explique aussi le refus de soutenir Tardieu et Laval en 1930 et 1931 par rejet de l’autoritarisme.
Enfin, les débats sur la défense occupent une place centrale. L’auteur revient à cette occasion sur un vieux préjugé qui voudrait que les élites françaises n’aient jamais pris la mesure d’un réarmement nécessaire. Les débats des commissions et des intercommissions révèlent l’inverse. On peut à cet égard citer Gisèle Berstein : « dans les années précédant le conflit [Deuxième Guerre mondiale], l’idée fréquemment répandue selon laquelle le Parlement aurait empêché le gouvernement de gouverner s’avère fausse, du moins pour le Sénat, concernant les questions de Défense nationale. L’examen des réalités conduit au contraire à considérer que, dans ce domaine, c’est le gouvernement qui a entravé la mission de contrôle de la Haute-Assemblée ». 4
Défense et illustration du Sénat
L’auteur ne passe pas sous silence les réticences des sénateurs pour certains projets qui nous apparaissent pourtant devoir être défendus par une majorité de gauche, ou de centre-gauche, comme l’est celle que constitue le groupe de la Gauche démocratique au Sénat. Pourtant, l’enterrement du droit de vote des femmes est bien le fait des sénateurs5. Même si l’auteur restitue avec finesse le contexte politique des débats et les raisons qui expliquent la prudence des sénateurs on ne peut manquer d’y voir un trait du conservatisme d’une assemblée d’hommes dont la moyenne d’âge dépasse la soixantaine.
Hormis cette ombre au tableau, le portrait que l’auteur dresse du Sénat est pour le moins flatteur. Il se situe à distance des attaques dont fait généralement l’objet cette Haute-assemblée. Si Gisèle Berstein insiste à juste titre sur la qualité du travail sénatorial et sur la pertinence des amendements, elle n’en présente pas moins une vision qui peut sembler par certains aspects trop édulcorée6. Reste donc au lecteur à faire la part des choses entre l’indéniable légende noire du Sénat, mise systématiquement à mal, et l’indéniable conservatisme d’une chambre qui n’arrive plus dans un contexte trouble à jouer son rôle. L’avis aurait ainsi pu être davantage balancé.
Une histoire politique classique, trop classique
Ce sentiment est renforcé par les choix historiographiques de l’auteur. L’ouvrage se présente comme une étude, savante et complète, d’une institution politique. Plusieurs points auraient pourtant mérité un autre traitement. D’une part, le lecteur peu familier avec l’histoire politique de la Troisième République risque de se noyer dans les successions de noms et de faits, même si l’écriture se veut didactique et fait un gros effort de pédagogie, notamment lors de la description du fonctionnement de l’assemblée. D’autre part, l’auteur ne réinscrit jamais son objet d’enquête dans le champ des cultures politiques, dans celui des sensibilités politiques, ni même dans celui de l’histoire des idées.
Le lecteur peut alors se retrouver frustré devant une histoire événementielle de qualité mais qui ne lui apporte peut être pas tous les éléments pour se faire une opinion sur le Sénat. Quoi qu’il en soit, Gisèle Berstein signe ici un livre indispensable pour toute personne s’intéressant à la vie politique de l’entre-deux-guerres.
- Gisèle Berstein, Le Sénat sous la IIIe République (1920-1940), Paris, CNRS éditions, 2014
—
Sur le web
- Paul Smith, A history of the French Senate, The Third Republic 1870-1940, vol. I, New York, The Edwin Mellen Press, 2005. ; Karen Fiorentino, La seconde chambre en France dans l’histoire des institutions et des idées politiques (1789-1940), Paris, Dalloz, 2008. ↩
- Gisèle Berstein et Serge Berstein, La Troisième République, Paris, M.A. Éditions, 1987. ↩
- Gisèle Berstein, Le Sénat sous la IIIe République (1920-1940), Paris, CNRS éditions, 2014. ↩
- Ibid., p. 440. ↩
- Ibid., p. 245-246. ↩
- Ibid., p. 468. ↩

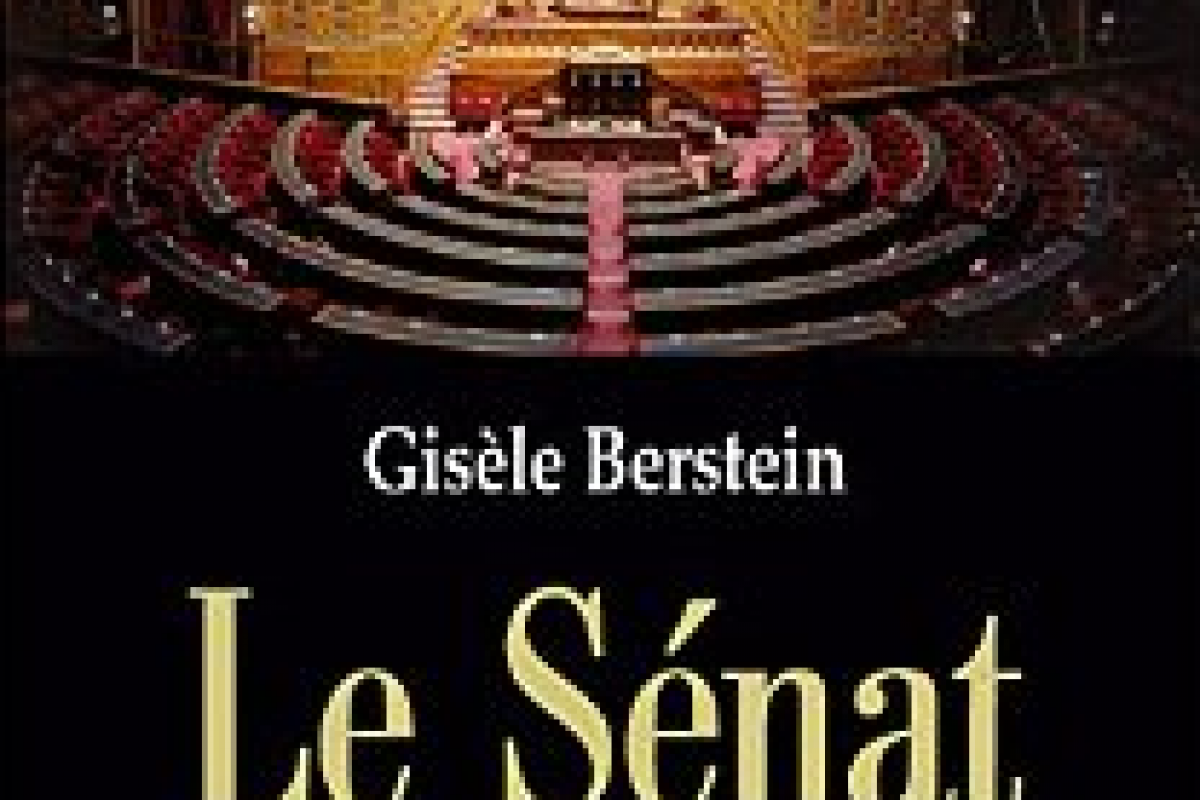



Laisser un commentaire
Créer un compte