Par Johan Rivalland
Je retombe un peu par hasard sur un commentaire de livre que j’ai écrit il y a maintenant neuf ans presque jour pour jour. En plein débat sur la question et au cœur de l’actualité en ce mois de janvier 2015, voici ce que j’écrivais. Il est frappant de constater, une fois de plus, qu’il n’y a pas un mot à changer… (Reconnaissons, au passage, que la plupart des enseignants savent faire la part des choses et assurent très bien leur métier au quotidien, dans des conditions pas toujours faciles, loin de là).
 Dans ma critique sur La désinformation par l’Éducation Nationale de Christine Champion, je remarquais que, malgré la qualité de l’ouvrage, je restais un peu sur ma faim car j’aurais souhaité avoir au moins une partie du livre consacrée à l’étude des manuels scolaires. Voici mon vœu exaucé, et même au-delà car l’ouvrage de Barbara Lefebvre et Ève Bonnivard est fort bien traité et très rigoureusement mené, sans parti pris politique ou quelconque approximation.
Dans ma critique sur La désinformation par l’Éducation Nationale de Christine Champion, je remarquais que, malgré la qualité de l’ouvrage, je restais un peu sur ma faim car j’aurais souhaité avoir au moins une partie du livre consacrée à l’étude des manuels scolaires. Voici mon vœu exaucé, et même au-delà car l’ouvrage de Barbara Lefebvre et Ève Bonnivard est fort bien traité et très rigoureusement mené, sans parti pris politique ou quelconque approximation.
Les manuels scolaires décryptés
Reprenant les propos cités dans les ouvrages scolaires d’histoire de collège et de lycée, les deux auteurs se livrent à une analyse des messages transmis aux élèves, non exempts on s’en doutait malheureusement d’a priori idéologiques ou d’« à peu près » indignes de manuels destinés à instruire la jeunesse.
Ainsi en va-t-il des événements du 11 Septembre 2001, traités avec un fascinant simplisme. Les morts y sont la plupart du temps oubliés et les attentats réduits à un seul (Trade Center), omettant en particulier le courage des passagers du vol 93 à destination de la Pennsylvanie. Les élèves sont conduits par les questions relatives aux documents à paraphraser, dans certains cas, les discours de Ben Laden, voire à les légitimer en partie. Trop souvent, une « avalanche d’approximations » ne permet aucun recul aux élèves, les empêchant de réfléchir à la réelle portée du terrorisme. Certains manuels expliquent par exemple à l’élève que le terrorisme islamiste s’appuie sur “les humiliations subies par le monde musulman”, sans autre forme de distanciation.
De trop nombreux parti-pris
Le chapitre sur la manière dont sont présentés les États-Unis est lui aussi hélas sans surprise. Le parti-pris résolument anti-américain n’y est aucunement mesuré, le monde y étant présenté comme entièrement soumis à l’arbitraire de cette entité qualifiée de super-puissance. Pacifisme, théorie du complot et autres accusations d’impérialisme aux contours mal définis s’y enchaînent, tout comme les caricatures du Monde, faisant office de document de réflexion, sans aucun sens de la nuance et ne permettant pas véritablement aux élèves le recul nécessaire à la compréhension des événements.
La mondialisation y est à son tour vilipendée et présentée comme l’œuvre de la puissance américaine, conduisant à une uniformisation planétaire supposée. Ce faisant, elle se trouve dénuée de toute historicité et rendue coupable de tous les maux.
Qui élabore les manuels scolaires ?
Devant tant d’outrecuidance, d’excès de mauvaise foi, de manque de scrupules et une si faible rigueur factuelle sur de nombreux autres sujets, de la part de ces manuels scolaires, les deux auteurs en viennent à se poser la question suivante (p.167) : “L’école forme-t-elle une opinion publique ou des individus libres de penser par eux-mêmes ?”
Un peu plus loin, Barbara Lefebvre et Ève Bonnivard expliquent les ressorts de la conception de ces manuels scolaires, en posant des questions qui intéresseront les lecteurs (Qui sont les auteurs ? Qui élabore les programmes ? Qui exerce un contrôle sur le contenu de ces manuels ?…) et se posent la question de l’opportunité d’y traiter l’actualité très récente.
Au total, cet ouvrage montre bien que les exemples abondent de ces parti-pris idéologiques, répandus à différents degrés chez l’ensemble des éditeurs et il faut lire l’ouvrage pour en avoir un aperçu très significatif. On pourrait d’ailleurs imaginer la sortie d’autres ouvrages sur le sujet, car il n’y a pas qu’en histoire que l’on trouve un tel manque de neutralité et de distance idéologique. Avis aux amateurs…
- Barbara Lefebvre et Ève Bonnivard, Élèves sous influence, Louis Audibert Editions, octobre 2005, 361 pages.

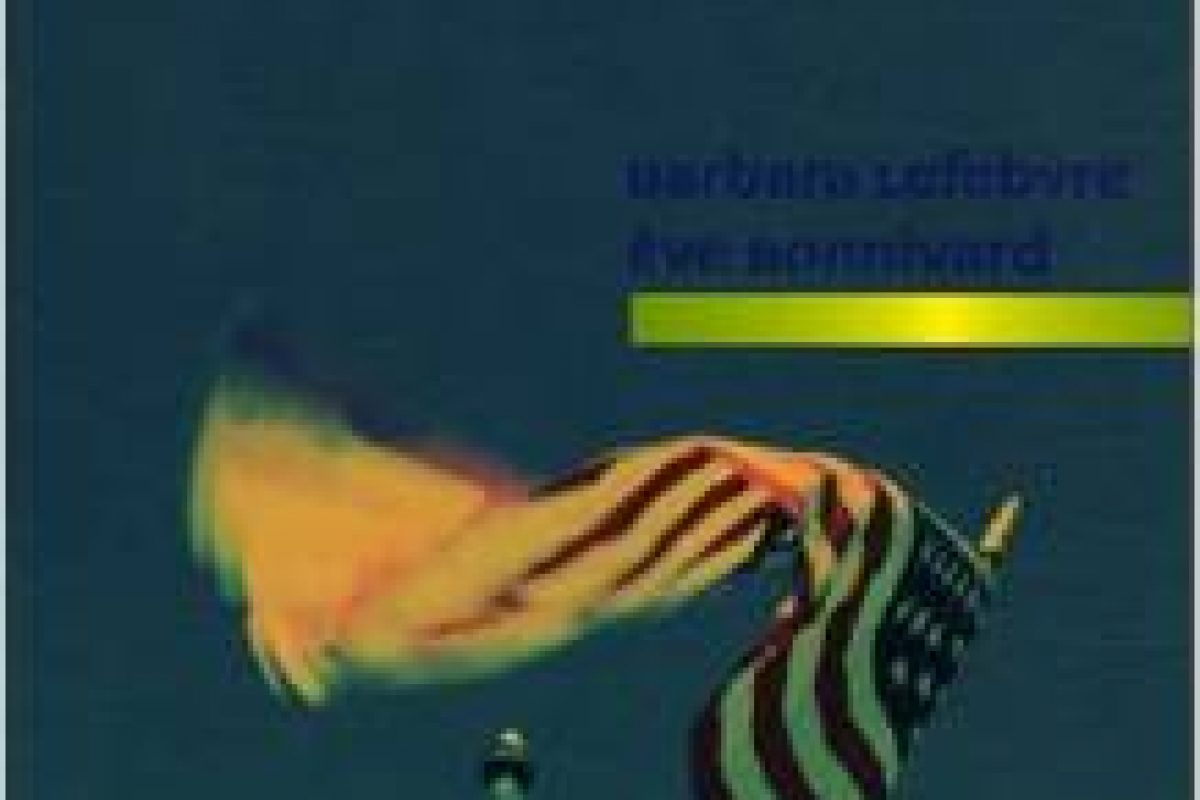
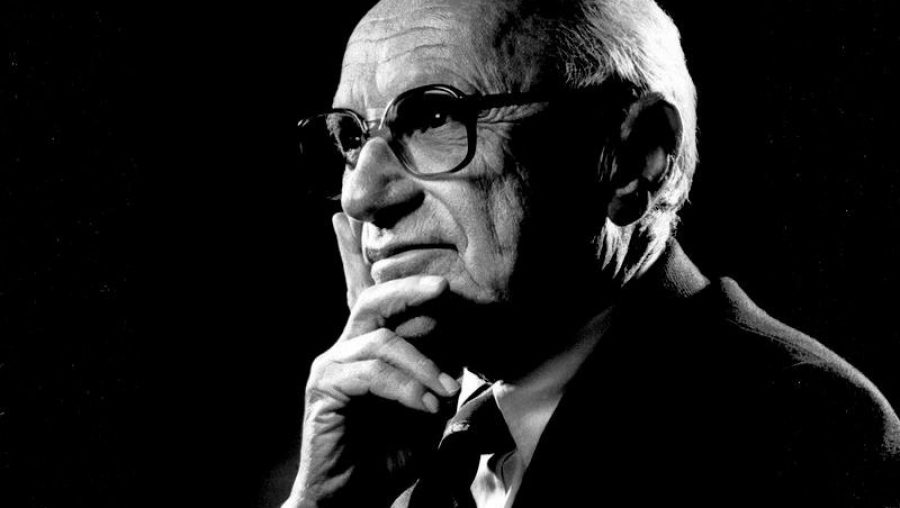


c’est aussi la rançon de la centralisation de l’Educ nat.
Et avec cela on arrive à crainde pour notre exception culturelle…