Les paradoxes made in France relevés par la presse internationale sont nombreux. Ils sont économiques, prévisionnels, culturels. La France, si décriée par les observateurs extérieurs, pourrait y puiser une certaine source d’ardeur et un regain d’optimisme, à condition de les apprécier pertinemment.
Par Benjamin Boscher
Un article de Trop Libre
« Il n’y a nul pays au monde où l’on trouve tant de contradictions qu’en France ». Cette assertion sans ambages est signée Voltaire. Si la vérifier relève de l’argutie, l’actualité semble cependant l’attester pour partie. En effet, les paradoxes made in France relevés par la presse internationale sont multiples.
Paradoxe économique
Alors que certaines agences de notation financière menacent d’abaisser prochainement d’un cran la note de la France – en raison des prévisions budgétaires captieuses et de l’absence de réformes structurelles portées par le gouvernement –, le taux d’emprunt à 10 ans de la France n’a jamais été aussi bas sur le marché, à 1,195%. Comme le note le magazine américain Foreign Policy, fondé par Samuel Huntington, “les marchés financiers perçoivent la solvabilité de la France et de l’Allemagne avec similitude en dépit du fait que l’économie allemande, plus compétitive et davantage orientée vers l’exportation, a toujours été considérée comme un modèle pour le reste de l’Europe et que la France est désormais perçue comme le maillon faible de la zone euro”.
En réalité, ce paradoxe est davantage lié à l’importante propension d’investisseurs étrangers à être présents sur le marché des obligations du gouvernement français, qu’aux déclarations entichées du Premier ministre au monde de l’entreprise. Ainsi, Foreign Policy s’interroge à juste titre sur la fiabilité et la résilience à moyen terme du marché obligataire français et se demande combien de temps encore l’Allemagne s’accommodera d’une France Politique couarde, peu encline aux réformes globales, structurelles et audacieuses.
Paradoxe prévisionnel
La presse internationale s’attarde sur les difficultés économiques que rencontre la France, sur la défiance qu’elle suscite, sur les carences qu’elle tarde à amender, comme l’illustre la récente chronique du Daily Telegraph britannique “Comment la France a fait pour aller si mal ?”
Paradoxalement, ce même journal a également relayé les travaux d’experts allemands qui affirment que la France sera économiquement plus puissante que l’Allemagne dans 10 ans. Le développement de l’économie allemande, axée sur le commerce extérieur, le dogme mercantile et la glorification de l’épargne, serait en passe de s’amenuiser durablement. Sa demande extérieure se contracte, sa croissance prévisionnelle est en baisse (1,3% sur l’année 2014 au lieu de 1,9%), ses salaires se compriment, ses inégalités sociales s’accroissent, sa démographie décline implacablement et ses investissements publics sont trop frêles. La France devant l’Allemagne dans 10 ans, vraiment ? “Un paradoxe doit être le moyen le plus tranchant et le plus efficace de transmettre la vérité aux endormis et aux distraits.” Puisse cette citation de Miguel de Unamuno être relue !
Car pour devenir le leader économique de l’Europe, la France a encore tant à accomplir : achever les réformes internes qui permettront à sa vieille économie d’affronter les contraintes de la mondialisation, escorter la révolution numérique et digitale qui réinvente tous les processus de production et d’innovation, renouveler inévitablement sa doctrine économique qui doit être plus libre, plus juste, plus connectée et populaire, établir avec ses partenaires européens une entente moderne, non-clanique, intensément réformatrice, fidèle à l’Europe.
Paradoxe culturel
“La France est finie ! Partez au plus vite ! Quittez ce pays sclérosé, désespéré et abattu !” Ces mots – cette raillerie – sont ceux prêtés à John Lewis, influent patron anglais, au cours du dernier Congrès mondial de la vente. Comme l’a confié Charles Bremner au Courrier international, correspondant à Paris du quotidien The Times, “les britanniques sont fascinés par la France, l’adversaire ancestral. Il y a entre les deux pays de la rivalité, de l’admiration, mais aussi de la jalousie. Ce type de déclarations obsessionnelles ressort assez régulièrement de l’autre côté de la Manche.”
Ces joutes de french-bashing, devenues cosmopolites et tendances, n’ont cependant pas entravé l’attribution des prix Nobel de littérature et d’économie à deux français, Patrick Modiano et Jean Tirole. L’excellence française est ainsi mise en avant, à l’honneur, à la portée du plus grand nombre et constitue une réponse – parmi d’autres plus engageantes naturellement – délicieuse et opportune aux apôtres et rhéteurs malveillants du déclin national. Cependant, l’éditorial du New York Times à ce sujet rapporte que “dans un pays où l’insatisfaction se porte comme un accessoire, certains intellectuels, économistes et autres polémistes ont salué ces prix d’un haussement d’épaules alors que l’économie chancelle” et que “si la France reste une grande culture, elle est néanmoins économiquement et politiquement à plat”. Quant à l’art du French bashing, le journal conclut non sans persiflage par les mots du journaliste britannique Peter Gumbel : “les Français sont eux-mêmes les plus grands adeptes de l’auto-dénigrement”.
Selon Oscar Wilde1, le chemin de la vérité est celui du paradoxe : une corde raide sur laquelle la vérité vacille et devient acrobate, où nous pouvons la contempler et la juger. S’il dit vrai, il semblerait que pour la France, à cette heure, celui-ci s’assimile à un interminable chemin de crête… !
—
Sur le web.
- Oscar Wilde, Les Ailes du paradoxe (1996). ↩



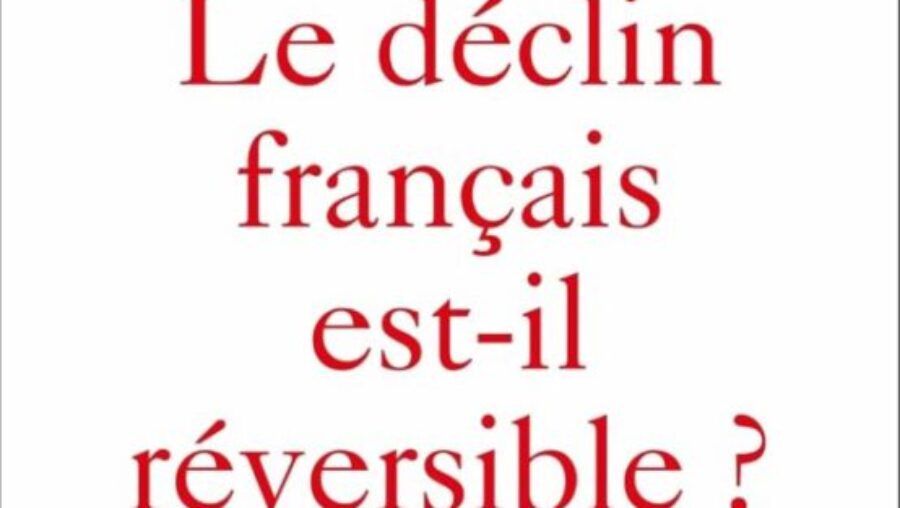

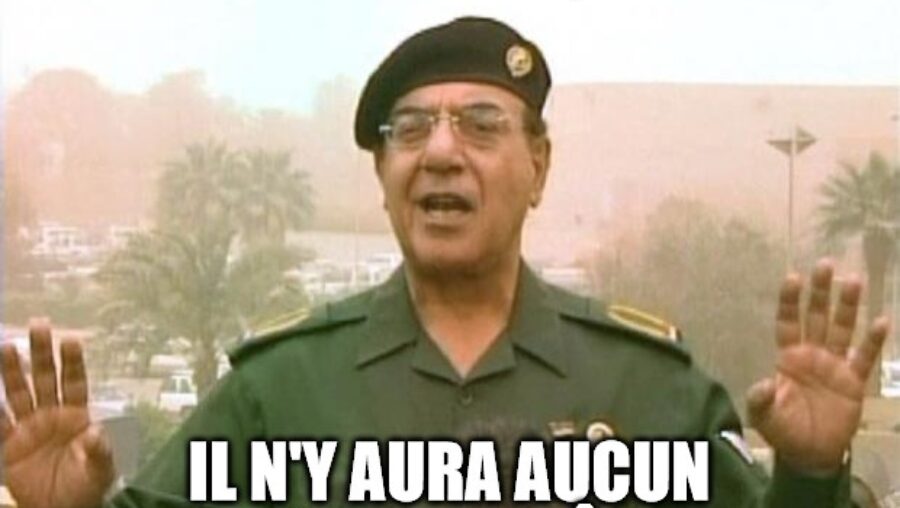
Laisser un commentaire
Créer un compte