Comme il ne pouvait en être autrement, l’illustre Paul Krugman revient à la charge contre la (feinte) austérité des gouvernements européens, qui serait en train d’étrangler les économies occidentales.
Par Juan Ramón Rallo, depuis Madrid, Espagne
 Un vrai coup de génie, cette austérité falsifiée, que la très efficace propagande étatique a réussi à nous vendre à nous, les libéraux, y compris nous qui avons l’habitude de regarder les chiffres et sommes conscients de nous trouver devant une des plus grandes opérations de manipulation du dernier lustre.
Un vrai coup de génie, cette austérité falsifiée, que la très efficace propagande étatique a réussi à nous vendre à nous, les libéraux, y compris nous qui avons l’habitude de regarder les chiffres et sommes conscients de nous trouver devant une des plus grandes opérations de manipulation du dernier lustre.
Parce que, en fin de compte, ce qui importe en politique n’est pas la vérité, mais la perception sociale de cette vérité. Et, par malheur, la majorité des citoyens ont mordu à l’hameçon selon lequel la récession serait le fruit de gouvernements extrêmement austères, raison pour laquelle nous devons à nouveau nous endetter à des rythmes insoutenables. Mais a-t-on jamais cessé de s’endetter à des rythmes insoutenables ne serait-ce qu’un mois, une semaine, un jour ?
Prenons l’exemple qui inspire l’article de Krugman [1] : le cas du Royaume-Uni de David Cameron. Selon le Nobel, après les coupes appliquées par le Premier ministre et son Chancelier de l’Échiquier, George Osborne, l’économie est en train de croître à un rythme inférieur à celui enregistré… pendant la Grande Dépression des années 30 (!) quand dominait la sensée pensée keynésienne et que furent appliqués des plans de relance de la demande beaucoup plus importants que les actuels. Pour s’en convaincre, il suffit de jeter un coup d’œil sur ce graphique, élaboré par un think tank anglais
La même chose semble en train d’être vécu en Espagne ou en Italie, où les coupes auraient propulsé l’économie contre les cordes. Ni l’Espagne, ni l’Italie n’ont rempli leurs objectifs de déficit pour 2011, mais peut-être aurions nous été exagérément austères, peut-être les coupes ne peuvent déprimer à l’excès des économies qui dépendent de la croissance pour créer de l’emploi ?
De fait, comme Krugman lui-même l’exposa dans un autre article il y a quelques semaines [2], il ne convient pas d’être obsédé par le remboursement de la dette. Les dettes, en réalité, ne se paient pas ! Celles de la IIe Guerre mondiale ne furent jamais amorties, elles cessèrent simplement d’être pertinentes face à une économie, l’américaine, qui entrait en expansion à la vitesse de croisière… grâce à ces mêmes dettes. La logique voudrait, donc, de ne plus se préoccuper de l’effet de levier de nos sociétés et nous concentrer pour nous endetter plus et plus pour, au final, mettre en marche le pilote automatique de la croissance et ce qui nous semble aujourd’hui comme de gigantesques et impayables dettes seront demain de la menue monnaie facile à assumer. Le slogan du Nobel, acheté par une bonne partie de l’Occident social-démocrate, est assez clair : « Ne soyons pas stupides : les dettes ne se paient jamais et l’austérité tue. »
Bon, pour commencer, plaçons certaines données en quarantaine. Il est vrai que le rythme de récupération du Royaume-Uni est plus lent que lors de la Grande Dépression si on le mesure en termes réels (en décomptant l’inflation), mais pas si on mesure en termes nominaux. Personnellement, évidemment, je préfère ne pas confondre l’avilissement de la monnaie avec la création de richesse, de sorte que j’opterais pour la variable réelle, mais certains keynésiens et pas mal de monétaristes préfèrent le piège inflationniste, de sorte que pour eux le Royaume-Uni serait en train de récupérer plus vite qu’il y a 80 ans.
Dans tous les cas, admettons la stagnation de l’économie britannique. Faut-il l’attribuer aux coupes d’Osborne, comme le prêche Krugman ? Pas du tout. On a beaucoup parlé du fait que ce dernier a approuvé des réductions de dépenses pour un montant de £81 milliards ; pas mal, si on tient compte du fait que le budget 2009 était doté de £671 milliards. Quel est le problème ? Qu’il ne s’agissait pas d’une réduction par rapport au budget de 2009, mais par rapport à l’augmentation des dépenses du lustre suivant dans le cas où cette coupe n’aurait pas été approuvée. Résultat : les dépenses publiques en 2010 furent de £697 milliards et en 2011, année d’extrême et déprimante austérité selon Krugman, de £710 milliards (si on ne tient pas compte des dépenses financières, les dépenses seraient passées de £641 milliards en 2009 à £660 milliards en 2011). La timide diminution du déficit vécue depuis 2009 (qui est passé de quelques £150 milliards à £130 milliards, c’est-à-dire de 11% du PIB à 9%) ne fut pas dû à une diminution nette des dépenses, mais à l’augmentation des recettes. Austérité publique ? Où ?
Bien entendu, les keynésiens pourraient arguer qu’effectivement le déficit total du gouvernement britannique en relation avec le reste de l’économie s’est légèrement réduit – si la perception augmente, l’exécutif aurait dû augmenter encore plus les dépenses pour maintenir son rythme d’endettement en relation au PIB –, ce qui, à la différence de ce qui se passa durant les keynésiennes années 30, serait en train de plomber la croissance économique. Vraiment ? Voyons les chiffres : l’économie anglaise augmenta de manière ininterrompue son PIB réel de 42% entre 1931 et 1940. Un grand succès des politiques keynésiennes de relance de la demande, non ? Mais non. Savez-vous quel fût le déficit public maximum tout au long de la décade ? Un 5% (en 1933). De fait, dans cinq de ces dix ans, le Trésor britannique enregistra un excédent budgétaire ou un déficit inférieur à 0,5%, ce qui a permis à la dette qui avait commencé en 1931 à £7,46 milliards de terminer en 1940 à £7,9 milliards (les dépenses publiques, par exemple, furent gelées de facto jusqu’au début de la guerre, en 1939). Résultats pas trop différents, il est vrai, de ceux que livrerait une analyse sommaire de la décade des années 30 aux États-Unis, celle où le prodigieux New Deal keynésien aurait empêché la chute dans l’abîme. Le déficit le plus élevé qu’approuva jamais Roosevelt à cette époque fut de 4,76%, en 1936. Les autres années, le déficit tourna autour ou en-dessous des 3% ; mais c’est que Roosevelt aurait passé le pacte de stabilité et de croissance de l’Union européenne.
Dès lors, comment attribuer le relatif succès (ou américain) aux politiques keynésiennes, quand le déficit maximum qui fut expérimenté était pratiquement la moitié de celui de 2011, l’année où, selon, Krugman, furent pratiquées de sauvages coupes entraînant la contraction ? Comment dire que le Royaume-Uni eût recours à de forts déficits publics qui permirent d’asseoir la récupération, quand ceux-ci diminuèrent de manière accélérée à partir de 1933, jusqu’au point qu’en 1935 et 1936 Londres eût deux excédents budgétaires ?
 La mauvaise foi et l’hypocrisie de Krugman sont sans bornes. S’il y a un pays européen qui est en train d’appliquer à la lettre les idées keynésiennes, c’est sans doute le Royaume-Uni : déficits publics très élevés et soutenus durant plusieurs exercices, monétisation massive de la dette publique de la part de la Banque d’Angleterre, hauts taux d’inflation (depuis le début de 2009, les prix ont augmenté de plus de 10%) et substantielle dépréciation de devise (depuis fin 2007, la livre a perdu 20% de sa valeur face au dollar et à l’euro). Et quand toutes ces absurdités échouent lamentablement, à qui la faute ? Aux politiques d’austérité qui ne diminuent pas les dépenses, mais évitent seulement qu’elles n’augmentent aussi rapidement que prévu !
La mauvaise foi et l’hypocrisie de Krugman sont sans bornes. S’il y a un pays européen qui est en train d’appliquer à la lettre les idées keynésiennes, c’est sans doute le Royaume-Uni : déficits publics très élevés et soutenus durant plusieurs exercices, monétisation massive de la dette publique de la part de la Banque d’Angleterre, hauts taux d’inflation (depuis le début de 2009, les prix ont augmenté de plus de 10%) et substantielle dépréciation de devise (depuis fin 2007, la livre a perdu 20% de sa valeur face au dollar et à l’euro). Et quand toutes ces absurdités échouent lamentablement, à qui la faute ? Aux politiques d’austérité qui ne diminuent pas les dépenses, mais évitent seulement qu’elles n’augmentent aussi rapidement que prévu !
On retrouve peu ou prou la même chose avec les énormes passifs accumulés par les USA durant la IIe Guerre mondiale, cette dette qu’il ne faut pas payer semblerait-il, selon l’américain. En vérité, j’aimerais savoir ce que veut dire Krugman par ne pas payer, car je n’ai pas connaissance que les USA aient répudié une fois, formellement, leur dette (en fait, oui, ils le firent avec la dette basée sur l’or, après la rupture de Bretton Woods, mais c’est une autre histoire). Si Krugman veut dire qu’à partir de 1945, le gouvernement américain put continuer à s’endetter sans problèmes à des rythmes très élevés grâce au fait que la nouvelle croissance servait à couvrir et garantir largement les nouvelles émissions de dette, c’est faux. La guerre terminée, les États-Unis réduisirent en deux ans leur déficit public depuis des niveaux proches des 25% du PIB jusqu’à… un excédent budgétaire de 1,32% en 1947 et de 4,3% en 1948. Beaucoup de keynésiens pronostiquèrent alors une débâcle, un retour à la Grande Dépression, qui, évidemment, ne se produisit jamais, malgré le fait que le pays ne connut plus un déficit supérieur à 2% durant les 25 années suivantes, étant habituel que son déficit se situât à 0,5% et qu’il fût compensé par des excédents budgétaires supérieurs à 1% pendant plusieurs exercices.
De fait, en décomptant les effets de l’inflation, le niveau – non pas le poids sur le PIB, mais bien le niveau – total de la dette publique américaine était en 1975 inférieur à celui de 1946, bien que le PIB avait été multiplié presque par trois en termes réels (en termes nominaux, elle augmenta de 165%, alors que l’économie atteint 640%). Congeler son rythme d’endettement tandis que l’on crée beaucoup plus de richesses qu’avant, n’est-ce pas là une manière de payer avec largesse sa dette ? Amortir la dette ne signifie pas la réduire à zéro (aucune grande entreprise ne fait cela), mais être en position d’honorer ses paiements présents et futurs avec ponctualité.
Bien entendu, Krugman nous dira que, de toute manière, la réduction de la dette après la IIe Guerre mondiale ne fut pas la condition pour recommencer à croître, que la prospérité arriva malgré la montagne de dette qu’accumulait l’économie américaine. Et c’est vrai, aussi vrai que la croissance fut accompagnée et consolidée par une réduction du déficit public en deux ans de 25% du PIB, qui rendit crédible l’idée que le gouvernement puisse amortir toute la dette qu’il avait accumulé auparavant. Personne ne demande aujourd’hui à l’Espagne ou au Royaume-Uni qu’ils réduisent leur dette publique de moitié, mais qu’ils mettent fin à la saignée de leur déficit et démontrent qu’ils peuvent amortir leur dette à long terme. Ce qui est absurde est de soutenir qu’une coupe minime de deux points sur le PIB du déficit – résultant en plus d’une augmentation des recettes – est ce qui a coulé le Royaume-Uni.
À d’autres ! Le Royaume-Uni, comme le reste de l’Europe, a un problème d’excès de dette… et de manque de confiance des marchés dans leur disposition à la réduire. Les banques européennes continuent d’être insuffisamment capitalisées, les marchés hyper-régulés n’en finissent pas de se réorganiser et les gouvernements européens accumulent des déficits publics structurels qui absorbent les rares épargnes que génèrent les secteurs privés de leurs pays respectifs pour financer la récupération de leurs économies. En conséquence de quoi, l’euro menace depuis deux ans de se briser à n’importe quel moment, ce qui détruirait non seulement les économies du continent, amis aussi la britannique. Quelqu’un regretterait-il le marasme dans l’investissement ? Moi pas ; mais, penser, à l’encontre de l’évidence théorique et empirique, que pour sortir de celui-ci, il suffit de redoubler le rythme de l’endettement de nos États n’est pas seulement manifestement irresponsable, mais extrêmement dangereux.
Notes :
[1] Paul Krugman, “The Austerity Debacle”, The New York Times, le 29.01.2012.
[2] Paul Krugman, “Nobody Understands Debt”, The New York Times, le 01.01.2012.
Lire aussi l’analyse critique de Pierre-Yves Saint-Onge publiée dans nos colonnes.


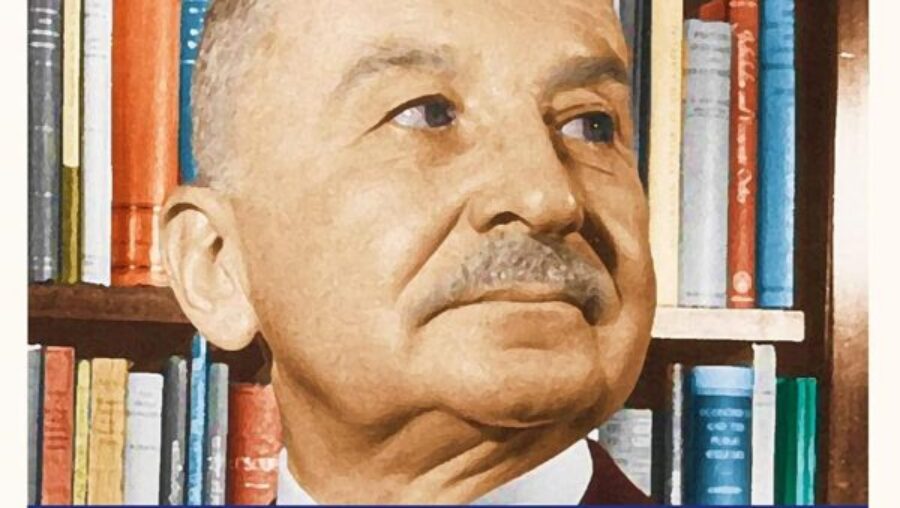

Absolument RT @vbenard: Qu’on se le dise: Paul Krugman est un crétin http://t.co/JDsFhHbs
Le faible déficit durant le “new deal” ne serait-il pas du à des dépenses publics élevées qui auraient, en relançant l’économie, provoqué de fortes rentrées fiscales ?
Je me demande surtout comment cela se fait-il que le déficit fut si faible pendant la crise de 29… Si quelqu’un pouvait m’éclairer !
Le New Deal a été une catastrophe. Sans résoudre en rien la crise, que seule la guerre a vraiment effacée, il a jeté les fondements d’un étatisme durable et prolongé la crise d’une période estimée jusqu’à 8 ans selon l’économiste Florin Aftalion ( http://www.unmondelibre.org/node/626 ) .
RT @vbenard: Qu’on se le dise: Paul Krugman est un crétin http://t.co/n9UzTRXB
A lire : Les dettes qu’on ne paie pas et l’austérité qui tue http://t.co/sZvM1JL6
RT @scarlett_0hara: Absolument RT @vbenard: Qu’on se le dise: Paul Krugman est un crétin http://t.co/JDsFhHbs
RT @TheFrenchChitah: A lire : Les dettes qu’on ne paie pas et l’austérité qui tue http://t.co/sZvM1JL6
RT @vbenard: Qu’on se le dise: Paul Krugman est un crétin http://t.co/n9UzTRXB
Les dettes qu’on ne paie pas et l’austérité qui tue: Krugman revient à la charge contre la (feinte) austérité de… http://t.co/2QdzPyj9
RT @Contrepoints: Les dettes qu’on ne paie pas et l’austérité qui tue: http://t.co/mGZDsohH #Krugman #dette #austérité #déficit #récession
RT @vbenard: Qu’on se le dise: Paul Krugman est un crétin http://t.co/n9UzTRXB
“Ce qui est absurde est de soutenir qu’une coupe minime de deux points sur le PIB du déficit – résultant en plus d’une augmentation des recettes – est ce qui a coulé le Royaume-Uni.”
C’est justement quand les réductions de déficit viennent d’une augmentation des recettes que ce la marche moins bien :
http://www.contrepoints.org/2011/09/05/43931-plan-fillon-fausse-rigueur-vraies-taxes-et-echec-programme
En train de lire “Les dettes qu’on ne paie pas et l’austérité qui tue” http://t.co/ddiNOO8T via @Contrepoints
RT @scarlett_0hara: Absolument RT @vbenard: Qu’on se le dise: Paul Krugman est un crétin http://t.co/JDsFhHbs
Les dettes qu’on ne paie pas et l’austérité qui tue http://t.co/lms8zyhs
Ce cher Krugman… >> Les dettes qu’on ne paie pas et l’austérité qui tue – Contrepoints | Contrepoints http://t.co/d2SFBwso
Les déficiences intellectuelles des keynésiens et les mensonges de Paul Krugman http://t.co/hnsYyeMQ vía @Contrepoints