Première partie de cette série ici.
Seconde partie de cette série ici.
Troisième partie de cette série ici.
Quatrième partie de cette série ici.
Sous l’impulsion d’Athènes, puis des troupes d’Alexandre et des légions romaines, le centre de gravité de la civilisation se déplace vers l’Ouest. La force d’expansion de l’Orient semble tarie. Ce sont les peuples de la Méditerranée qui désormais détiennent la puissance créatrice et les vues d’avenir.
À la source de ces grandes évolutions, la mutation intellectuelle qui se produit en Grèce à partir du VIe siècle joue un rôle essentiel mais ambigu. Elle donne naissance à des ferments de liberté créatrice mais valorise si peu le travail qu’elle condamne homo faber à rester dans l’ombre d’une caverne d’où il ne peut encore sortir.
Une nouvelle vision du cosmos
Au début du VIe siècle avant notre ère débute l’essor de la philosophie et de la science hellénique.
Cet avènement de savoirs rationnels est le fruit d’une longue évolution. Mille ans plus tôt, la civilisation de Mycènes est proche de celles des royaumes orientaux qui lui sont contemporains. Lorsqu’elle s’effondre au XIIe siècle sous la poussée des envahisseurs doriens s’ouvre une période obscure où lentement germent des idées neuves. Elles éclosent au grand jour à Milet vers l’an – 600. Dans cette colonie grecque d’Asie mineure, à l’instigation de Thalès (625-547) et de son école surgit un nouvel esprit de géométrie fondé sur l’intuition que l’ordre qui fonde le cosmos est régi par des lois qui lui sont immanentes.
L’enjeu devient de donner aux phénomènes naturels des explications profanes. Cela ouvre un domaine de pensée qui échappe à l’emprise de la religion et inscrit le monde physique dans un cadre spatial qui n’est plus façonné et habité par les dieux, mais fait « de relations réciproques, symétriques, réversibles »1.
À cette conception de l’univers physique correspond une nouvelle vision de l’espace civique, celui de la « polis »2 qui trouve son plein épanouissement à Athènes au Ve siècle avant J.-C. Avec l’avènement de la cité, centrée sur l’agora, se produit un changement de mentalité faisant de la gestion des affaires publiques l’affaire de tous les citoyens.
Une révolution conceptuelle qui place l’homme libre au centre
Par ces innovations, la rationalité grecque rompt de manière radicale avec les civilisations de l’Orient ancien où le roi dominait la hiérarchie sociale et où même « l’ordonnancement de l’espace, la création du temps, la régulation du cycle saisonnier apparaissent intégrés à l’activité royale »3.
À ces anciens rapports de soumission envers le souverain tout-puissant dont le contrôle s’impose à tout moment sur toute personne et toute chose, se substitue un lien social entre des citoyens définis comme « semblables » et capables de s’affranchir du poids de la tradition par l’invention et la critique. Initiatrice de la philosophie, de la logique et de l’investigation scientifique, porteuse d’un art qui valorise l’équilibre, la pensée grecque met l’homme libre au cœur de ses réflexions.
Des lois écrites fixent ses droits et ses devoirs. Elles dessinent les contours d’une démocratie à laquelle n’a accès qu’une minorité des habitants. En sont exclus les esclaves, les affranchis et les immigrés. Partielle, elle est aussi fragile, toujours menacée par les manœuvres des tyrans.
Cet héritage sera repris par les Romains pour lesquels le grec devient la langue du savoir utilisée par les élites. Même si dans les cités grecques, comme plus tard à Rome, les principes de la démocratie ont souvent été édulcorés, ignorés ou niés, ils n’ont jamais cessé d’être des points de repère dessinant une nouvelle manière d’appréhender le monde et les institutions politiques en vigueur.
Le côté sombre
Mais ces éléments conceptuels favorables à la liberté, à l’innovation et donc à l’essor d’homo faber sont neutralisés par d’autres tendances qui leur font obstacle et étouffent l’économie.
Au fondement de sa dynamique, on a du mal à imaginer autre chose que la prédation et la conquête.
Même les activités tournées vers le commerce et l’échange sont conçues en termes conflictuels. La recherche du butin sous toutes ses formes, en y incluant donc la mise en esclavage des ennemis vaincus, reste le ressort premier des entreprises humaines. Par nature servile, le travail est profondément méprisé et déprécié, ce qui n’incite pas à en accroître l’efficacité.
Selon Aristote, les esclaves sont des instruments de production animés, des sortes de moteurs humains disponibles en abondance. C’est un obstacle rédhibitoire à la mise au point de techniques génératrices de gains de productivité. Tenter de le contourner menacerait l’ordre social en vigueur dans la cité grecque car si « les navettes tissaient toutes seules ; si l’archet jouait tout seul de la cithare, les entrepreneurs se passeraient d’ouvriers, et les maîtres d’esclaves »4.
Tout au long de l’Antiquité, la machine est de fait vouée à la malédiction, ce qui limite drastiquement les possibilités d’amélioration des conditions matérielles d’existence du plus grand nombre. L’argument d’Aristote domine toujours les esprits à la fin du IIIe siècle de notre ère. Lorsqu’un inventeur soumet à l’empereur l’idée d’une machine à dresser les colonnes, Dioclétien la rejette aussitôt : « Laisse-moi nourrir le petit peuple ».
Or, comme le fait remarquer Alfred Sauvy, « l’utilisation de cette machine ne réduisait en rien la quantité de grains existant dans l’Empire, de sorte qu’il existait un moyen de nourrir le petit peuple aussi bien qu’avant et même mieux, grâce aux bras devenus disponibles »5.
Autre élément défavorable à l’essor de l’économie, l’évergétisme était en Grèce, puis à Rome, une façon pour les plus nantis de se montrer généreux envers les moins favorisés et d’apaiser les tensions sociales. Considéré comme une pratique quasiment obligatoire, il consistait à offrir à la foule des spectacles et des banquets ou à entreprendre la construction de bâtiments publics.
On voit comment un tel système peut décourager les initiatives en favorisant le clientélisme et la corruption de la vie publique.
L’oïkos, un cadre de production étouffant
À cela s’ajoute le fait que l’oïkos6, cadre de production jugé idéal dans la Grèce ancienne comme dans la Rome antique, n’est pas non plus favorable à l’amélioration du sort de tous.
À la fois unité de production agricole ou artisanale, et unité familiale élargie incluant les parents et les esclaves, l’oïkos a à sa tête un homme dont le rôle est d’en défendre les intérêts dans la polis tout en assurant la protection des femmes et des mineurs placés sous son autorité. Sur l’art de le gérer ou oïkonomia, Xénophon7 a produit un long dialogue8 dont il ressort que par leurs propres actions les hommes peuvent influer sur le rendement de leurs terres.
Même si cela le démarque d’Hésiode9 pour lequel les cultures dépendent exclusivement du bon vouloir des dieux, le raisonnement économique reste enfermé dans un cadre étroit peu propice à la croissance des activités.
C’est aussi le cas d’Aristote dont la pensée est peu axée sur l’analyse économique. Il en restreint le champ aux seules relations d’échange entre des producteurs libres qui sont peu nombreux à son époque. En revanche, il en écarte aussi bien l’esclavage qui était à la base de l’économie que le grand commerce maritime qui fondait la puissance athénienne.
À Rome, le système oïkiste va conduire à la création de domaines de plus en plus vastes. La concentration de la richesse foncière aux mains d’un petit nombre de riches propriétaires pousse les paysans dépossédés à s’entasser dans les villes. Ils y deviennent les clients des plus puissants qui ont envers eux les obligations de l’évergétisme. « Panem et circenses »10, ce système où chacun aliène sa liberté décourage les activités productives et bride fortement le potentiel des agents économiques.
Des contradictions paralysantes
Prédation, esclavage, évergétisme, oïkos, misonéisme11, ces concepts qui structurent la réflexion dévalorisent le travail productif et étouffent l’éclosion d’une économie qui pourrait assurer la prospérité du plus grand nombre, alors même que le souffle de liberté qui balaie le monde égéen aurait pu la favoriser
Avec ses éléments moteurs et ses freins, ce composé conceptuel fait grandir à l’Ouest de l’Eurasie un nouveau type de civilisation qui se confronte à celles de l’Orient ancien et lui dispute la prééminence.
Arrêtées dans leur expansion, les anciennes puissances orientales finissent par être subjuguées par leurs nouveaux compétiteurs qui à leur tour contribuent à réduire la diversité culturelle des sociétés humaines. Amorcé par l’Empire achéménide, ce processus désormais lui échappe et a pour foyer le monde grec.
Selon une séquence en deux temps animés successivement par Athènes et la Macédoine, les traits principaux de l’hellénisme se diffusent dans l’ensemble du monde connu.
- Jean-Pierre Vernant, Les origines de la pensée grecque, PUF, 1962, p. 3 préface 10e édition, 2005 ↩
- Soit de la cité-État autonome avec son acropole et son agora ↩
- Jean-Pierre Vernant, opus cité, p. 110 ↩
- Aristote, Politique, Livre I, IV,traduction J. Barthélemy-Saint Hilaire, Ladrange, 1874 ↩
- A. Sauvy, L’économie du diable, chapitre 1, Calmann Levy, 1976 ↩
- L’oïkos c’est la maison, les biens afférents, les gens qui forment au sens large la communauté familiale ↩
- Philosophe et chef militaire de la Grèce antique né à Erchia près d’Athènes vers 430 av. J.-C. et mort vers 355 av. J.-C ↩
- L’Économique, œuvre écrite dans la forme des dialogues socratiques, traite de la gestion d’un grand domaine foncier, sur le plan humain et technique ↩
- Hésiode est l’auteur d’un poème datant probablement de la fin du VIIIe siècle avant JC, Les Travaux et les Jours ↩
- Paul Veyne, Le pain et le cirque, Éditions du Seuil, 1976 ↩
- Hostilité à la nouveauté ↩


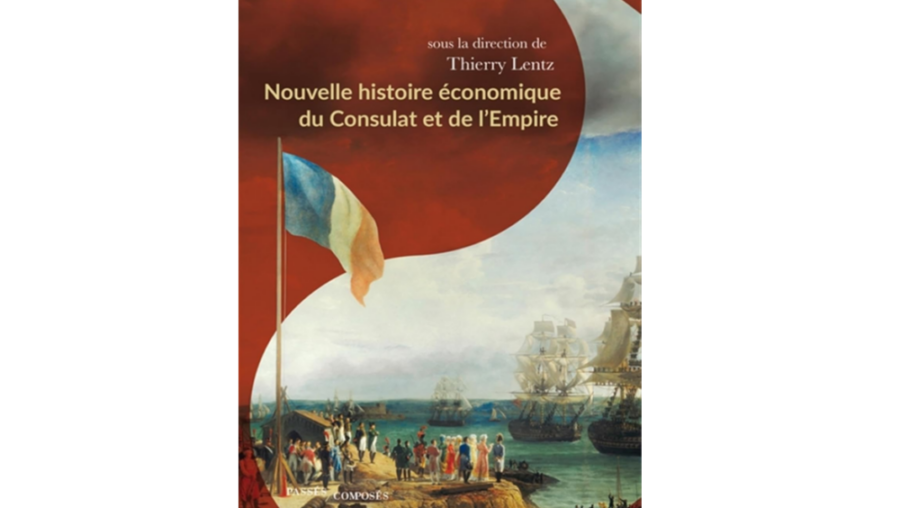
Laisser un commentaire
Créer un compte