Nous vivons une époque de très grande incertitude, où nombre de prédictions et de croyances fortement ancrées ont été brutalement démenties par les faits, notamment depuis les trois dernières années. Et pourtant nous continuons à faire des prédictions. Cela semble rationnel : nous voulons nous protéger contre les mauvaises surprises et nous préparer au pire.
Mais cette préparation au pire a un coût important.
Le pétrole et le gaz naturel dont nous dépendons pour 75 % de notre énergie s’épuisent. La production mondiale de pétrole peut probablement continuer à augmenter pendant encore six ou huit ans. Mais à un moment donné, elle ne pourra plus augmenter beaucoup. La demande dépassera la production. Nous n’avons pas le choix.
Le ton est grave. Le président américain s’adresse à la nation depuis le bureau ovale dans un discours retransmis depuis la Maison Blanche.
Le président ? Jimmy Carter. La date ? 21 avril 1977. Nous vivons dans un monde de prédictions, et toutes, loin de là, ne se révèlent pas exactes. Comment faire avec ?
Déjouer Cassandre
Le Dieu Apollon avait accordé à Cassandre le don de prophétie dans l’espoir qu’elle lui accorderait ses faveurs. Lorsqu’elle s’y refusa, Apollon voulut se venger. Comme un don ne peut être retiré, il fit simplement en sorte que ses prophéties soient ignorées. C’est ainsi qu’elle prédit la chute de Troie mais que personne ne l’écouta. La tragédie grecque fonctionne sur un schéma relativement simple : la fin est connue d’avance, les hommes n’y peuvent rien. Tout ce qu’ils peuvent faire, c’est s’agiter dans tous les sens, mais ce qui doit arriver arrivera inéluctablement.
Dans la vie d’une entreprise, il en va cependant autrement. Le décideur doit constamment agir en tenant compte de nombreuses prédictions dans différents domaines.
Face à une prédiction donnée, il court deux risques :
Le faux positif
Ou agir en tenant compte de la prédiction pour constater plus tard que celle-ci ne s’est pas réalisée. On songe par exemple à la grande panique de l’an 2000 qui devait voir les ordinateurs du monde entier cesser de fonctionner, alors qu’il n’en a rien été. Accepter la prédiction peut se révéler très coûteux. On dépense beaucoup d’argent pour se protéger d’un événement qui finalement n’arrive pas
Le faux négatif
Ou refuser de tenir compte de la prédiction et se retrouver fort dépourvu si elle se révèle exacte. En refusant la prédiction, on économise cet argent, mais cette économie peut se révéler catastrophique si finalement la prédiction se révèle exacte. Cependant, quand on considère l’histoire humaine et le nombre incroyable de prédictions dans tous les domaines qui se sont révélées fausses, ce choix est loin d’être irrationnel.
Il y a donc un coût important à la prédiction. C’est important car nous vivons une époque qui, malgré l’incertitude très forte et les multiples surprises que nous avons vécues ces trois dernières années, conserve une prédilection forte pour les prédictions, dont certaines apocalyptiques. La protection contre ces éventualités représente non seulement un coût direct important, mais aussi un coût d’opportunité : les dépenses (d’argent, d’énergie, d’attention) auraient pu être plus productives ailleurs plutôt que dans une protection contre un risque non avéré.
Toutefois il existe une différence importante avec la tragédie grecque qui est que nous avons souvent une influence sur la réalité de la prédiction. Bien sûr si on annonce qu’une météorite va nous tomber dessus, il n’y a pas grand-chose que nous puissions faire. Mais dans beaucoup de domaines, nous avons une capacité d’action qui peut modifier la validité de la prédiction. Autrement dit, et contrairement aux Grecs, au moment où celle-ci est formulée, elle n’est pas une fin inéluctable, mais devient un élément d’information qui influence notre décision. Cela peut donner une prophétie auto-réalisatrice : si on annonce une pénurie de moutarde, tout le monde se rue pour acheter de la moutarde, ce qui entraîne effectivement une pénurie. Mais cela peut aussi fausser la prédiction. La pénurie d’énergie annoncée pour cet hiver entraîne actuellement un effort très important, notamment des entreprises, pour réduire leur consommation, ce qui empêchera peut-être la pénurie au final.
C’est ainsi que nos actions peuvent rendre la prédiction finalement fausse. Cela ne signifie pas qu’elle aura été inutile. Par son existence, elle aura suscité une action pour l’éviter. Pour reprendre l’exemple du bug de l’an 2000, on ne saura jamais vraiment si le danger n’était pas réel, auquel cas tous ces efforts ont été faits pour rien, ou si ce sont au contraire ces efforts qui ont permis d’éviter le bug.
Le pari de l’optimisme
Une chose est sûre : à part dans le monde strictement physique, comme la météorite évoquée ci-dessus, il existe très peu de prédictions que nous ne soyons pas à même de rendre fausses par notre action.
Bien sûr, nous ne pouvons jamais en être certains.
Mais comme l’observait l’historien et homme d’État britannique Thomas B. Macaulay :
« Selon quel principe, alors que nous n’avons que des améliorations derrière nous, nous ne devons nous attendre qu’à une détérioration devant nous ? »
Autrement dit, penser que nous avons la capacité de faire mentir les prédictions les plus sombres est un pari rationnel, en tout cas plus rationnel au regard de l’histoire que de renoncer et considérer le futur annoncé comme inéluctable. C’est là le domaine de l’entrepreneuriat et de l’innovation.
—


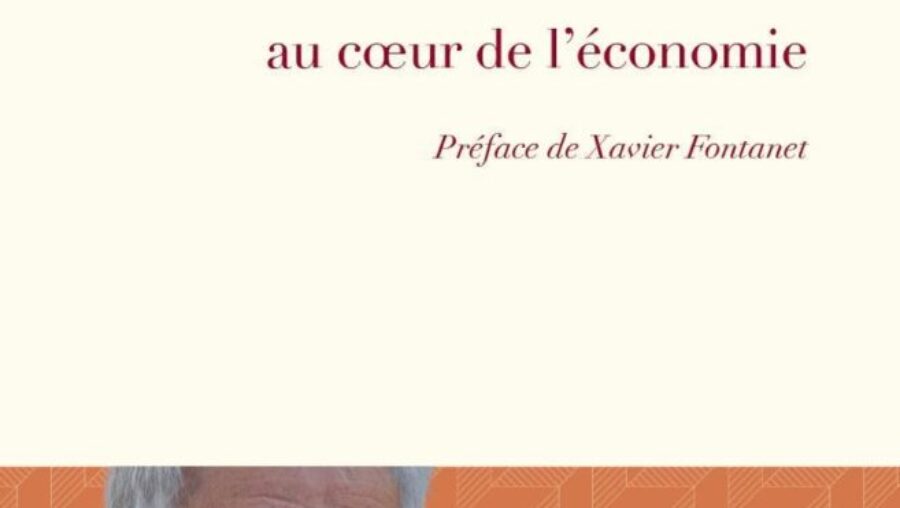
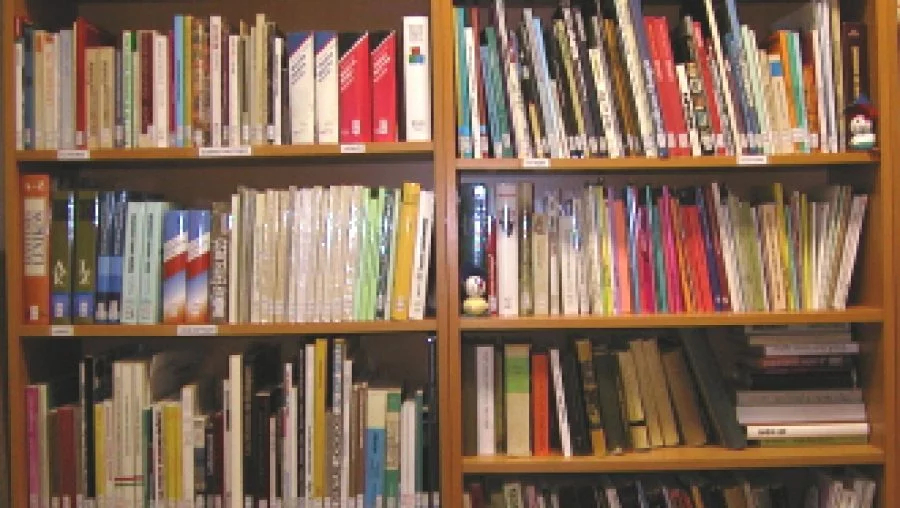

Voilà mon sujet d’inquiétude : qu’on rejoue la tragédie grecque avec la chute de la météorite !
Car il y a bien plus à craindre de cette chute que d’une montée des températures. Les dinosaures nous le rappellent assez souvent.
Or, ici comme ailleurs, il n’y a pas de fatalité. Et déjà certaines agences travaillent à réduire ce risque.
Il était temps.