Par Philippe Aurain.
Les États-Unis nous ont habitués à sortir plus rapidement et plus dynamiquement des crises économiques que les pays européens. Il est vrai que cette dynamique a généralement comme contrepartie qu’ils subissent des impacts au préalable plus forts sur leur économie, laquelle ne dispose pas d’un niveau équivalent de stabilisateurs automatiques (assurance chômage, sécurité sociale universelle…).
La crise du Covid présente des similitudes et des divergences par rapport à ce schéma.
Comme à l’accoutumée, le choc a été plus violent sur l’emploi : le taux de chômage est passé de 3,5 % à 14,7% (6 % aujourd’hui), contre une évolution de 7,30 % à 8,40 % (8,3 % aujourd’hui) en zone euro. En revanche, de manière atypique, les conséquences sur la croissance ont été plus modérées (au T2 -7,9 % vs -11,8 % en zone euro, et sur l’année, -3,5 % vs -6,8 % en zone euro).
Cet état de fait est largement dû à l’effort de soutien gouvernemental considérable qui a été produit outre-Atlantique.
Une analyse publiée dans le Bulletin économique de la BCE (numéro 2/2021) évalue les efforts budgétaires réalisés en 2020 à 10 % pour les États-Unis et 7 % en zone euro, après intégration des stabilisateurs automatiques. Un chiffre illustre le résultat : le revenu disponible des ménages américains a augmenté de 6 % en 2020, entièrement du fait de transferts sociaux sans lesquels il aurait baissé de 0,9 %.
Que pouvons observer pour 2021 ?
Le contrôle de la crise sanitaire est plus avancé aux États-Unis avec un taux 35 % de personnes ayant reçu, au 12 avril, au-moins une dose de vaccin, contre 15 % en zone euro (moyenne Allemagne, France, Italie). En conséquence, les restrictions se relâchent plus rapidement (indice de restriction 59 aux États-Unis, 78 sur la moyenne des trois pays cités).
Le soutien public reste très important : le versement en janvier des chèques du plan adopté en fin d’année a entrainé une hausse des revenus des particuliers de 10 % sur un mois et 13 % sur un an.
Le Président a également fait voter un nouveau plan de 1900 milliards de dollars en mars 2021 et prépare un plan infrastructure de 11 % du PIB qu’il souhaiterait opérer sur huit ans.
Les entreprises américaines ont été moins touchées par la crise en 2020 (pour un ordre de grandeur, pas complétement comparable toutefois dans leur définition, les profits d’exploitation ont baissé de -6% aux Etats-Unis vs -20% en zone euro) et ont donc préservé des capacités d’investissement plus importantes.
Au total, la situation actuelle permettrait aux États-Unis d’enregistrer une croissance de 6,5 % en 2021 contre 4 % pour la zone euro.
Les courbes des taux s’ajustent en conséquence : l’écart entre les taux 10 ans des deux zones a augmenté de 0,30 % en 2021 ; l’écart de dynamique économique pourrait entraîner un creusement du déficit commercial américain puis un ajustement du taux de change.
Mais la vraie difficulté serait un écart de cycle qui entrainerait une hausse de l’inflation, dont la dynamique est largement mondialisée, alors que la zone euro aurait besoin pour longtemps d’une politique monétaire très accommodante. Apparaîtrait alors la véritable difficulté associée à la politique monétaire ultra expansionniste actuelle : comment gérer sa réversibilité ?




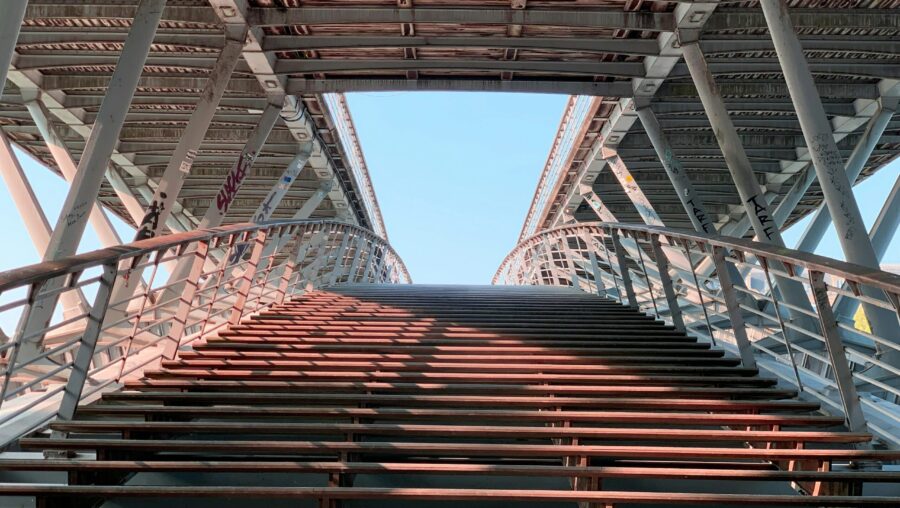
L’Europe hétérogène V/S les USA homogènes : c’est donc normal !