Par Jonathan Frickert.
La seconde phase du quinquennat sera-t-elle le contraire de la première ? On dépeint, notamment ici, Emmanuel Macron en social-démocrate jacobin, le voilà qui nomme un Premier ministre de droite dure aux relents girondins.
Un changement de ton qui ne trompe personne à un an et demi de la prochaine échéance présidentielle et qui n’est pas sans rappeler la nomination d’un Eric Dupond-Moretti à la Chancellerie avant qu’il ne verse dans le sentimentalisme en pleine polémique sur l’affaire Traoré dans laquelle celui qu’il n’était pas encore avait explicitement pris la défense d’Assa.
En pleine remise en cause de la doctrine sécuritaire française, la dernière phase du quinquennat suit donc la première en termes d’esbroufe, et le projet de réforme de la justice de proximité évoqué lors du discours de politique générale du nouveau locataire de Matignon ne contredit en rien cette impression.
Juges de proximité : Castex réinvente les tribunaux correctionnels
Un exercice de calinothérapie. C’est ainsi qu’on pourrait qualifier les mots du nouveau Premier ministre Jean Castex lors de son discours de politique générale à l’Assemblée nationale.
Par une défense franche des forces de l’ordre au cœur d’une polémique importée des États-Unis par quelques idéologues indigénistes, le chef du gouvernement a évoqué la présentation prochaine d’un projet de loi visant à en finir avec le séparatisme et les incivilités du quotidien.
À cette fin, le Premier ministre a demandé au ministre de la Justice de créer des juges chargés de « la petite délinquance » et « des incivilités du quotidien ». Autant dire que Jean Castex ne réinvente ici ni plus ni moins que les tribunaux de police et correctionnels.
Mieux encore, souhaitant appeler ces juges « juges de proximité », le Premier ministre renvoie à un juge ayant déjà existé entre 2002 et 2017 et qui n’avait pas brillé par son intérêt.
Mais outre ce pléonasme législatif, c’est bien la théorie derrière ce projet qui interroge. Les professionnels de la justice sont en effet habitués depuis plusieurs années maintenant à une fusion des juridictions.
Après les tribunaux des affaires de Sécurité sociale, juridictions d’exception devenues pôles sociaux des tribunaux de grande instance en 2019, ce sont les tribunaux d’instance et de grande instance qui ont fusionné au 1er janvier dernier dans les tribunaux judiciaires, dont l’intitulé est un calque de celui des tribunaux administratifs.
L’idée d’une division va donc à l’encontre des dernières réformes intervenues.
L’indépendance, mais pas trop
Cette inversion du sens de l’histoire juridictionnelle interroge quant aux véritables intentions d’un gouvernement dont le garde des Sceaux est régulièrement accusé de vouloir renverser la table du système judiciaire français.
Celui qui a récemment estimé, sans surprise, qu’il ne pourra pas faire tout ce qu’il aimerait en 600 jours avait plusieurs fois évoqué ses ambitions pour la justice.
Outre son combat pour la suppression de l’ENM qui lui valut une levée de boucliers des syndicats de magistrats, l’avocat lillois révélé par le procès d’Outreau défend une séparation nette entre les magistrats du siège et du parquet.
En clair : entre ceux qui jugent et ceux qui accusent, entre ceux qui disent le droit et ceux qui en demandent l’application. Ce même parquet qui est sous l’autorité directe du pouvoir politique à travers le Garde des Sceaux.
De quoi rappeler ce qui se fait de l’autre côté de la Manche, où le système judiciaire n’est pas unifié, avec des procureurs indépendants et, surtout, le plus gros budget accordé à la justice et notamment à l’aide juridictionnelle en Europe comparativement au PIB du royaume.
Un système tellement efficace que les juges britanniques n’hésitent pas à mettre en accusation des chefs d’État étrangers, et non des moindres, comme ce fût le cas de Vladimir Poutine, visé par l’enquête sur le meurtre présumé de l’ancien agent secret russe Alexandre Litvinenko décédé fin 2006 à Londres.
Cependant, un point éloigne le nouveau ministre de l’étiquette d’anglophile : sa sympathie pour le statut actuel du parquet. Il estime ainsi que la politique pénale est l’affaire de l’État et non des juges, reprenant à son compte la tradition française, reconnaissant toutefois les problèmes que cela pose en termes de soumission au pouvoir politique et en particulier dans les affaires mettant en cause des justiciables candidats à des élections.
À l’image du quinquennat d’Emmanuel Macron, la politique pénale et sécuritaire de ce pays semble donc refuser d’aller au bout des choses et de donner au terme de « réforme » sa pleine signification.
Justice de proximité et mesures liberticides ?
Outre l’absence de réforme structurelle, la politique de sécurité que nous connaissons depuis 2017 souffre d’un mal déjà connu auparavant, mais renforcé par les différentes crises sociales, sanitaires et bientôt économiques qui agrémentent ce quinquennat.
Cette demi-mesure rappelle en effet la fin de l’État d’urgence sanitaire le 11 juillet dernier, voyant se télescoper l’accroissement d’interdictions frappant les citoyens de tous les jours et un dépeçage en règle des moyens techniques de la police, avec la fin de la technique de l’étranglement s’ajoutant à plusieurs années de désagrégation de nos forces de l’ordre.
Le projet de loi sur la justice de proximité semble suivre la même logique, puisqu’au milieu de ce qui semble être un rééquilibrage de notre dispositif judiciaire s’ajoutent plusieurs mesures liberticides, en proposant notamment la fin de l’anonymat sur des réseaux sociaux que le Premier ministre n’a pas hésité à comparer au régime de Vichy, sans se rendre compte que la réponse qu’il propose rappelle, elle, la Terreur.
L’anonymat, une condition démocratique
L’Antiquité a sans doute tout créé en matière de philosophie. Depuis deux millénaires, nous ne faisons que réadapter, et c’est également vrai en matière de politique. Le vote à bulletin secret en témoigne, puisqu’il fût proposé à cette époque afin d’éviter les pressions et représailles sur les votants.
Le vote anonyme est une garantie fondamentale de la vie démocratique d’un État puisqu’elle permet notamment de respecter l’article 10 de la Déclaration de 1789 en évitant que quiconque ne soit inquiété en raison de ses opinions. La parole sur les réseaux sociaux fonctionne de la même manière, mais cela passera évidement par une longue série de luttes dont nous n’avons pour l’instant vu que le début.
Preuve en est que la révolution démocratique qu’a été l’avènement des réseaux sociaux connaît, comme toute révolution, plusieurs étapes où le despotisme succède à la libération.
Twitter à l’heure du mouvement « woke »
Après l’éclatement de la révolution en 1789, la France a connu la Terreur avant de retrouver un régime démocratique en 1795 avec notamment l’introduction du vote à bulletin secret. Cette année-là, des républicains modérés ont mis en place le Directoire afin de lutter contre les conspirations jacobines et royalistes, et ce jusqu’au coup d’État du 18 Brumaire qui marquera le début de l’époque napoléonienne. Cette période est peu connue dans une histoire de France très césariste préférant Robespierre et Napoléon à Barras et Reubell.
La parole démocratique a également connu sa petite révolution avec l’émergence des réseaux sociaux dans les années 2000, au point que certains leur prêtent un rôle prépondérant dans les printemps arabes, les manifestations hongkongaises ainsi que l’émergence des Gilets jaunes avant leur récupération par l’ultra-gauche.
À cette première phase, libératrice, correspondant à 1789, succède une deuxième phase, totalitaire, que nous connaissons aujourd’hui. Les réseaux sociaux connaissent aujourd’hui leur 1793 avec, pour principal enjeu, la question de l’anonymat.
Cette démocratisation a donc ses ennemis, qu’ils soient dans le champ républicain ou non. Dans ce cadre, si le nouveau garde des Sceaux est un défenseur reconnu des libertés publiques, son opposition à l’anonymisation sur les réseaux sociaux en fait le meilleur allié de la cancel culture, ce dérivé direct de la pensée progressiste dont les partisans n’hésitent pas à mener des opérations de lynchage de grande ampleur en révélant les coordonnées des gens considérés comme impurs, allant des appels au licenciement aux appels au meurtre.
Mais le risque de la fin de l’anonymat sur les réseaux sociaux est également démocratique. En se focalisant davantage sur « qui » plutôt que sur « quoi », le débat démocratique devient gangrené par le fameux « d’où vous parlez » soixanthuitard. À l’époque, l’objectif était de discréditer des propos en renvoyant son émetteur à sa condition sociale jugée généralement trop aisée.
Avec l’émergence de la culture dite woke, on passe d’une connotation sociale à une connotation sexuelle et ethnique. La fin de l’anonymisation sonne, pour les partisans de cette « culture », comme du pain bénit renforçant un peu plus la chape de plomb qui s’est lentement accrochée à cette grande agora virtuelle que constituent les réseaux sociaux.
La continuité liberticide
Derrière des intentions louables visant – enfin – à assurer un minimum de sécurité dans ce pays, le gouvernement Castex continue là où le gouvernement Philippe s’était arrêté : dans les demi-mesures cachant de réelles régressions pour les libertés publiques.
La seconde phase du quinquennat sera définitivement dans la continuité de la première.




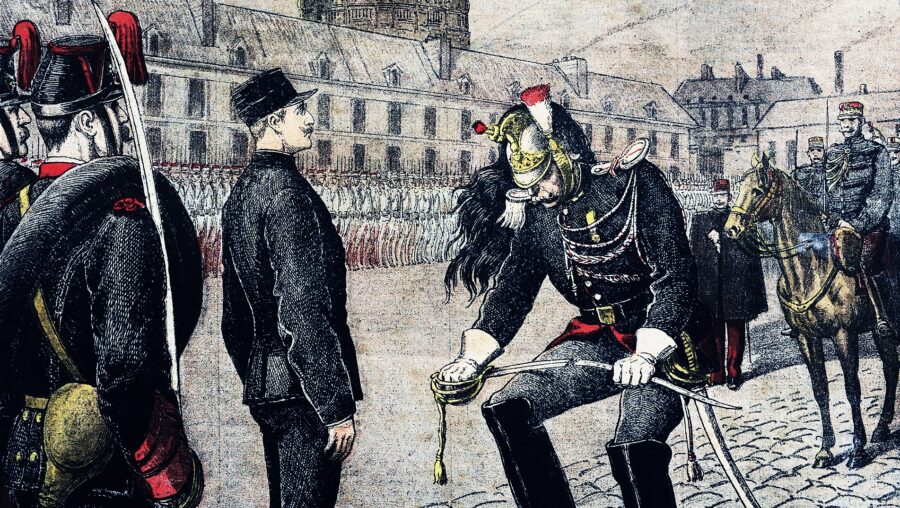
La calinotherapie qu’elle soit de proximité ou pas reste de la calinotherapie… Et donc c’est pour diminuer les incivilités.. Quel joli mot pour qualifier les actes de gens non civilisés, des sauvages.
” petite délinquances ” ? ” incivilités ” ? les gentils mots que voilà alors que nous avons à faire à des agressions gratuites violentes quotidiennes , voire mortelles , de la part d’individus islamisés ou pas , mais qui profitent du laxisme gouvernemental ; Marion Maréchal a raison quand elle dit ” je crains qu’il ne soit trop tard pour la France ” ;
https://www.atlantico.fr/decryptage/3591183/cette-ultraviolence-avec-laquelle-les-francais-vont-devoir-apprendre-a-vivre-nicolas-moreau?utm_source=wm&utm_medium=email&utm_campaign=20200718
cela ne peut pas bien finir.
Macron est un President qui a pour mission de détruire la France. Et il s’acquitte parfaitement de sa mission.
non, il n’en est pas conscient : c’est un pantin.
À votre avis, quel est le pays avec me meilleur système juridique ? Le Royaume-Uni ?
Continuité liberticide… Franchement, qui espérait autre chose?
Après avoir enfermé les Français, on les bâillonne. Significatif’.
Bon, comme le “jeu” du bonneteau, mélanger les professionnels, mélanger les lieux, mélanger les intitulés et faire croire que c’est novateur. Ce que l’on vit depuis 40 ans, légèrement exacerbé depuis 3 ans. Bonne chance aux plaignants de base…