 Ce roman de la japonaise Ito Ogawa, tout en simplicité, délicatesse et élégance, dresse le portrait d’une jeune femme de 25 ans, Hatoko, de retour à Kamakura après quelques années passées à l’étranger. Elle revient s’installer dans la papeterie familiale, qui appartenait à sa grand-mère et dont elle va à présent reprendre le flambeau.
Ce roman de la japonaise Ito Ogawa, tout en simplicité, délicatesse et élégance, dresse le portrait d’une jeune femme de 25 ans, Hatoko, de retour à Kamakura après quelques années passées à l’étranger. Elle revient s’installer dans la papeterie familiale, qui appartenait à sa grand-mère et dont elle va à présent reprendre le flambeau.
Un métier un peu oublié
Riche de tous les enseignements reçus de sa grand-mère – l’Aînée, comme elle la nomme – Hatoko s’apprête à mener à son tour l’activité d’écrivain public. Un métier un peu oublié, mais fort utile, auquel l’Aînée l’a préparée avec exigence et sévérité. Une activité passionnante et pleine de surprises à laquelle la jeune femme va se livrer avec assiduité et engagement.
On suit avec un certain intérêt la manière dont il faut s’y prendre pour s’adapter à toutes les sortes de demandes, tristes ou heureuses, graves ou plus légères : condoléances, billet doux, lettre d’amour, nouvelles données après de longues années, annonce de divorce, lettre de rupture, lettre de refus, vœux, remerciements, et plein de choses encore, avec leur lot de surprises parfois.
Mais c’est surtout à l’art de la calligraphie que nous sommes conviés. Car la jeune femme y a été formée pendant toute son enfance par sa grand-mère, dès le plus jeune âge. Et on découvre l’art – car c’en est un véritable – d’écrire une lettre.
Au-delà du choix délicat des mots, il y a aussi le choix de l’instrument – stylo-plume, stylo-bille, pinceau, plume d’oie, ou même plume de verre – le style de l’écriture, l’orientation horizontale ou verticale (nous sommes au Japon), le soin apporté à l’écriture, le choix des caractères, de la typologie (hiragana, kanji, …), de l’encre, du papier (voire du parchemin), de sa taille, de sa texture, de son grammage. Sans oublier le choix délicat de l’enveloppe et même du timbre (et de la façon de le coller).
Il y a ensuite le choix des formules, de la ponctuation, la clarté et la précision à apporter, la forme de langage à adapter, la longueur de la missive, la diplomatie dont il faut faire preuve, entre douceur et fermeté selon les situations, mais sans jamais prendre le risque de froisser son interlocuteur.
À l’arrivée, ce sont de très belles lettres qui nous sont révélées, pour certaines magnifiques. Et le charme du livre consiste à nous les reproduire en écriture japonaise. Dans toute leur subtilité et leur beauté, même si nous ne les regardons -nous Européens – que de manière évasive.
Une histoire simple et touchante
Tout le charme de cette narration réside aussi dans la manière, pour Hatoko, de recevoir le client, par un cérémonial du thé, suivi de l’art subtil et délicat de s’approprier sa demande, en entrant dans ses motivations profondes et sa psychologie, tout en se gardant de toute indiscrétion ou d’entrer dans son intimité. Une entreprise pleine de pudeur et de délicatesse.
Et dans la restitution de tous les sentiments et tourments qui parcourent l’esprit de la jeune femme lorsqu’elle recherche l’inspiration, parfois avec une certaine angoisse et difficulté, à l’image de certains artistes. Comme dans le passage suivant :
La beauté naturelle, intacte, porte en elle le charme de la vieillesse. À force d’y réfléchir, je n’avais plus aucune idée de ce que serait l’écriture du père de Seitarô aujourd’hui. Quand j’y pensais, j’avais toujours vécu seule avec l’Aînée. Il n’y avait pas d’homme à la maison. Pour commencer, qu’était-ce qu’un père ? Je n’arrivais pas du tout à l’imaginer.
Alors que le texte était presque prêt, l’écriture qui l’incarnait m’échappait. J’avais beau essayer encore et encore, je n’étais pas satisfaite. Je souffrais vraiment, terriblement. Je me tordais de douleur comme si j’avais mangé quelque chose qui ne passait pas. Je n’arrivais pas à trouver la bonne écriture. Plus j’essayais et plus je m’enfonçais dans un labyrinthe.
Il est aussi question, dans cette histoire, de nourriture (comme souvent dans les histoires japonaises), de petits plaisirs au quotidien, d’une relation épistolaire, de cérémonie des lettres brûlées, et de révélation d’un secret.
Autant de saveurs que je vous convie à goûter sans restriction. Mais à la condition, bien sûr, de ne pas être allergique à une certaine forme de lenteur et de poésie.
- Ito Ogawa, La papeterie Tsubaki, Editions Philippe Picquier, août 2018, 384 pages.

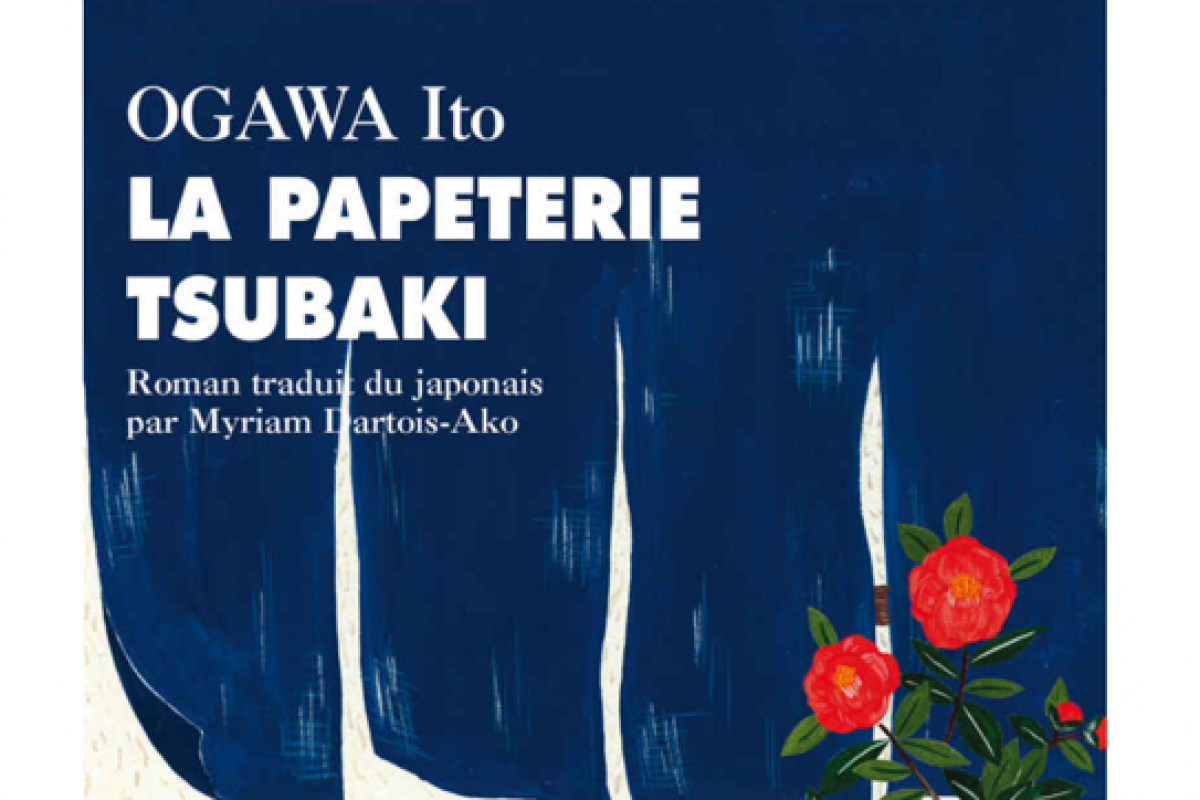


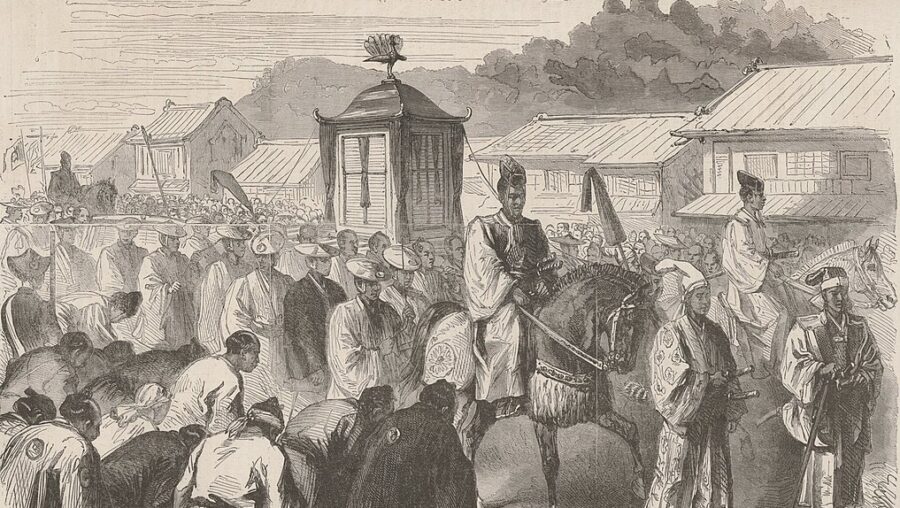
Une bien belle critique, qui donne envie de lire. Merci
En effet.