Par Eddie Willers.
J’ai déjà eu l’occasion de parler à plusieurs reprises du principe de construction d’un prix. Néanmoins, l’actualité m’offre régulièrement l’occasion de refaire un point sur ce mécanisme.
Un prix est le résultat d’une rencontre entre une offre et une demande. Rien d’autre. Certains économistes voudront toujours affirmer que le prix est la résultante d’une intensité de travail. Plus la quantité de travail pour produire un bien ou un service est importante et plus le prix devrait l’être et inversement.
Or je ne pense pas me tromper en disant que vous ne seriez pas prêt à payer plus cher, toutes choses égales par ailleurs, quelqu’un qui repeint votre appartement en une semaine qu’un peintre qui le ferait en trois jours. Je suis même convaincu du contraire.
Ce mécanisme a pour conséquence de ne pas être un système méritocratique. Là où un maître d’école encourage l’élève qui travaille dur et peut s’en prendre à l’élève qui a des facilités mais est moins travailleur, la fixation des prix ne répond qu’à l’impératif de l’efficacité.
Ce n’est évidemment pas agréable. Nous cherchons toujours, autant que faire se peut, à encourager les situations justes, or il nous apparaît naturellement plus juste d’encourager celui qui travaille dur même si cela n’est pas efficace.
Pour autant, valoriser la quantité de travail au détriment de l’efficacité en vue de répondre à un besoin est source d’inefficacités. Nos ressources (temps, argent, matières premières …) sont rares et nos besoins nombreux : nous devons donc chercher à optimiser ce couple ressources-besoins.
Quel indicateur peut dès lors nous permettre de savoir que nous optimisons nos ressources ?
La réponse est le prix.
Si jamais la réalisation d’un bien ou d’un service est coûteuse en ressources, deux options s’offriront à moi :
- demander un prix élevé pour au moins couvrir mes coûts,
- ne pas le vendre car personne ne serait prêt à payer aussi cher.
Je saurai donc très rapidement si ce que je produis répond à un besoin et si mon couple ressources-besoins est correctement adressé.
De nombreux pays ont tenté de se soustraire à cette logique de prix. “La santé n’a pas de prix”, “l’éducation n’a pas de prix” … Ils ont donc décidé de fixer eux-mêmes des prix sans faire appel à une mécanisme de rencontre entre offre et demande.
Il en a résulté partout une mauvaise allocation des ressources et donc une destruction de richesses : URSS, Républiques socialistes d’Europe de l’Est, Cuba, Corée du Nord, Venezuela…
La réalité de ce monde ne se soucie guère des idéaux de l’âme humaine. Elle est froide et implacable. Pour organiser la réponse à un besoin, se nourrir par exemple, nous pouvons faire le choix d’un mécanisme de prix libre ou faire le choix d’un système de queues et d’attente.
L’être humain reste avant tout un animal qui répond à règles universelles. Je vous renvoie à vos manuels d’histoire pour savoir ce qu’il est advenu des populations dont les dirigeants ont voulu “changer l’Homme en un Homme nouveau“.
Malheureusement, si nous voulons améliorer les conditions de vie des Hommes, nous devons produire plus avec autant ou moins. Nous devons donc répondre au mieux à une demande et au long de l’histoire de l’humanité, il semble que seul un mécanisme de prix libres a su répondre à cette exigence.
Je terminerai ce billet en racontant une blague connue en URSS dans les années 1980 et qui viendra illustrer à nouveau le fait qu’un mécanisme de prix non-libre se solde par un mécanisme de queues et d’attente :
“Un travailleur fait la queue devant un magasin de nourriture, agacé, il s’exclame face à son ami :
– J’en ai assez, je vais me débarrasser de Gorbatchev !
Il part donc et revient quelques heures plus tard. Son ami lui demande :
– Alors ? Tu t’es débarrassé de Gorbatchev ?
– Non la queue était encore plus longue qu’ici.”
—


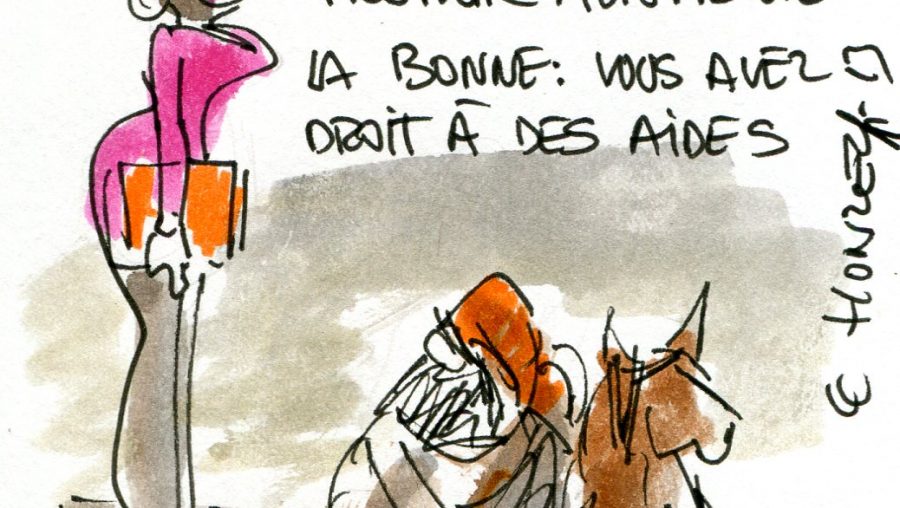


Qu’en est -il de l’histoire selon laquelle certains chauffeurs de VTC seraient des salariés de la RATP en grève ? Si elle est vraie, alors l’offre et la demande n’ont plus de fondement honnête, les prix sont des faux prix donnant des signaux erronés, comme à chaque fois que l’Etat et ses sbires se mêlent d’économie.
Si c’est le cas, à la limite ces salairés mériteraient plutôt des remerciements : en augmentant l’offre dans des conditions de demande forte, ils contribuent à maintenir les prix à des niveaux plus supportables.
Ce qui n’exonérerait pas leur employeur de faire aussi son travail et de les sanctionner, si tant est que leur contrat de travail leur interdit d’exercer une autre activité rémunérée – je ne travaille pas à la RATP, mais le mien m’impose au minimum d’informer mon employeur, ne pas le faire est une faute.
S’ils profitent de leur propre grève, ils font monter les prix par pénurie artificielle.
ce n’est donc pas une idée reçue
Concernant la santé, il faut quand même voir qu’aux USA, pays dont le système de santé est très largement privatisé, où le marché fixe les prix, 17% du PIB est absorbé par ce système (un article récent de Contrepoints en a bien parlé)
Le PIB américain étant de surcroît très élevé (première puissance économique mondiale), l’espérance de vie étant largement plus faible que les autres pays de l’OCDE, je pense voir là un échec patent de ce genre d’approche dans le domaine de la santé.
Quand l’auteur écrit “La réalité de ce monde ne se soucie guère des idéaux de l’âme humaine. Elle est froide et implacable.”, je vois également un aveu d’échec de la capacité (ou possibilité) de l’Homme d’agir (améliorer) sur son environnement et ses conditions de vie, rendant inutile toute démarche libérale ou non.
Il me semble que le gros problème du système de santé américain est le système judiciaire (tout le monde veut porter plainte contre tout le monde grâce à des avocats commerciaux). Il y a aussi la réglementation qui protège les majors de la concurrence. Par exemple, serait il possible à un entrepreneur de créer un concurrent des gros groupes d’assurance en étant moins cher et toujours rentable (genre Free dans la téléphonie en France)?
Le système judiciaire est conséquence de ce principe de responsabilité individuelle. En clair, le libéralisme américain créé de l’insécurité juridique et permet de nourrir des parasites (les avocats).
Pour les assureurs, là, aucune idée.