 Nous faisions état récemment de notre vive déception face à un recueil de « La petite bédéthèque des savoirs » dont le militantisme grossier dépassait tout ce que l’on pourrait attendre de la part d’une collection qui a la prétention de partager l’univers des connaissances sur de multiples sujets en les mettant à portée d’un large public, par le biais de présentations simples et plutôt ludiques. Et qui nous semblait y parvenir de manière plutôt satisfaisante d’après ce que nous en avions vu jusque-là.
Nous faisions état récemment de notre vive déception face à un recueil de « La petite bédéthèque des savoirs » dont le militantisme grossier dépassait tout ce que l’on pourrait attendre de la part d’une collection qui a la prétention de partager l’univers des connaissances sur de multiples sujets en les mettant à portée d’un large public, par le biais de présentations simples et plutôt ludiques. Et qui nous semblait y parvenir de manière plutôt satisfaisante d’après ce que nous en avions vu jusque-là.
Voici donc un volume qui pourra nous réconcilier avec cette collection, en revenant à l’idée que c’est la science qui doit constituer la source essentielle de certains types de savoirs plutôt que les a priori ou visions idéologiques primaires.
Une préface passionnante et très instructive
La préface, signée David Vandermeulen, est véritablement passionnante. Elle permet de remonter à Pline l’Ancien et de découvrir quelles interprétations les Anciens pouvaient avoir – y compris avant lui – de l’origine des objets ou ossements ensevelis du passé retrouvés ici ou là. Et de mesurer le nombre de siècles et l’évolution surprenante des hypothèses qui ont été nécessaires pour voir émerger des hypothèses plus conformes à celles qui sont émises aujourd’hui au sujet de ces fragments préhistoriques.
Il fallut ainsi attendre Michele Mercati, contemporain de Michel-Ange, pour que les outils en pierre travaillés soient considérés comme tels, et non comme des « produits de la foudre ». Puis deux siècles de plus pour qu’en 1717 ses travaux soient exhumés des archives vaticanes, ceux-ci n’ayant pas été considérés comme valides à son époque. Encore fallait-il que Mercati lui-même, puis ses successeurs, fassent remonter ces fragments à après le Déluge, pour tenir compte des contraintes de l’époque… Le naturaliste Antoine de Jussieu, le missionnaire jésuite Joseph Lafitau (moqué plus tard par Voltaire) ou le moine trappiste Nicolas Mahudel (le premier à avoir distingué l’Âge de la pierre, de ceux du bronze et du fer), puis de nombreux autres naturalistes au XVIIIe siècle, ne furent pas plus entendus. Tous confrontés, en outre, à une bonne dose de censure.
Il fallut donc attendre le début du XIXe siècle, puis surtout les découvertes répétées d’ossements d’espèces animales anciennes, ainsi que d’un mammouth congelé trouvé dans les glaces de Sibérie (1799) pour que les choses commencent véritablement à évoluer. Le personnage brillant et excentrique de William Buckland joua un rôle essentiel dans la popularisation de ces thèses. Sans jamais oublier toutefois de continuer de les concilier avec les récits bibliques de la Création… Et ce n’est qu’avec la contribution du zoologue belge Philippe-Charles Schemerling, puis la sortie de L’origine des Espèces de Charles Darwin que cet état d’esprit put enfin évoluer. Ce qui permit de déboucher enfin sur les véritables fondements de la préhistoire et sa conception en millions d’années (et non plus en milliers d’années) à travers notamment les études de Jacques Boucher de Perthes ou d’Édouard Lartet, en France. Quant à la popularisation de la préhistoire et sa diffusion au grand public au-delà du seul cercle des spécialistes, elle n’intervint qu’après 1945 (et a considérablement évolué depuis).
Une présentation à la fois vivante et rigoureuse
De manière amusante, l’auteur Antoine Balzeau – paléoanthropologue, chercheur au CNRS et au Museum d’Histoire naturelle — se met en scène lui-même, sous le coup de crayon de Pierre Bailly, en tant que personnage nous conviant à cette visite guidée à travers la science et l’histoire. Selon un plan en trois parties (principaux concepts, nos origines préhistoriques, perspectives d’avenir).
Avec beaucoup d’humour (qui est une grande force de ce volume et que j’ai beaucoup apprécié), ainsi que de pondération et de sens de la pédagogie, il commence par nous défaire des caricatures habituelles qui sont faites, ainsi que des idées reçues en matière d’anthropologie, de théories sur l’évolution des espèces ou de prédictions fantaisistes que nous sommes habitués à entendre régulièrement ici ou là quant au devenir de l’espèce humaine. Il insiste notamment sur la place essentielle du hasard dans ces évolutions et se garde de tout simplisme, révélant également la fragilité des hypothèses qui, en l’absence de connaissances bien établies sur certains sujets – pour lesquelles nous n’aurons jamais de réponses – mènent à des désaccords entre paléoanthropologues. Ce qui oblige à garder une certaine humilité lorsqu’il est question de savoirs en matière d’histoire, et a fortiori de préhistoire.
D’autant que certains chercheurs « survendent leurs trouvailles » et que d’autres en donnent des interprétations parfois tout à fait fantaisistes. D’où l’invitation d’Antoine Balzeau à se référer uniquement à ce qui relève véritablement de la science, et en dépassant toute forme de clichés.
Combattre les préjugés et stéréotypes
En ne se basant ainsi que sur des faits bien établis et à caractère purement scientifique, ce volume est une excellente occasion pour tout un chacun de faire le point sur les grands axes de la connaissance en matière de paléoanthropologie et de prendre conscience que nous savons finalement très peu de choses sur nos ancêtres. C’est l’occasion, aussi, de remettre l’Homme à sa juste place et de toujours nous rappeler à quel point nous devons rester humbles et modestes.
Un autre intérêt essentiel de ce recueil est, en outre, d’insister sur ce qui fait la spécificité de l’être humain, comme la source de ses plus grands succès : la force des échanges, de la transmission et de la collaboration dans le devenir humain.
Antoine Balzeau et Pierre Bailly, Homo sapiens, La petite Bédéthèque des Savoirs – Le Lombard, avril 2019, 88 pages.

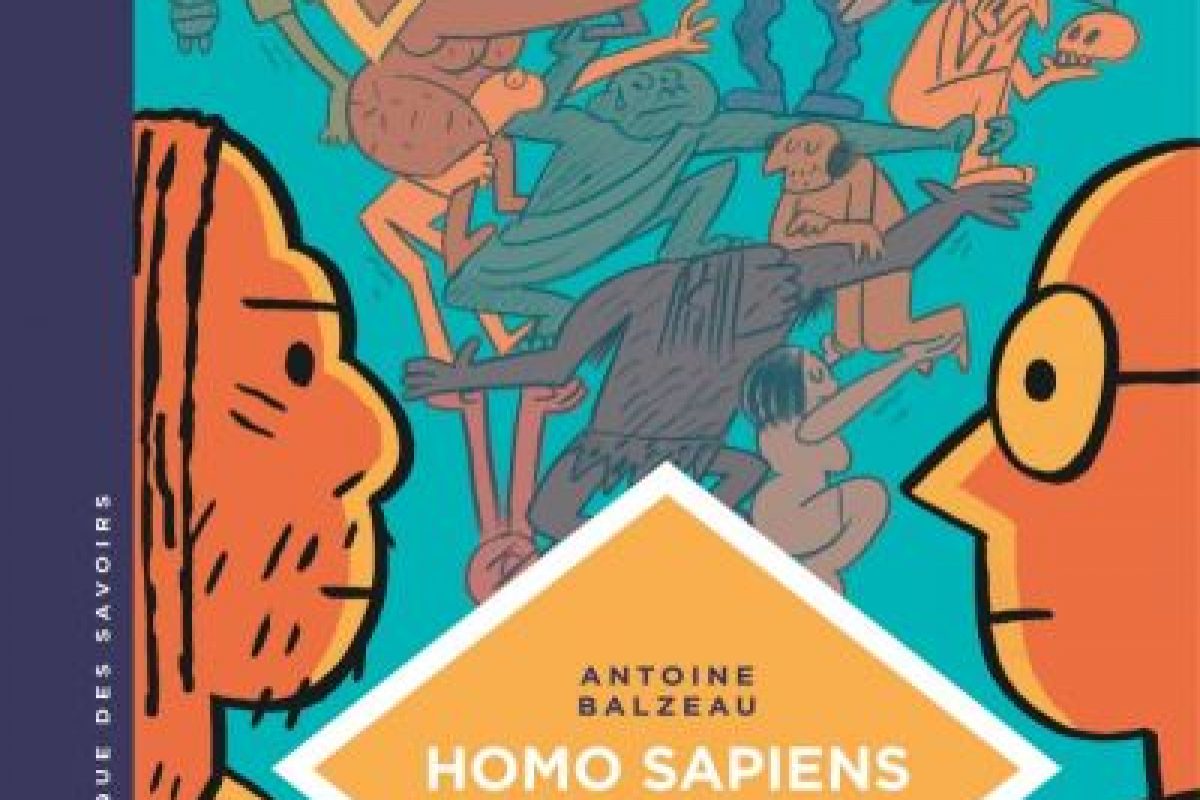


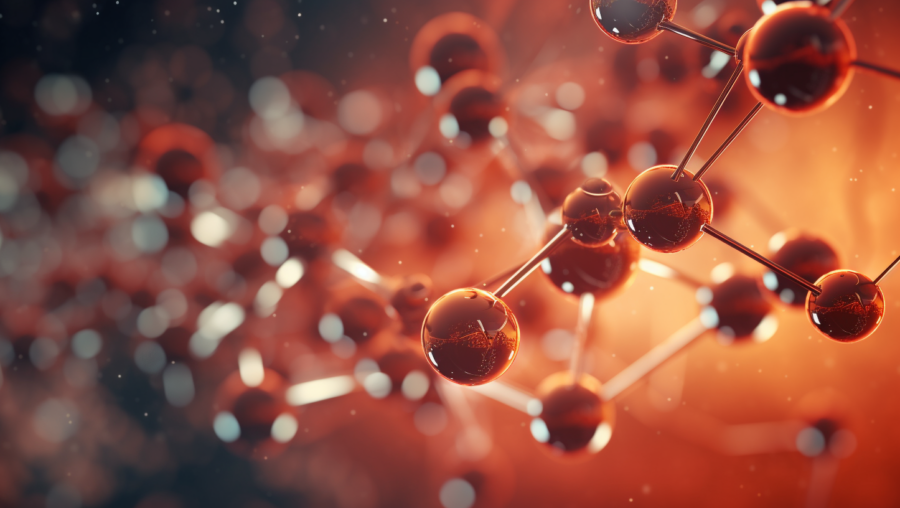
Combattre les préjugés et les stéréotypes : non c’est impossible il faut les faire évoluer. On ne peut pas attendre de la masse un dénominateur commun du niveau de la science en cours.