Par Philippe Silberzahn.
Dans un article de la revue Harvard Business Review, je montrais comment les principes entrepreneuriaux de l’effectuation pouvaient être utilisés pour transformer les organisations.
En substance, l’argument est le suivant : si ces principes permettent aux entrepreneurs de transformer le monde extérieur (nouveaux marchés, nouveaux produits, nouvelles attitudes, nouvelles valeurs, etc.), ils doivent permettre également aux managers de transformer l’intérieur, c’est-à-dire l’organisation.
L’appropriation de ces principes doit permettre de développer ce que j’appelle le leadership effectual. Ces principes sont au nombre de cinq. Regardons le principe numéro 1 : « Démarrer avec ce qu’on a. »
Partir de ce qu’on a sous la main : entrepreneurs
Alors que l’on présente souvent la démarche entrepreneuriale comme guidée par une vision qui doit être définie préalablement (on part d’une idée et on la met en œuvre), l’observation de l’entrepreneuriat tel qu’il se fait montre que c’est rarement le cas. Ikea se crée en 1943 et met dix ans à avoir son idée de vente de meubles en kit.
Facebook commence comme une blague de potache. La grande idée est la résultante d’une trajectoire entrepreneuriale. Elle n’est pas nécessaire au départ même si certains entrepreneurs, comme Elon Musk avec Tesla, sont de brillants contre exemples.
La plupart des entrepreneurs, au contraire, partent de ce qu’ils ont sous la main, c’est à dire de leurs ressources disponibles. Au lieu de se dire “Je veux inventer l’Internet 5.0”, ils se disent plutôt : je dispose de 10.000€, de pas mal de temps, je suis expert en moulage plastique et je programme un peu en Java. Et je connais pas mal de gens dans l’industrie plastique. Que puis-je faire à partir de ça ? Métaphoriquement, ils ouvrent leur frigo et se demandent « Qu’est-ce que je peux cuisiner avec ça ? »
En partant de leurs ressources disponibles, plutôt que d’un rêve, ils peuvent donc commencer immédiatement sans rien avoir à demander à personne, et à partir de matière concrète. Ils ne rêvent pas de ce qu’il faudrait idéalement faire, ils commencent tout de suite à faire quelque chose. Ils ne font pas de plan sur la comète. Ils sont immédiatement dans l’action à partir de matière concrète sur laquelle ils ont plein contrôle.
De manière intéressante, les organisations appliquent spontanément ce principe en cas de crise majeure. Elles oublient alors organigrammes, descriptions de poste, objectifs annuels… Tout le monde est mobilisé en partant de ce qu’on a et de la réalité (la crise) pour se demander “que pouvons-nous faire ?” C’est donc un mode parfaitement envisageable pour toute organisation, y compris en dehors d’une situation de crise.
La vision éloigne de l’action
Les plans de transformation des organisations procèdent en général d’une logique infaillible : ils peignent la vision d’un futur à atteindre. Cette vision est ensuite déclinée à travers les objectifs et les entretiens d’évaluation, au niveau de l’équipe à travers la définition de sa contribution stratégique, à un niveau organisationnel à travers la vision et la mission de l’organisation.
Une fois cette vision définie, ils déterminent les étapes à franchir pour la rendre possible. Ils restent dans la logique dite causale : d’abord définir un objectif, puis trouver les moyens pour l’atteindre. Ce faisant, ils détournent le regard de la situation actuelle de l’organisation.
Cette approche repose sur une supposition qui a valeur d’évidence : avant de s’engager dans une transformation, il faut savoir où l’on veut aller. Car, comme dans Alice, si tu ne sais pas où tu veux aller tu as peu de chance d’y arriver. Or la transformation naît de l’incertitude de notre monde plein de ruptures. Nous sommes précisément dans une situation où il est difficile de savoir où on veut aller ! Figer une vision trop tôt peut dès lors s’avérer contre-productif.
Nous observons que très souvent, la démarche de transformation est basée sur ce qu’en jargon managérial franglais, on nomme le as is/to be, c’est-à-dire la description, d’une part de l’état actuel (as is) et d’autre part de l’état final à atteindre (to be). L’opposition entre les deux est supposée représenter les deux états possibles ; le premier insatisfaisant, le second souhaitable. Les deux sont comme les rives d’une rivière sans pont entre les deux ; cela implique un grand saut, une grande discontinuité qui bloque l’action : le lien entre les deux va être fourni par des plans stratégiques abstraits dont la traduction concrète “pour moi lundi matin” est difficile sinon impossible, et ce d’autant que je suis déjà la tête sous l’eau. Se focaliser sur la vision nous éloigne donc de la matière à transformer, c’est-à-dire que ça nous éloigne de l’action.
Ce n’est pas là-bas très loin (go for it), c’est ici et maintenant (go from it)
Ce que nous dit le premier principe, c’est que tout doit partir de ce que nous avons sous la main. Et la seule chose que l’on a sous la main, c’est l’organisation en l’état, ici et maintenant, à savoir des individus liés ensemble par des modèles mentaux (M&Ms) individuels et collectifs (croyances, valeurs, etc.) Ce sont ces M&Ms qui doivent servir de matière première car ce sont eux qui déterminent les prises de décision. Ce sont eux qu’il faut transformer, modifier, inventer.
Exemple : au cours d’un séminaire, un dirigeant nous déclare : “Contredire son chef conduit à l’anarchie”. Derrière, se cache un M&M très fort, et qui semble parfaitement naturel à celui qui prononce cette phrase, sur le lien entre la critique et l’anarchie, et entre l’anarchie et le risque organisationnel. On pourrait au contraire estimer que la discussion contradictoire est une façon de faire progresser la connaissance et la sagesse du monde (c’était le cas des philosophes grecs). On pourrait également estimer que la contradiction est à la base de l’innovation, ou encore qu’elle est un devoir de chaque employé pour éviter que son organisation ne commette une bévue. Quoiqu’il en soit, la phrase est un point d’entrée vers une croyance forte (élément de modèle mental ou M&M), dont la remise en question peut permettre une ouverture.
Ce ne sont pas (seulement) les autres ; c’est vous
Beaucoup de cadres de grandes entreprises se sentent bloqués ; ils n’arrivent pas à changer leur organisation et constatent que leur marge de manœuvre, leur autonomie, se réduit d’année en année. Très souvent ils nous disent : « le problème c’est mon chef. Si seulement il pouvait faire un effort tout pourrait changer ». Mais un tel raisonnement est problématique : d’une part le chef est lui aussi soumis à des pressions qui, quelle que soit sa bonne volonté, l’empêchent de desserrer l’étau, et d’autre part, cela conduit à se déresponsabiliser.
Si c’est la faute du chef, alors on n’a plus rien à se reprocher et on s’est trouvé une bonne raison pour ne rien faire : souffrir est plus facile qu’agir. Car naturellement lorsque nous allons voir le chef en question, il ou elle nous dit la même chose. Si on remonte tout en haut, le PDG nous dit « Ce n’est pas de ma faute, c’est celle des actionnaires.
À cause d’eux je ne peux rien faire ». Les-dits actionnaires, qui sont les représentants de fonds d’investissement, diront sans doute qu’ils ont, eux aussi, les mains liées. Se met ainsi en place une chaîne de déresponsabilisation qui arrange tout le monde, d’une certaine façon, mais qui est mortifère par la résignation qu’elle induit.
Le premier principe nous dit au contraire qu’il faut commencer par soi-même, pas les autres. En quelque sorte, le principe remet la balle dans notre camp. Avant de parler des autres, il faut parler de soi-même. La question n’est pas «que pourrait faire mon chef ?» ou « que pourrait faire le PDG ? » mais « Que puis-je faire ». Plus précisément, « Que puis-je faire là où je suis avec ce que j’ai sous la main ? ». Il est inutile de se lamenter sur des leviers d’action qui ne sont pas les nôtres, et qui sont souvent d’ailleurs largement imaginaires ; il faut au contraire déterminer les leviers possibles pour nous, et les utiliser. C’est la version de « un tiens vaut mieux que deux tu l’auras ».
Et la chose à faire, c’est de mettre en lumière les M&Ms, c’est-à-dire de rendre visibles les ressorts cachés de l’action, de rendre explicite l’implicite. Une fois que ces M&Ms sont mis au jour et librement discutés, on peut en parler et les faire évoluer, et la mutation de l’organisation via sa culture peut commencer.
Ce n’est pas vous, ce sont vos M&Ms
Même si bien sûr les individus sont au centre des organisations, ils ne constituent pas en eux-mêmes la matière première réelle. Comme nous l’avons vu, la matière première est constituée des modèles mentaux (M&Ms). Très souvent, lorsqu’on est confronté à une situation que l’on déplore, on est tenté d’en trouver le responsable. S’il se passe quelque chose, c’est forcément la faute de quelqu’un. Or le plus souvent, le contexte est produit à cause des M&Ms existants.
Exemple : la visite par le PDG d’un service de l’entreprise, conçue par lui comme un moyen de faire la tournée des popotes de manière décontractée, est préparée deux semaines à l’avance dans les moindres détails, et la visite se déroule dans un stress extrême pour les membres du service, effrayés à l’idée qu’une fausse note puisse se produire. Cette frayeur n’est probablement pas voulue par le PDG, mais elle est générée par lui en raison du contexte que ses M&Ms et ceux des membres du service créent. Ces derniers sont tout aussi responsables de la frayeur que lui car ils souscrivent à la fiction collective implicite de la toute-puissance du chef et de l’impératif absolu de ne pas faire d’erreur en sa présence. Peut-être lui ne voit-il rien de tout cela, mais il devrait. Comme toute émotion, cette frayeur est un révélateur puissant de M&Ms. Être capable de l’analyser explicitement (probablement après la visite) peut être extrêmement profitable.
Le principe n°1 pose également que l’on doit considérer la matière première à disposition avec bienveillance. Il ne s’agit pas de se connaître pour se juger, mais de se connaître pour se transformer. On démarre avec ce qu’on a, et la question n’est pas de savoir si on aime ce qu’on a ou pas, parce que c’est ce qu’on a, point.
Beaucoup d’études montrent que la condition d’une transformation, sur le plan personnel, est l’acceptation de qui l’on est. En mettant en lumière les M&Ms personnels et collectifs de l’organisation, on s’abstiendra de tout jugement même si c’est parfois très tentant.
Ainsi, les tenants d’une approche traditionnelle réticents à basculer dans le digital ne sont pas forcément des ringards ; ils peuvent simplement être attachés à leur façon de faire dont ils perçoivent les avantages, qui peuvent être réels.
En remettant la balle du côté du manager, le principe n°1 libère les possibles et rend possible l’action concrète à partir de la seule matière malléable : les modèles mentaux de l’organisation qui en régissent le fonctionnement.
Article écrit avec Béatrice Rousset. Voir l’article HBR, également écrit avec Béatrice Rousset : Comment transformer les grandes entreprises en s’inspirant des entrepreneurs. Voir également la vidéo de ma conférence sur le sujet au Lab Postal 2018 ici. Pour en savoir plus sur l’effectuation, voir mon article : Effectuation : Comment les entrepreneurs pensent et agissent… vraiment. Sur l’impuissance apprise des managers, voir : Des tortues jusqu’en haut : Les managers coupables, mais pas responsables du manque d’innovation.
—



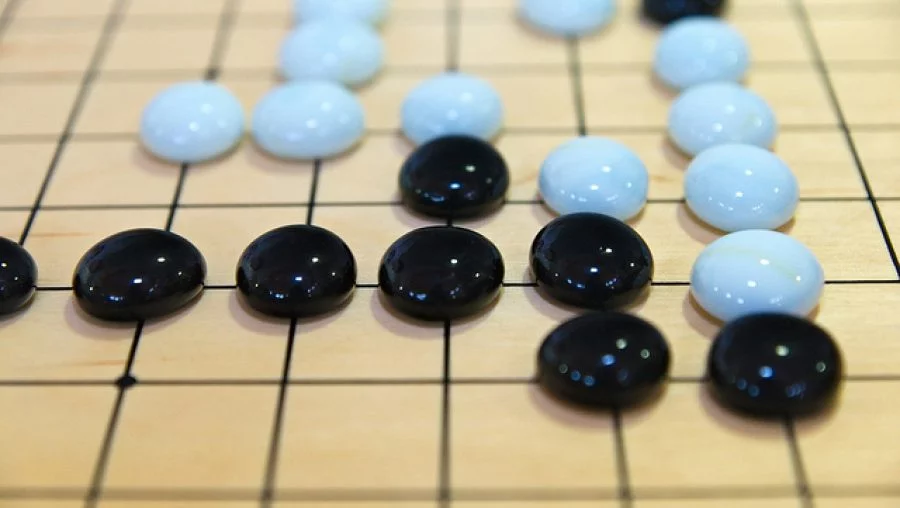

Laisser un commentaire
Créer un compte