Par Martin van Staden.
Un article de Libre Afrique
Saviez-vous que lorsque vous conduisez à 140 km/h dans une zone où la vitesse est limitée à 120 km/h, vous n’êtes pas en train « d’enfreindre la loi », du moins pas directement ?
Il en va de même lorsque vous garez votre voiture sur le trottoir de manière illégale ou lorsque vous vendez ou sous-louez votre maison RDP (programme de reconstruction et de développement) sans autorisation. Comment est-ce possible ?
Quelle est la légitimité de ces textes ?
Ce que vous êtes en train de faire est d’enfreindre une réglementation, une décision, une notice, une directive ou toute autre chose selon le nom que l’on souhaite lui donner. Mais aucune n’est véritablement une loi. Nous devons obéir à ces réglementations parce que la loi nous oblige à le faire, mais notre consentement ne les rend pas pour autant démocratiquement légitimes.
La loi est une institution respectable caractérisée par la régularité, une relative stabilité et un caractère raisonnable. L’état du droit (rule of law) est un principe ancré dans l’ordre juridique de l’Afrique du Sud.
Cela signifie que la loi s’applique sans aucune discrimination, ne change pas souvent, est accessible et motivée par des preuves et par la raison, plutôt que par des considérations politiques opportunistes.
L’article 1c de la Constitution sud-africaine dispose que la Constitution et le principe de la primauté du droit sont la loi suprême de l’Afrique du Sud et l’article 2 dispose que toute loi ou toute conduite incompatible avec cette réalité est nulle et non avenue. Ces dispositions, dans la mesure où les pouvoirs discrétionnaires fleurissent, ont, jusqu’ici, été ignorées par nos tribunaux, et surtout par le Parlement lui-même.
Le diktat des fonctionnaires
On pourrait penser que le Parlement veut protéger jalousement son domaine d’intervention en tant que seul législateur national, mais ce n’est pas le cas. Le Parlement transfère à l’exécutif des pouvoirs discrétionnaires étendus, inconstitutionnels pour presque toutes les nouvelles lois qu’il adopte.
Peut-être est-ce parce qu’il veut transférer la responsabilité d’un hypothétique échec à l’exécutif ou poursuit-il simplement une tradition politique injustifiable ? Quelle qu’en soit la raison, seule l’illégitimité sous-tend ces «lois» par lesquelles nous sommes liés.
Ces «lois-qui-ne-sont-pas vraiment-des lois» sont omniprésentes et minent de plusieurs manières notre liberté, surtout à l’extérieur de nos foyers. Les aspects vitaux de notre vie, comme les soins de santé, ne sont pas réglementés par la loi, mais par les caprices de fonctionnaires dont nous ne connaîtrons jamais le nom, et que nous ne rencontrerons ou ne verrons probablement jamais à la télévision.
Comme beaucoup d’entre nous, ils se mettent au travail tôt le matin, s’installent dans un bureau modeste, font de la paperasserie et rentrent à la maison. Cette «paperasserie», cependant, est d’une nature particulière : c’est le diktat selon lequel tous les Sud-Africains doivent vivre, ou l’alibi qui autorisera la police, l’administration fiscale, ou une foule d’autres agences gouvernementales à nous tomber dessus.
Deux millions de Sud-Africains perdront l’accès à leurs soins de santé privés abordables une fois que les nouvelles «réglementations de démarcation» du ministère de la Santé entreront en vigueur. Cela aura pour effet d’éliminer les options à faible coût auxquelles les utilisateurs de l’assurance maladie (par opposition à des régimes médicaux coûteux) ont eu accès depuis 2002.
Ces produits abordables répondaient pourtant à l’inaccessibilité des régimes médicaux publics hautement réglementés et coûteux qui permettraient soi-disant une «solidarité sociale».
Les réglementations de démarcation ont été introduites en raison de la crainte du gouvernement voyant la ruée des gens sur les soins de santé abordables et efficaces offerts sur le marché libre.
Cela signe bien leur désaffection pour les traitements dans les établissements médicaux publics. Comme l’indique leur nom « réglementations », il ne s’agit pas de lois débattues au Parlement par les partis représentatifs, mais d’un simple texte émanant d’un fonctionnaire qui appose une signature qui peut donner l’apparence d’une loi.
L’irresponsabilité du parlement
Est-ce vraiment tolérable qu’après avoir attendu cinq longues années pour élire nos représentants au Parlement, on laisse des fonctionnaires non élus, liés par simple contrat, nous dicter les règles qui régissent nos vies ? Ceci est une violation claire de l’état de droit. C’est l’une des raisons pour lesquelles le concept de la primauté du droit a été conçu en premier lieu pour empêcher la gouvernance arbitraire.
Si le Parlement veut une loi, il doit la faire lui-même, et ne pas transférer la responsabilité au gouvernement, qui est toujours trop heureux d’étendre son pouvoir et son contrôle sur la société.
C’est le Parlement qui doit fixer les limites de vitesse et élaborer une loi sur la circulation, et prescrire en termes précis quand il est illégal de vendre ou de sous-louer sa maison. Enfin, c’est le Parlement qui doit priver les Sud-Africains de leurs droits aux soins de santé, afin que nous sachions à qui demander des comptes.




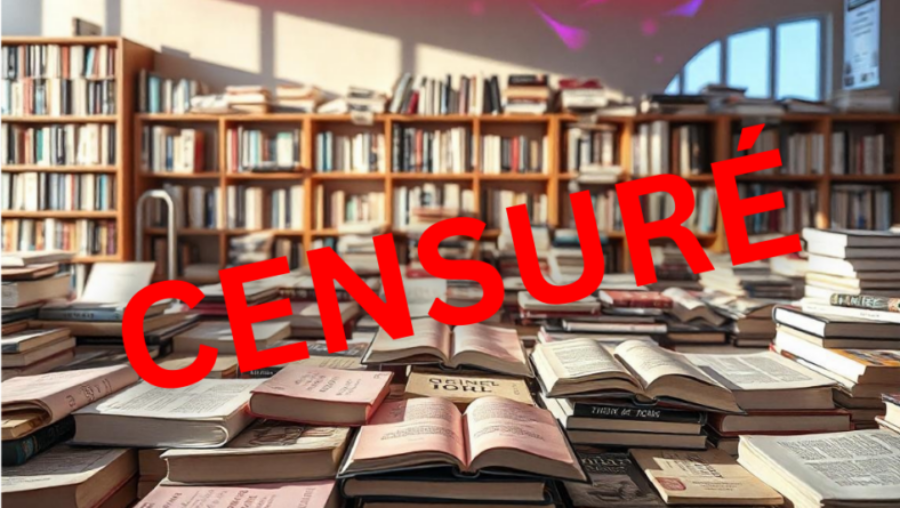
Laisser un commentaire
Créer un compte