Par Philippe Silberzahn.
Il est paru dans le dernier Libellio, une revue de recherche en management très originale et injustement mal connue, une intéressante discussion sur l’avenir du management stratégique entre plusieurs chercheurs éminents.
Le constat dressé sur l’état et l’avenir de cette discipline, aussi bien en tant que pratique qu’en tant qu’objet de recherche et d’enseignement, est très sombre. Étant moi-même enseignant et chercheur en stratégie, je livre ci-après mes réflexions sur les causes de cette situation.
Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d’en être l’organisateur. (Jean Cocteau)
Le premier problème du management stratégique est celui de ses bases ontologiques et épistémologiques. Malgré les efforts de quelques auteurs comme Mintzberg, la stratégie est essentiellement restée ancrée dans un paradigme positiviste et cartésien.
L’ancrage positiviste et cartésien
Elle promeut une vision mécaniste du monde vu comme une grande machine auquel l’acteur est extérieur. Logiquement, elle sépare la pensée et l’action : La pensée est la « patrie divine » tandis que l’action est simplement la combinaison des choses matérielles, de statut évidemment inférieur.
Il en découle une vision jupitérienne du management : le chef pense, lance ses éclairs du sommet du mont Olympe, et les subordonnés exécutent. Il y a ainsi encore des chefs d’entreprises, ancrés dans cette vision, qui se plaignent d’avoir un problème d’exécution quand tous leurs beaux plans ne mènent à rien.
Fort logiquement, les stratèges, parce qu’ils traitent de la « partie divine », développent un sentiment de supériorité par rapport aux autres disciplines, ce qui n’arrange pas les choses.
Il me souvient d’avoir lu, dans l’introduction d’un ouvrage de référence sur la stratégie, qu’elle était la matière noble du management. Les nobles, on leur a coupé la tête, non ? Dans le Libellio, elle est qualifiée de « fonction méta » qui « englobe les disciplines phares de la gestion ».
La stratégie n’englobe rien du tout
Basta, elle n’englobe rien du tout et l’arrogance est mauvaise conseillère, demandez à Nokia. Pourquoi par ailleurs faut-il penser encore en termes de hiérarchies et, Ô ironie, à partir du modèle de la chaîne de valeur de… Porter pour penser sa discipline ? La stratégie, observent Chia et Holt dans leur ouvrage Strategy without design, qu’on ne saurait trop recommander, ce n’est pas regarder le sommet, c’est regarder l’ensemble, et avec modestie.
Le second problème du management stratégique est lié à son utilisation d’outils. Depuis longtemps, et en cohérence avec la vision mécaniste du monde, la réflexion sur l’ensemble a cédé le pas à la constitution de diagrammes et à la création de matrices.
La stérilité de ces exercices est connue, et dénoncée, depuis longtemps par les plus illustres penseurs et industriels, mais rien n’y fait. On sait aussi qu’on peut utiliser le modèle des cinq forces pour démontrer que AirBnB, ou Dell dans les années 80, n’avaient aucune chance, que le marché n’était pas attractif pour eux. Il n’est rien qu’un bon modèle, par définition toujours ambigu, ne puisse démontrer. Le petit secret honteux du management stratégique c’est qu’avec ces diagrammes, il n’est pas stratégique, seulement tactique.
Le saint patron du management stratégique
Quant au saint patron, Michael Porter, comme contribution à la stratégie, on se rappelle que le grand homme avait écrit, à propos de la réussite des constructeurs japonais dans l’industrie automobile, que ces derniers n’avaient pas de stratégie. Si c’était vrai, cela démontrait l’inutilité de ses travaux. Si c’était faux, cela démontrait qu’il n’avait rien compris à la stratégie. Ou les deux ?
Avec la vision mécaniste de la stratégie, Descartes a triomphé de Montaigne ; la complexité, l’incertitude et l’ambiguïté du monde ont été niées avec des résultats catastrophiques.
Une stratège qui travaillait pour le département de stratégie d’une des plus grandes entreprises françaises, me disait, après la crise de 2008 : « On a appliqué tous les modèles de stratégie de manière parfaitement orthodoxe, avec les meilleurs cabinets, depuis vingt ans : résultat, on s’est planté partout, on a rien vu de la crise à venir, notre pensée stratégique est complètement en ruines. »
À l’heure des ruptures, de l’incertitude, et de la complexité, réduire la pensée en trois matrices et deux diagrammes simplistes est rien moins que criminel, comme si on donnait des AK47 à des enfants de quatre ans.
Ensuite, il y a le problème spécifique de l’académie et ce terrible aveu d’être arrivé à une impasse et surtout d’être devenu complètement inutile, aussi bien intellectuellement que sur le plan pratique. C’est l’acte d’échec d’une discipline.
Il serait trop long ici de l’analyser entièrement, mais de manière symptomatique, le Libellio évoque avec douleur la césure dans la recherche entre ceux qui étudient le contenu de la stratégie et ceux qui étudient comment la stratégie est produite. Voilà typiquement un débat qui n’intéresse personne et qui n’existe que parce qu’on reste enfermé dans un modèle positiviste.
La séparation entre conception et mise en œuvre ou entre contenu et processus est le péché originel de la pensée stratégique, maintes fois dénoncé, et cinquante après on demeure confondu qu’elle modèle encore la pensée académique sur la question.
La recherche : beaucoup de bruit pour rien
Mais plus profondément, le numéro évoque l’absence de contribution majeure de la recherche et le sentiment de ne plus avoir d’impact. Comment en est-on arrivé là ? L’explication est pourtant simple : il y a belle lurette qu’en recherche, les articles ne servent plus à contribuer au développement de la connaissance mais à l’avancement de la carrière de leurs auteurs.
Les institutions ont besoin d’une production mesurable et la production d’articles sert parfaitement cet objectif. Comme la publication devient la seule façon de faire carrière, et que la seule façon de publier est de se conformer institutionnellement, son formatage est naturel.
L’auteur de ces lignes se souvient, alors qu’il était jeune doctorant, être allé proposer un papier original (pensait-il) à un ponte de la spécialité. La réponse a été la suivante : ce sont des idées intéressantes, mais elles ne se rattachent à aucune conversation en cours, tu n’as donc aucune chance d’être publié. Et voilà le piège incrémental : pour publier, il faut parler de ce dont nos grands ancêtres parlent. Retour à la normale, suppression des outliers, notre sport préféré.
Et on s’étonne de n’intéresser personne ? Il doit y avoir deux mille articles publiés sur la notion de modèle d’affaire, coupant les cheveux en 18 avec une technique éblouissante, et pratiquement aucun d’entre eux ne dit la moindre chose intéressante par rapports aux pionniers que sont Osterwalder – pouah, un ouvrage pratique, et Clayton Christensen – oh, un autre ouvrage.
En effet, quelle ironie de voir que les travaux fondateurs du management stratégique, dont ceux de son saint patron, Michael Porter, ont été publiés dans des livres ! Horresco referens, Porter n’a jamais publié d’article scientifique.
En substance, les ruptures conceptuelles de notre champ (outliers éliminés de nos magnifiques processus castrateurs de peer review) se font dans les livres, et il reste à une myriade de petites mains comme nous à aller travailler sur les détails de l’œuvre du grand homme dans des revues de rangs divers.
Mais ça n’empêche nullement la caste scientifique de rejeter toute pensée originale venant des ouvrages, comme en témoigne le mépris stupéfiant dans lequel est encore tenu un auteur majeur comme Clayton Christensen, un de ceux ayant proposé une approche vraiment novatrice de la stratégie ces vingt dernières années, avec un contenu théorique et pratique extrêmement solide.
J’en valide pourtant régulièrement la pertinence au sein des entreprises – qu’on ne vienne pas me dire, comme le fait le Libellio, que les entreprises ne veulent pas entendre parler de stratégie. Mais non, malgré Porter et d’autres, l’académie méprise les livres et s’étonne que personne ne s’intéresse plus à ses travaux.
L’autre ironie, bien sûr, est que Porter n’était pas du tout stratégiste, mais économiste, et qu’au fond, la base de la pensée stratégique est constituée par l’économie industrielle, un vieux courant mécaniste des années 70 habilement réincarné en matière noble, dont l’unité d’analyse était le marché, pas la firme. La vérité est qu’il n’y a pas de pensée stratégique autonome, seulement des emprunts (Ah Sun Tzu) et une pensée bâtarde en résultat ; dominatrice certes, mais peu sûre d’elle au final.
Stérilité de l’enseignement
Reflet direct de la stérilité de la pensée académique, la majorité des cours de stratégie – et l’auteur de ces lignes en a donné dans un paquet d’institutions – est encore largement basée sur les travaux de Bruce Anderson (fin des années 60) et de Porter (fin des années 70).
Comme si le monde n’avait pas radicalement changé depuis quarante ans ! On enseigne toujours la stratégie comme si on enseignait le morse comme introduction à Internet. On gave nos étudiants de 5 forces, SWOT et autres matrices BCG alors que la stérilité de ces exercices est reconnue depuis longtemps.
Il vaudrait mieux enseigner le latin, il y aurait au moins une dimension culturelle. Pourquoi le fait-on ? Eh bien parce qu’il faut bien enseigner quelque chose ! Et qu’enseigner le remplissage de diagrammes c’est facile et pratique, et les étudiants adorent ça. Descartes s’enseigne facilement, même si c’est nocif ; Montaigne pas vraiment, même si c’est fertile.
En plus ça donne l’impression de comprendre le monde en cinq forces et huit cases. C’est jouissif ! Et hop, Suez, Danone ou General Electric, cinq forces, des chiens, des vaches, des étoiles, des forces et des faiblesses, youplaboum, yapluka !
Mais il y a une troisième ironie, est qui est le vrai drame de la pensée stratégique, c’est que si nous, académiques, pleurons sa disparition, elle se fait quand même dans les firmes.
Il existe une activité qui n’est ni le marketing, ni la finance, ni la gestion opérationnelle, bref, une activité qui représente un champ distinct. Mais elle n’est pas identifiable, elle est diffuse, elle est Montaigne, pas Descartes, et c’est tout le problème. Ou plutôt, c’est un problème si l’on reste dans notre bon vieux paradigme positiviste et cartésien. S’il y a stratégie, alors il doit y avoir un stratège quelque part ! Comment résoudre cette énigme ?
Good science starts with good definitions
Comme souvent, tout est affaire de définition. Dans le Libellio, mon collègue Philippe Monin a la bonne idée de repartir d’une définition du management stratégique, utilisant celle de Nag, Hambrick et Chen (2007) selon lesquels le champ du management stratégique traite (1) des principales initiatives, délibérées ou émergentes, (2) engagées par les dirigeants au nom des propriétaires, (3) relatives à l’utilisation de ressources (4) afin d’accroître la performance (5) des entreprises (6) dans leurs environnements externes.
Magnifique définition qui satisfait aux canons de l’académie, mais qui reste, encore et toujours, ancrée dans le positivisme et le cartésianisme, ce qui conditionne, naturellement, la façon dont la question va être abordée : sans parler du fait qu’il est supposé qu’il faille une stratégie pour performer, celle-ci est faite par les dirigeants (pleure, Ô Burgelman) ; aucune mention n’est faite de la mise en œuvre ; les ressources sont au service de la stratégie, elles ne sont pas pensées comme pouvant la déterminer (Pleure, Ô Penrose) ; elle évoque le terme d’initiative émergente – délicieux (il se passe un truc, on n’y est pour rien mais on va le qualifier de stratégie) mais surtout on peut y faire rentrer ce qu’on veut : quelle initiative n’a pas pour objet d’accroître la performance d’une entreprise, exactement ? Un plan marketing ou financier, ou la rationalisation de la fabrication, répondent exactement aux critères de messieurs Nag, Hambrick et Chen.
Ceci alors que l’académique estampillé Label Rouge Richard Rumelt a, dans un ouvrage – ah encore un ouvrage – proposé une bien meilleure définition de la stratégie qui, elle, est véritablement opérante et différenciante :
La stratégie est le mélange cohérent de politique et d’action conçu pour résoudre un défi fondamental de l’organisation.
Quand Steve Jobs reprend Apple en 1996, son défi fondamental est le besoin de liquidités. Personne ne veut lui donner d’argent. Il va alors voir Microsoft, son ennemi mortel (lui et Bill Gates se détestent depuis toujours) parce qu’il sait que la firme de Redmond ne peut pas se permettre de voir Apple mourir : elle deviendrait ipso facto un monopole.
Coup de maître : en un coup de fil, il convainc Microsoft d’investir 150 millions de dollars, relançant ainsi la firme à la pomme. Ressource ? Performance ? Environnement externe ? Messieurs Nag, Hambrick et Chen n’ont strictement rien à dire sur un coup stratégique qui est un cas d’école et dans lequel la dimension humaine est essentielle.
Son problème de liquidités étant réglé, le nouveau défi fondamental d’Apple est de sortir vite des produits un tant soit peu originaux pour relancer le commerce. C’est l’heure des gimmicks avec des Mac vert fluo. Tout le monde se moque – pas de stratégie !- mais ça marche. L’entreprise à nouveau sur les rails, le défi fondamental devient alors d’imaginer des produits plus disruptifs pour créer de nouvelles sources de croissance.
Mais lesquels ? « Quelle stratégie ? » demande Rumelt à Jobs en 1997. Réponse du maître : « Je vais attendre la prochaine vague. » Attendre ! Comme stratégie ! ça sera l’iPod, sur lequel Jobs tombe presque par hasard. Mes chers confrères, difficile de faire entrer la pensée de l’industriel le plus spectaculairement innovant des trente dernières années, ayant à lui seul réinventé au moins trois industries (informatique, musique, téléphonie), dans la définition de Nag, Hambrick et Chen ou même de Porter.
Quand nos modèles ne correspondent plus à la réalité, nous sommes au bout du rouleau, et il faut changer de paradigme. Le management stratégique est mort, au moins dans l’académie, mais ce n’est pas grave par ce qu’au fond, a-t-il vraiment existé ailleurs que dans nos têtes ?
—


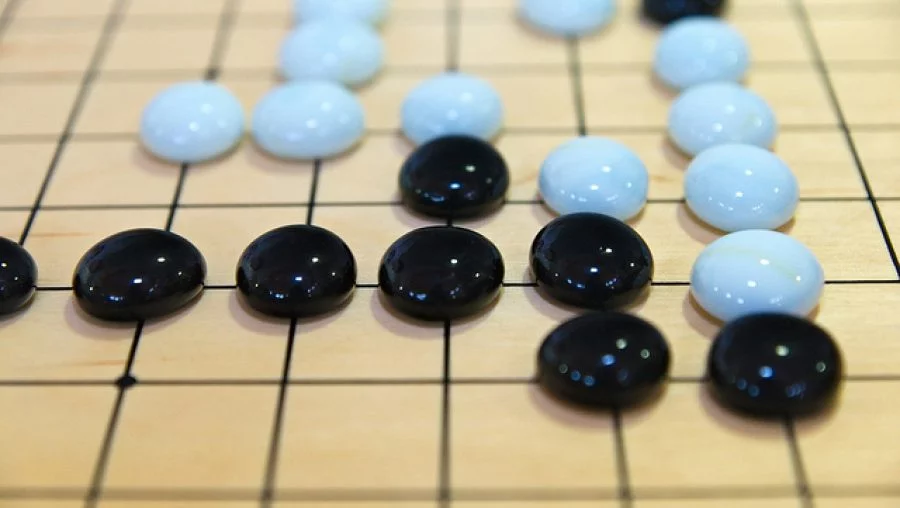


Il y a aussi Dyson qui illustre ce Propos.
L’intuition ,l’imagination sont essentiels. Un intérêt complet (voir une passion) pour le produit et son utilisation .
La stratégie qu’évoque l’auteur est souvent l’accompagnement des gestionnaires …