Par Manuel Dorion-Soulié.
Un article de The Conversation

En campagne électorale, Donald Trump a promis de mettre fin à l’aventurisme en politique étrangère et à la défense inconditionnelle des alliés traditionnels. Contrairement à Hillary Clinton et aux « élites washingtoniennes », il assuré qu’il n’entraînerait pas les États-Unis dans des guerres inutiles et ruineuses.
Trump a isolé les néoconservateurs comme responsables de l’invasion de l’Irak de 2003 et donc de la déstabilisation du Moyen-Orient et de l’émergence de l’État islamique. Il a même attaqué nommément l’une des figures de proue du mouvement, William Kristol, un « perdant » qui ne songerait qu’à « faire la guerre et tuer des gens ». Les néoconservateurs, très bien représentés chez les conseillers de (presque) tous les candidats aux primaires républicaines de 2012 et 2016, ont-ils vraiment perdu leur ascendant sur le parti ? Assisterait-on à la mort tant de fois annoncée du néoconservatisme ?
« Pourrissement moral »
Répondre à ces questions exige de définir au préalable la pensée des néoconservateurs. Justement, leur critique de Trump offre une fenêtre sur leur vision du monde. Ils ont bien sûr bruyamment décrié l’isolationnisme et le protectionnisme de Trump comme autant de menaces pour l’ordre international que les Américains soutiennent depuis 1945. Robert Kagan, chantre de la Pax Americana, en vint même à soutenir publiquement Hillary Clinton.
Surtout, les néoconservateurs comme Eliot Cohen voient en Trump l’incarnation du « pourrissement moral », du déclin de la « culture de la vertu » (intégrité, abnégation, frugalité, modestie, dignité) qui sous-tendent la démocratie américaine. Se disant tocquevilliens, ils croient au besoin, pour une démocratie, d’insuffler à ses citoyens la capacité de sacrifier leur intérêt privé au bien commun. Pour eux, cela pourra passer par l’inculcation des vertus martiales. La conclusion de Cohen est typiquement néoconservatrice : Trump serait un personnage moins affligeant s’il n’avait pas échappé à la conscription à l’époque du Vietnam.
Ennemi utile
Cette critique « culturaliste » révèle l’essence du néoconservatisme. Dans les années 1960, Irving Kristol (père de William) et consorts redoutaient les « excès » de la contre-culture. Pour les premiers néoconservateurs, la révolution sexuelle et l’opposition à l’impérialisme américain, fondées sur une pensée hédoniste, individualiste et antipatriotique, signalaient la décadence du libéralisme américain. Ce relativisme moral était l’ennemi intérieur qui sapait la volonté nationale face à l’ennemi extérieur communiste.
Pour y remédier, ils se serviraient de l’ennemi extérieur, et revitaliseraient le patriotisme par une politique étrangère d’affirmation agressive de l’universalité des principes américains. Cette logique les fit combattre la détente de Nixon et Kissinger, le moralisme mou de Carter et même la complaisance de Reagan (qu’ils ont pourtant soutenu, et qui leur a permis d’entrer au gouvernement) face aux ennemis d’Israël et face à Gorbatchev.
À la fin de la Guerre froide, ils perdirent cet ennemi utile. Ils en trouvèrent un autre le 11 septembre 2001 et ils comptèrent parmi les plus ardents promoteurs d’une stratégie militariste maximaliste dans la « guerre à la terreur ». Nuançons cependant leur influence sur la décision de 2003 : Bush, Cheney et Rumsfeld ne sont pas néoconservateurs. Le premier partage leur manichéisme sans adopter leur théorie du libéralisme, tandis que les deux autres ont en commun leur bellicisme mais ignorent leur moralisme et défendent une vision beaucoup plus « techniciste » de l’empire. Ainsi, les néoconservateurs n’hésitèrent pas à critiquer fortement la stratégie adoptée par Rumsfeld en Irak… Surtout quand il apparut évident qu’elle avait échoué.
Vertus martiales
En 2006, la catastrophe de l’occupation américaine et le remaniement de l’administration Bush firent croire à la fin de l’influence des néoconservateurs. Or, c’est précisément à cette époque qu’ils connurent leur plus grand succès : Eliot Cohen et Frederick Kagan (frère de Robert) comptèrent parmi les acteurs cruciaux de l’adoption du « surge » de 2007, stratégie de contre-insurrection impliquant le maintien quasi-permanent de petits postes avancés dans tous les quartiers des villes irakiennes.
Le « surge » illustre la grande stratégie néoconservatrice, faite d’interventions terrestres et de maintien d’innombrables garnisons aux frontières de l’empire. Exporter la démocratie « prouverait » l’universalité des principes américains, et militariser la société américaine contribuerait à revitaliser les vertus martiales : c’est ainsi que les néoconservateurs combattent le relativisme moral et la décadence démocratique.
Si Trump abjure les changements de régime et le nation-building, son discours signale aussi que sous sa présidence, la militarisation de la société américaine ira croissante. En ce sens, les néoconservateurs n’ont pas tout perdu avec son élection. Mais le rejet de l’internationalisme par le Parti républicain marquerait leur expulsion d’une maison politique qu’ils habitent depuis les années Reagan.
Dans les années 1970, les néoconservateurs ont abandonné les démocrates car le parti ne soutenait plus leur internationalisme agressif. Pourquoi ne rebrousseraient-ils pas chemin ? Tant que l’un des deux partis souhaitera mener une politique impériale, les néoconservateurs seront courtisés pour leurs talents de publicistes (et de polémistes), et leur influence potentielle demeurera une réalité dans le paysage politique américain.
Manuel Dorion-Soulié, Doctorant en histoire internationale, Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID)
La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation.


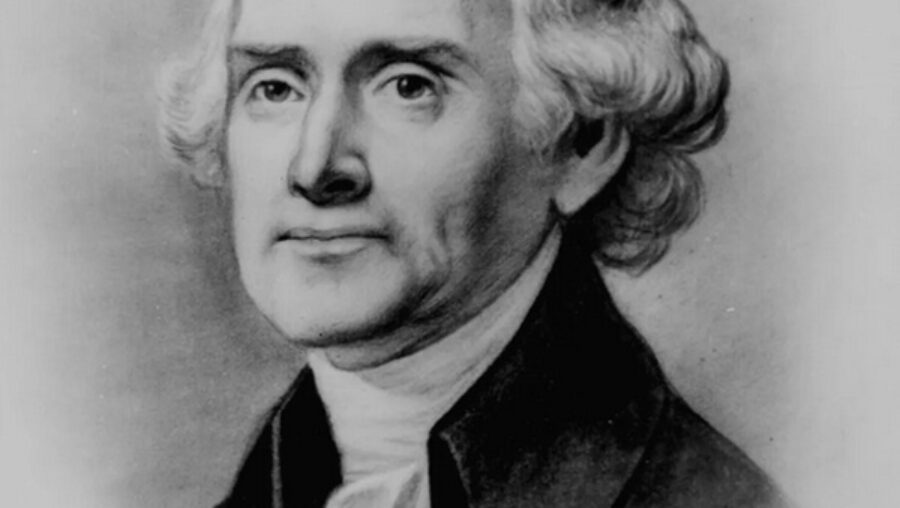
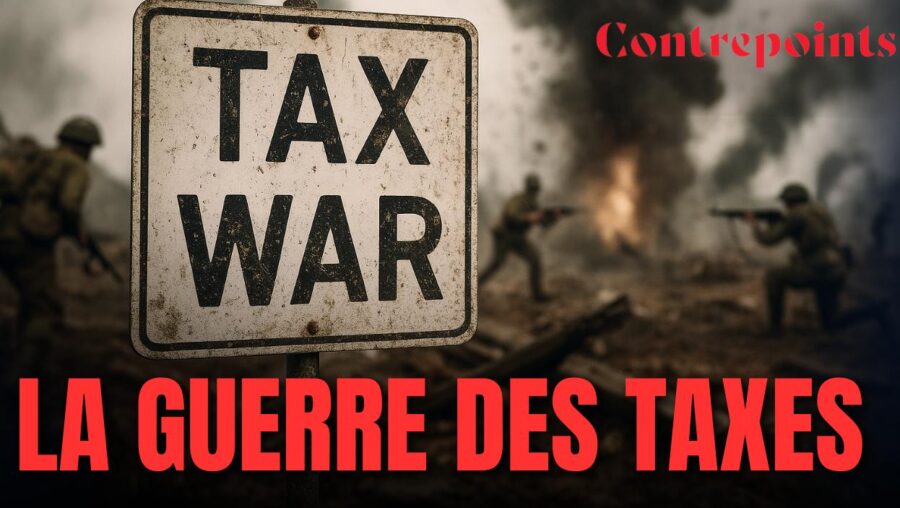

Article manichéen par excellence, donc sans intérêt.
Article simpliste et approximatif. Irving Kristol fut d’abord un militant trotskiste actif, représentatif d’une extrême-gauche américaine des années 70 déçue par un constat d’échec du communisme soviétique qui bascula dans ce qui fut appelé “néo-conservatisme”.