Par Pierre-Marie Meeringen.

La décision du Conseil constitutionnel du 10 février 2017 par laquelle celui-ci a annulé les dispositions de la loi du 3 juin 2016 relatives au délit de consultation individuelle de sites terroristes a dû sonner comme un coup de tonnerre au sein de la 16e chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance de Paris.
Alors que depuis plusieurs jours, les prévenus défilent devant la juridiction selon un circuit court, consacré aux « petits » actes terroristes, ceux qui ont été jugés le 9 février ont dû regretter de ne pas l’être le lendemain : le Conseil constitutionnel a purement et simplement supprimé le texte qui fondait les poursuites engagées contre eux, suivant en cela la magistrale plaidoirie de l’avocat et romancier François Sureau.
Le raisonnement tenu par le juge constitutionnel consiste dans l’application de critères dégagés par sa propre jurisprudence depuis sa décision du 18 septembre 1986. En substance, la question se posait de savoir si l’atteinte à la liberté de la communication qu’entraîne l’incrimination de la consultation habituelle de sites provoquant le terrorisme ou faisant l’apologie de celui-ci présentait les caractères de nécessité, d’adaptation et de proportionnalité susceptibles de justifier une telle atteinte. Sur ces points, la réponse du juge constitutionnel est claire mais ne va pas sans susciter des interrogations concernant la lutte contre le crime organisé.
L’atteinte à la liberté de communication pas nécessaire
L’atteinte à la liberté de communication portée par cette loi n’était, aux yeux du juge constitutionnel, pas nécessaire. La décision relève ainsi la multiplicité des dispositions du Code pénal incriminant déjà les faits liés au terrorisme, notamment l’apologie du terrorisme, l’incitation, l’association de malfaiteurs, l’entreprise individuelle de terrorisme, la préparation d’actes terroristes.
Notons que cette dernière infraction, prévue par l’article 421-2-6 du Code pénal, sanctionne déjà explicitement la répression de faits constitutifs de préparation d’un acte de terrorisme, caractérisé notamment par « la consultation habituelle d’un ou de plusieurs services de communication au public en ligne provoquant directement à la commission d’actes de terrorisme ou en faisant l’apologie ». Dès lors que le droit existant permet déjà, selon le juge constitutionnel, de contrôler, surveiller et interpeller des personnes qui consultent des sites djihadistes lorsque leur intention criminelle est avérée, cette nouvelle atteinte à la liberté de communication n’est selon lui pas nécessaire.
Ce faisant, il sanctionne une législation déjà fort brouillonne et redondante sur le terrorisme, la fébrilité du législateur ayant incontestablement, depuis plusieurs années, nui à la qualité de sa production législative.
Le problème de la proportionnalité de l’atteinte à la liberté de communication
Plus discutable est, à nos yeux, le raisonnement du Conseil constitutionnel concernant l’adaptation et la proportionnalité de l’atteinte à la liberté de communication. Celui-ci relève que la loi en cause condamne la consultation de l’usage de sites terroristes et ce alors même que l’auteur des faits n’aurait eu aucune volonté de commettre des actes terroristes, ni même d’ailleurs manifesté son adhésion à l’idéologie exprimée sur ces sites.
Bien que le législateur ait explicitement exclu la pénalisation de la consultation effectuée « de bonne foi » (notamment par des professionnels, chercheurs ou enquêteurs), une telle incrimination, indifférente à la volonté du mis en cause, constitue pour cette raison même une atteinte excessive à la liberté de communication.
L’interprétation de la décision du Conseil constitutionnel est, sur ce point, moins aisée qu’il n’y paraît. À première vue, il y a lieu de se réjouir de cette approche libérale de la pénalisation des comportements sur Internet. En effet, face aux dangers qui découlent de la cybercriminalité, le législateur paraît, en France comme dans la plupart des pays occidentaux, osciller entre une approche libérale et une approche répressive d’Internet.
Or, en sanctionnant la consultation (et non plus seulement la diffusion) de sites, le législateur s’était engagé dans une démarche prohibitionniste, qui est déjà celle que prévoit la législation en vigueur en matière de lutte contre la pédopornographie. Dans un contexte marqué par un durcissement de la répression des actes liés au terrorisme, la décision du Conseil constitutionnel peut donc s’interpréter comme le rappel du principe de la liberté de l’usager d’Internet : la possibilité pour tout un chacun de surfer de page en page et de site en site doit, aux yeux du Conseil constitutionnel, pouvoir être préservée de la tentation de l’État d’étendre à l’infini les exigences de la sécurité au détriment des libertés publiques.
La lutte contre les réseaux criminels
Toutefois, à y regarder de plus près, le raisonnement tenu par le Conseil constitutionnel a pour effet de gommer certaines réalités de la lutte contre les réseaux criminels transnationaux.
Un exemple nous permettra d’expliciter ce point de vue.
La consultation habituelle de sites pédopornographiques est réprimée, nous l’avons dit, par l’article 227-23 du Code pénal. De fait, certains usagers de site Internet pédopornographiques font l’objet de poursuites, alors même qu’ils ne sont jamais passés à l’acte et qu’ils n’ont en réalité rien du profil psychologique du pervers pédophile susceptible d’agir : l’intention de l’internaute est aujourd’hui totalement indifférente à la qualification pénale des faits.
Le fait que les auteurs de ces faits puissent être poursuivis alors même qu’ils n’ont pas l’intention de passer à l’acte fait-elle de cette incrimination une atteinte excessive à la liberté de communication ? Si l’on suit la décision du Conseil constitutionnel, il semble que oui ; et il sera à cet égard intéressant de suivre sa jurisprudence sur ce point.
Pourtant, la lutte contre les trafics transnationaux impose de s’extraire d’une approche exclusivement individualiste de la répression pénale. En effet, ce qui, en matière de pédophilie, justifie aujourd’hui l’interdiction de consulter les sites Internet n’est pas tant la dissuasion des actes pédophiles susceptible d’être commis par un individu que la volonté de lutter contre des réseaux transnationaux dont l’individu en cause n’est qu’un maillon : en consultant de tels sites, les auteurs de ces faits encouragent la diffusion de ce type de sites et, corrélativement, les atteintes aux mineurs qu’ils mettent en scène. Tuer la demande doit finir par tuer l’offre : la volonté ou l’absence de volonté de l’auteur de passer à l’acte ne change rien à l’affaire.
Comment déstabiliser les trafics ?
Qu’il s’agisse des réseaux de pédopornographie, de trafics de stupéfiants, de trafic d’êtres humains à fins d’exploitation sexuelle, les questions sont toujours les mêmes : quelle stratégie utiliser pour déstabiliser les trafics ? Faut-il réprimer la demande ou l’offre ? Les entrants ou les sortants ? Le consommateur final ou les intermédiaires ?
En réprimant la consultation des sites terroristes, et ce alors même que les usagers n’avaient aucune intention de commettre des faits, les dispositions de la loi aujourd’hui censurée offraient aux parquets et aux enquêteurs une angle d’attaque, certes limité et imparfait, contre les réseaux terroristes, en tentant de décourager la diffusion de ces contenus par la prohibition de leur « consommation » par les usagers.
Soyons clairs : nous ne pleurerons pas le délit défunt, peu utile au regard de la législation existante et de l’atteinte aux libertés qu’il suppose. Mais nous regretterons l’absence de stratégie pénale en matière de lutte contre les réseaux criminels transnationaux sur Internet.
Plutôt que de s’interroger à perte de vue sur le quantum des peines ou le régime de détention encourus, il conviendrait plutôt, face au terrorisme, de réécrire le droit pénal en s’interrogeant sur les moyens concrets, compatibles avec les libertés publiques, de déstabiliser les réseaux sur lesquels il s’appuie. Sur ce point essentiel à la sécurité publique, la pensée stratégique devrait l’emporter une fois pour toutes sur la dérive émotionnelle.



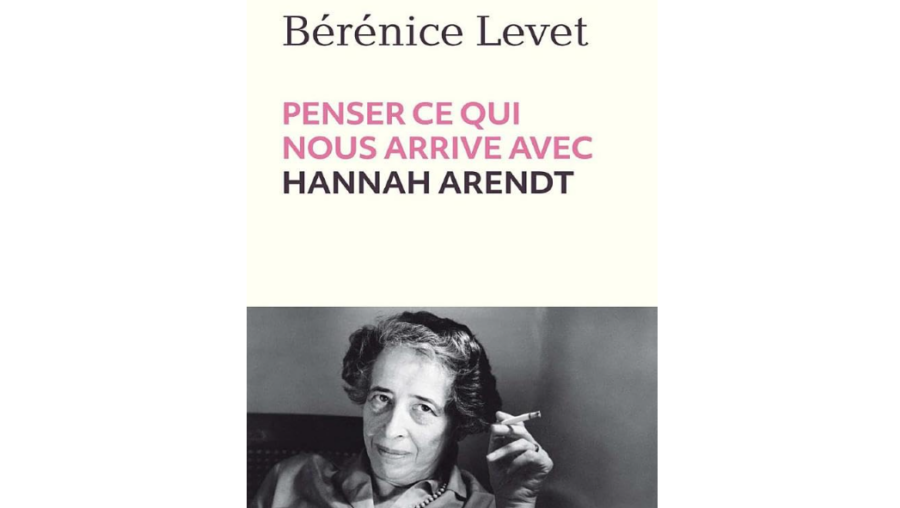

On interdit des sites qui défendent leur point de vue sur sur l’avortement (je respecte l’idée que l’on puisse être pour ou contre), mais on tolère la consultation de sites encourageant le terrorisme, sans même s’interroger sérieusement sur l’interdiction des sites eux-mêmes. À méditer…
Personne n’est condamné pour consultation de sites anti-avortement.
Il n’y a pas de raisons pour que des gens soient condamnés pour avoir consulté des sites d’islamistes radicaux.
Deux remarques sur cet article intéressant :
– les systèmes de consultations anonyme d’Internet et les sites du très fameux Dark web rendent les précautions juridiques obsoletes aujourd’hui. Légiférer sur l’interdiction de sites de tel ou tel type n’a pour objet que de rassurer une population (qui globalement est étrangère à ce sujet AMHA) et de permettre des actions répressives grace a des textes spécifiquement préparés à cet effet (dans l’esprit de l’Etat d’urgence devenu permanent, en contradiction avec la définition même du concept d’urgence).
– prohiber la consultation de sites traitant du terrorisme, de la pedophilie, de la fabrication de drogues, de négationniste, ou de n’importe quel comportement délictuel ou criminel ne permet pas à tout un chacun de se forger une opinion éclairée sur ces sujets. C’est considérer à la base que les citoyens sont des enfants qu’il faut protéger de tous les dangers. L’abrutissement généralisé issu d’une DésEducaction Nationale touche ici son point d’orgue.
Au final, Minority Report ou 1984 et sa police de la pensée sont déjà présents dans notre quotidien : au nom de la protection dès population on met en place des mécanismes répressifs qui n’auront plus de limites à l’avenir. Plutôt qu’informer, qu’expliquer, on interdit. On pénalise les clients des prostituees parce qu’on n’arrive pas à s’attaquer aux réseaux de traffic humain. On prohibe le négationnisme pour préserver des liens internationaux, des appuis politiques et pour perpétuer un sentiment de culpabilité de notre pays. On interdit la consultation de sites djihadistes ou terroristes plutôt que mettre un nom sur le problème et désigner les sources du mal au grand jour, préservant ainsi nos approvisionnements en pétrole, nos financements de clubs sportifs ou de partis politiques.
La Loi est dévoyée au nom de bonnes intentions. C’est préjudiciable à la société, profondément.
La peur n’évite pas le danger, fermer les yeux n’empêche pas les accidents…
Je vous concède José que personne n’est condamné pour consulter un site défendant l’anti-avortement puisque que ces sites sont interdits.
Mais il est intéressant que vous mainteniez la comparaison (s’il on ne condamne l’un alors aucune raison de condamner l’autre). Je visais justement à montrer la disproportion entre les deux causes, et je remarque qu’elle ne saute pas aux yeux de tous. On vit vraiment une drôle d’époque 🙂