Par Pierre Tarissi.

Dans le discours de nos hommes politiques, le propos sur les inégalités est non seulement courant, mais un passage obligé… Chacun ne parle que de les réduire et explique qu’elles sont insupportables, à grand renfort de déciles, de coefficient de Gini, et autres éléments statistiques …
Qu’en est-il très concrètement ?
Égalité parfaite chez les pré-humains
Dans une troupe de proto-humains il y a un million d’années, il régnait la plus grande égalité : tout le monde avait le même patrimoine et le même revenu (à savoir zéro). Le plus costaud, ou le plus agressif des hommes avait juste un avantage sur le nombre de femmes et la part de fruits auxquels il pouvait prétendre : c’était donc le chef. Il avait ainsi une plus grande chance que les autres de vivre un peu plus longtemps (espérance de vie inférieure à 20 ans) et d’assurer sa descendance.
Donc, patrimoine de tous égal à zéro, revenus égaux à zéro, aucun pauvre et coefficient de Gini égal à zéro : excellent !
En cas, sans doute fréquent, de famine, pour cause climatique, d’incendie, d’épiphytie ou autre, la situation se complique. Comme il est quasi-impossible de stocker la nourriture, il n’y a que deux solutions. La première est d’étendre le territoire sur lequel on prélève la nourriture (gibier ou végétaux) quitte à casser la figure du voisin qui ne serait pas d’accord pour céder son territoire. L’autre solution (à très court terme) étant de manger le voisin lui-même : là aussi, il faut commencer par lui casser la figure, puisqu’il y a peu de chances pour qu’il soit d’accord !
Hier, pour être riche : casser mieux que la moyenne la figure du voisin !
Pendant très longtemps d’ailleurs, casser la figure du voisin a été la seule façon connue de s’enrichir, dans une économie stable, où en gros au moins 95 % de paysans travaillaient péniblement pour arriver à nourrir (mal) eux-mêmes et les 5 % restants. Le développement économique étant très faible et à la merci de la moindre famine ou épidémie, la guerre était la seule façon d’agrandir la richesse de chacun en se procurant des esclaves et des territoires cultivables, ainsi que quelques matières premières. D’où les expansions territoriales, seul mode d’équilibre un peu durable (Rome, Carolingiens et tant d’autres). Avec la guerre, il y avait aussi le commerce qui lui était largement lié (Cités grecques, Venise, Pise, Gênes …).
À partir de la Renaissance, tout change avec l’émergence en Occident de la méthode expérimentale qui permet de faire décoller la recherche, l’innovation et l’industrie que nous connaissons. Les premières entreprises voient le jour et commencent à créer des produits nouveaux – comme les livres imprimés – et à écraser leurs coûts, les rendant ainsi accessibles à tous …
Aujourd’hui, pour être riche : imaginer et créer plus de richesses pour tous !
C’est un changement fondamental, accompagné par les outils monétaires mis au point de longue date (Xe-XIIe siècles), le crédit et l’assurance, qui vont eux aussi se développer de façon colossale. Il est aussi boosté par les Universités – également créées en Occident à la même époque), d’abord gardiennes, puis de plus en plus créatrices du savoir. Enfin n’oublions pas la variable essentielle : la (re)découverte inespérée, à partir du XVIIIe siècle, d’énergie à très bas coût, en fait de l’énergie solaire stockée sous forme de biomasse transformée : les hydrocarbones fossiles (charbon, pétrole, gaz).
Il y a 300 ans était riche celui qui cassait la figure de son voisin plus efficacement que la moyenne. Aujourd’hui, le riche sait imaginer puis fabriquer en masse un produit ou un service que beaucoup d’autres lui achètent volontairement
Mais ce faisant, ceux qui innovent et se mettent à produire deviennent riches non plus parce qu’ils ont cassé la figure de leurs voisins de façon plus performante que la moyenne, mais parce qu’ils se sont mis à produire plus et à plus bas prix des produits (biens et services) nouveaux et plus intéressants.
Il s’agit dès lors d’augmenter la production, en trouvant des gens d’accord pour échanger autre chose – évalué sous forme d’argent, seule mesure commune – contre ces nouveaux biens. L’activité économique moderne – à savoir post-méthode expérimentale – et plus précisément l’innovation et l’industrialisation, donne la prospérité à tous, par la création de nouveaux produits et l’écrasement de leurs coûts – ce qui permet de les répandre largement. Toute amélioration concrète du sort des autres en leur fournissant un produit ou service plus efficace et durable se traduit donc mécaniquement par l’enrichissement de ceux qui y parviennent – chercheurs, innovateurs, entrepreneurs -, et de leurs collaborateurs.
Encourager les riches présents et futurs, la meilleure façon d’enrichir les pauvres
En effet, pour arriver à produire massivement, le futur riche est contraint de fabriquer un produit ou service de bonne qualité, qui corresponde à un besoin (le plus souvent non exprimé par les futurs clients : jamais personne n’a demandé à disposer d’une automobile ou d’un tableur) et qui rende le service attendu. Il doit surtout écraser ses coûts, en perfectionnant son processus de production pour en vendre beaucoup à un prix bas.
Évidemment, il aura d’autant plus de chances de s’enrichir que son produit sera innovant : il bénéficiera ainsi d’une période plus ou moins longue sans concurrence – et donc à plus forte marge ! Plus on a de personnes de ce genre – donc chercheurs, entrepreneurs et investisseurs – qui diffusent des produits et services nouveaux, mieux chacun se porte dans sa vie de tous les jours – et plus on a de super-riches. La notion de « produit et service nouveau » va du spectacle (sports compris…) jusqu’à la plus haute technologie (par exemple les smartphones) en passant par la mode vestimentaire.
Si nous raisonnons en termes de patrimoine, là encore seule la situation d’égalité des hominidés est parfaite : comme il n’y a rien, personne ne possède rien. En fait, dès qu’il y a revenu, quel qu’il soit, il y a constitution d’inégalités de patrimoine, puisque le montant d’un patrimoine dépend très largement de la propension à épargner de chacun. Celle-ci – très variable – dépend du libre-arbitre des choix individuels. Avec les mêmes revenus et dans les mêmes conditions, un tel épargnera, tel autre s’endettera. Avec le développement de la production industrielle, la notion d’épargne se développe d’ailleurs : cela constitue en clair des stocks de travail, que l’on peut réinvestir pour innover et produire encore plus de nouvelles richesses.
Sommes-nous sûrs d’employer les bons indicateurs de pauvreté ?
Pour arriver à gérer sainement le dossier inégalités, il convient sans doute, comme souvent, de revoir les indicateurs économiques employés. La grande pauvreté, définie comme un revenu inférieur à une certaine somme journalière en dollars (1,90 dollars par jour sauf erreur) baisse continuellement partout dans le monde. En revanche, la pauvreté des pays occidentaux est définie en pourcentage de la médiane des revenus (50 ou 60 %).
Cela ne dit rien de concret sur l’amélioration réelle des conditions de vie des pauvres, surtout en cas de récession. Dans certains cas, on peut très bien en décompter moins alors que les revenus de tous baissent – ou plus de pauvres quand les revenus de tous montent. Il serait sans doute plus pertinent de la définir par une somme journalière absolue, exprimée en parité de pouvoir d’achat selon les pays. Et arrêter ainsi d’exciter la jalousie sociale en se focalisant sur les inégalités, qui n’intéressent personne dès lors que la situation de tous s’améliore. Cela dépend directement de l’éducation donnée aux citoyens et de sa conséquence, la capacité du pays à innover.
—


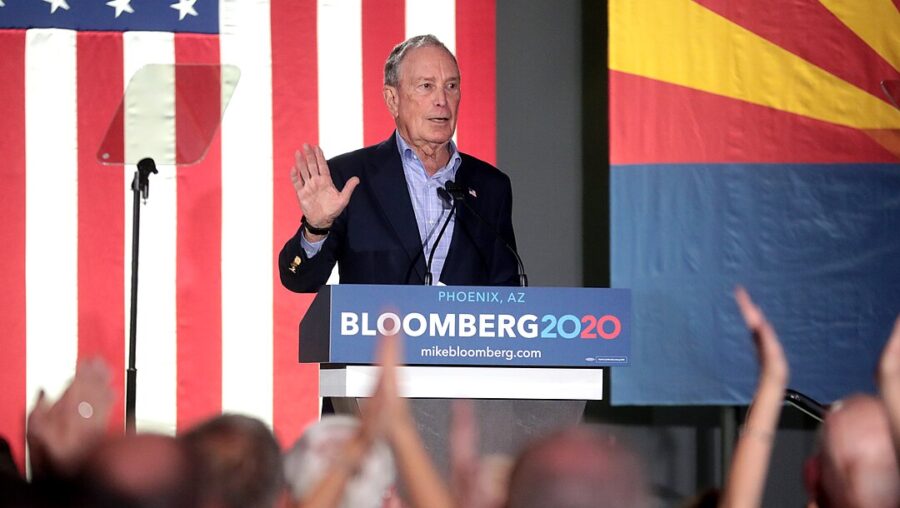


Merci de rappeler les deux définitions de la pauvreté.
A propos de notre façons de la mesurer (en pourcentage de la médiane des revenus (50 ou 60%), Jacques Marseille disait que “tant que nous aurons des riches, nous aurons des pauvres”.
De quoi assurer de beaux jours à l’Etat providence, non?
Bonjour Dominogris, Bonjour à toutes et à tous,
A l’Etat providence, certes, mais surtout à l’innombrable armée de fonctionnaires et de bénévoles (certains sincères, d’autres nettement moins) qui s’engraissent en gèrant à grands frais et de façon inefficace l'”aide aux pauvres” …
Amitiés,
Pierre
Et c’est tout le problème de la fRance :
– on punit le travail,
– on punit la prise de risque,
– on punit la capacité à épargner (investissements futurs).
Ensuite on s’étonne :
– chômage de masse,
– paupérisation,
– endettement.
Puis on trouve des solutions :
– punir encore davantage le travail,
– punir encore davantage la prise de risque,
– punir encore davantage les épargnants.
Mais jamais, non, jamais on ne remettra en question :
– le fardeau fiscal,
– le mode d’imposition/taxation (progressivité),
– le code du travail,
– les diverses politiques publiques.
Bonjour Xavier C, Bonjour à toutes et à tous,
Il faudra pourtant bien arriver à se poser ces questions basiques (et surtout à répondre) sinon un scénario “façon Grèce” s’en chargera tôt ou tard (et plus tôt qu’on ne l’imagine …).
Amitiés,
Pierre
Les hommes ne sont pas égaux, hormis en droit.
Certains sont grands, d’autres pas. Certains sont maigres, certains ont la peau pâlichonne, certains ont des cheveux longs, certains sont capable de faire à manger a une grande tablée avec trois fois rien, certains sauront imaginer une nouvelle source d’énergie, concevoir de la musique, la jouer. Certains ont une aptitude à l’autorité, à la faire respecter ou à s’y soumettre. Certains sont intelligents, d’autres sont des cretins (au sens médical).
Certains sont des femmes, d’autres des hommes, d’autres enfin dissocient personnalité et physique.
L’éducation reçue, le milieu dans lequel on vit, la culture du moment : ce qui forme un “homme” est un ensemble de critères infinis, qui vont bien au-delà de sa richesse économique, de son patrimoine, de sa capacité de travail ou de son revenu.
Prétendre réduire les inégalités est une fiction, une imposture, un mensonge institutionnel.
Les inégalités sont sources de richesse.
D’ailleurs, dans notre pays qui prône l’égalitarisme à tout va, on prône en même temps la diversité. Belle prouesse de langage qui consiste à dire que la diversité des humains doit être respectée, mais qu’ils sont tous égaux.
Schizophrénie politique à laquelle tout le monde adhère…
Bonjour “PukuraTane”, à toutes et à tous,
La “pensée de gauche” n’existe plus en ce début de XXIe siècle, sauf pour ânonner des idées abstraites et vagues (l'”égalité”, l'”antiracisme” …) qui n’apportent rien, mais dénotent une fascination morbide pour le déclin et l’autodestruction …
Clairement, le progrès est ailleurs …
Amitiés,
Pierre