Par Jean Senié.
Un article de Trop Libre
 Les attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris, ainsi que le drame récent de Bruxelles, faisant suite à d’autres événements de même nature, suscitent le besoin de comprendre.
Les attentats de janvier et de novembre 2015 à Paris, ainsi que le drame récent de Bruxelles, faisant suite à d’autres événements de même nature, suscitent le besoin de comprendre.
Néanmoins, la tentation est toujours grande de présenter chaque attentat selon une logique sensationnaliste. Pourtant, il est impératif de penser le phénomène terroriste dans sa complexité pour éviter les raccourcis qui valideraient trop hâtivement un discours de « choc des civilisations ».
Cette réflexion s’opère suivant deux axes.
Le premier privilégie les enquêtes de terrain, les analyses sociologiques ou les réflexions sur la violence. De manière schématique, on peut le qualifier d’horizontal ou de synchronique.
Le second cherche à inscrire les manifestations terroristes actuelles dans une histoire, non pas pour en gommer la spécificité, mais au contraire pour en faire ressortir la nouveauté.
C’est à cette seconde catégorie qu’appartient le livre de Jenny Raflik. Historienne de formation, spécialiste de l’histoire de l’OTAN et des relations transatlantiques et, de manière plus générale, des relations internationales, elle a décidé de prendre le terrorisme pour objet.
Pour autant, elle ne suit pas le sentier désormais battu des histoires du terrorisme qui se résument trop souvent à proposer un récit des différents attentats marquants de l’histoire, qui plus est d’une histoire occidentalo-centrée. En introduisant le couple « terrorisme et mondialisation », elle entend conceptualiser le terrorisme, en faire un objet d’étude de l’histoire des relations internationales.
Penser le terrorisme à l’échelle globale : un livre manifeste
Même si le sous-titre précise qu’il s’agit d’« approches historiques » et que l’auteur prend toujours grand soin de présenter son propos avec toute la réserve nécessaire, elle n’écrit pas moins :
« Il est vrai qu’en la matière, les historiens sont largement concurrencés par les « experts » , ainsi que par des chercheurs issus d’autres disciplines, comme la science politique et la sociologie. La domination ainsi exercée est telle qu’elle peut donner l’impression que l’objet « terrorisme » ne saurait constituer un sujet en soi pour l’historien. Or nous pensons qu’il le peut, et qu’il le doit ».
Pour mener à bien ce programme, il faut trouver un angle d’étude permettant une problématisation du sujet et évitant l’écueil d’une juxtaposition d’histoires sans lien logique. Jenny Raflik le voit dans la mondialisation. Autant le dire d’emblée, il s’agit là de l’aspect le plus novateur, et le plus intéressant, de son livre.
L’historienne part d’une évidence que chacun constate aujourd’hui, à savoir que le terrorisme est une réalité mondiale.
Il l’est de deux manières.
- Il frappe tous les espaces du monde.
- Il bénéficie de phénomènes que l’on regroupe sous le terme de mondialisation.
Elle propose ainsi d’établir un programme de recherche qui viserait à étudier conjointement le phénomène de mondialisation et le terrorisme pour voir si le terrorisme connaît les mêmes changements opérationnels que les autres acteurs, c’est-à-dire un passage de l’international au global, ou s’il existe des continuités qui l’emporteraient, ce qui se traduirait par une sorte d’invariant dans l’agir terroriste et son organisation.
C’est clairement la première solution qui ressort à la lecture du livre. Les mouvements terroristes ont ainsi connu de profonds bouleversements entre les attentats anarchistes de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle, et les attentats revendiqués par Al-Qaïda.
Le personnage de Carlos illustre ce basculement dans les années 1970 et 1980 manifestant la mondialisation du terrorisme avec la circulation aussi bien des moyens que des hommes et des idées. Certes, les groupes terroristes des années 1970, comme la Fraction Armée rouge ou les Brigades rouges, opéraient à l’échelle internationale, mais elles nécessitaient pour cela une mise en relation de différents acteurs nationaux. Désormais, avec les nouveaux moyens de communication et surtout internet, un groupe terroriste comme Al-Qaïda peut véritablement agir à l’échelle du monde.
Pour autant, de là à dire que la mondialisation serait facteur du terrorisme, il y a un pas que l’auteur se garde bien de franchir, montrant que les liens entre terrorisme et mondialisation sont ambivalents et que si la mondialisation le sert c’est de manière « paradoxale ».
Le terrorisme, entre modèle et faits
L’ouvrage se révèle tout autant passionnant quand il s’agit de dresser sur le temps long un profil des terroristes. L’auteur, à la suite d’autres enquêtes, revient sur le mythe du terroriste en Robin des bois. Les terroristes ne proviennent pas des couches sociales les plus défavorisées, même s’il existe des exceptions, mais davantage de la classe moyenne.
L’auteur avance que schématiquement le terrorisme « ethno-nationaliste » draine davantage les classes populaires que le terrorisme « idéologique » visant à détruire la civilisation occidentale. Précisons que dans la typologie élaborée par l’auteur il existe une troisième forme de terrorisme, l’« identitaire ».
Un autre apport de la méthode défendue par l’auteur est de voir la construction symétrique des mécanismes de défense contre le terrorisme, toujours à la peine derrière celui-ci. La définition même du terroriste, devant l’impossible consensus qu’il suscite, montre la difficulté qu’il y a d’appréhender le terrorisme, a fortiori quand celui-ci connaît des évolutions liées à la mondialisation.
Les gouvernements et les organisations internationales, confrontés à des acteurs globaux jouant sur plusieurs échelles, géographiques et temporelles, sont ainsi contraints d’évoluer, mettant ainsi les démocraties face à une solution inédite. La question de l’état d’urgence en a récemment offert une illustration.
À travers ces deux exemples, on voit qu’en privilégiant une approche typologique et systématique l’auteur offre un ouvrage passionnant qui revient sur des nombreuses idées acquises, et souvent erronées, sur le terrorisme mais aussi sur la mondialisation. Au final, si on peut lui faire le reproche de n’avoir pas fait une histoire, mais seulement des approches historiques du terrorisme et de la mondialisation, on ne peut qu’attendre la mise en place de programmes de recherche allant dans ce sens.
Toujours dans ce sens, il aurait peut-être encore été plus éclairant d’insister sur le lien entre « terrorisme » et « mondialisation » dans l’ensemble des raisonnements, à le souligner encore plus fortement.
De manière peut-être plus prégnante pour la vie quotidienne, le livre invite à une objectivation du terrorisme par l’histoire pour comprendre les évolutions qu’il a connues et, surtout, afin d’éviter d’y plaquer des idées fausses qui, sous l’apparence d’une singularisation de chaque attentat, aboutirait en réalité à un traitement uniforme qui donnerait l’impression fallacieuse d’un terrorisme éternel et immuable.
Jenny Raflik,Terrorisme et mondialisation : Approches historiques, Éditions Gallimard, 2016, 416 pages, 28 euros
—

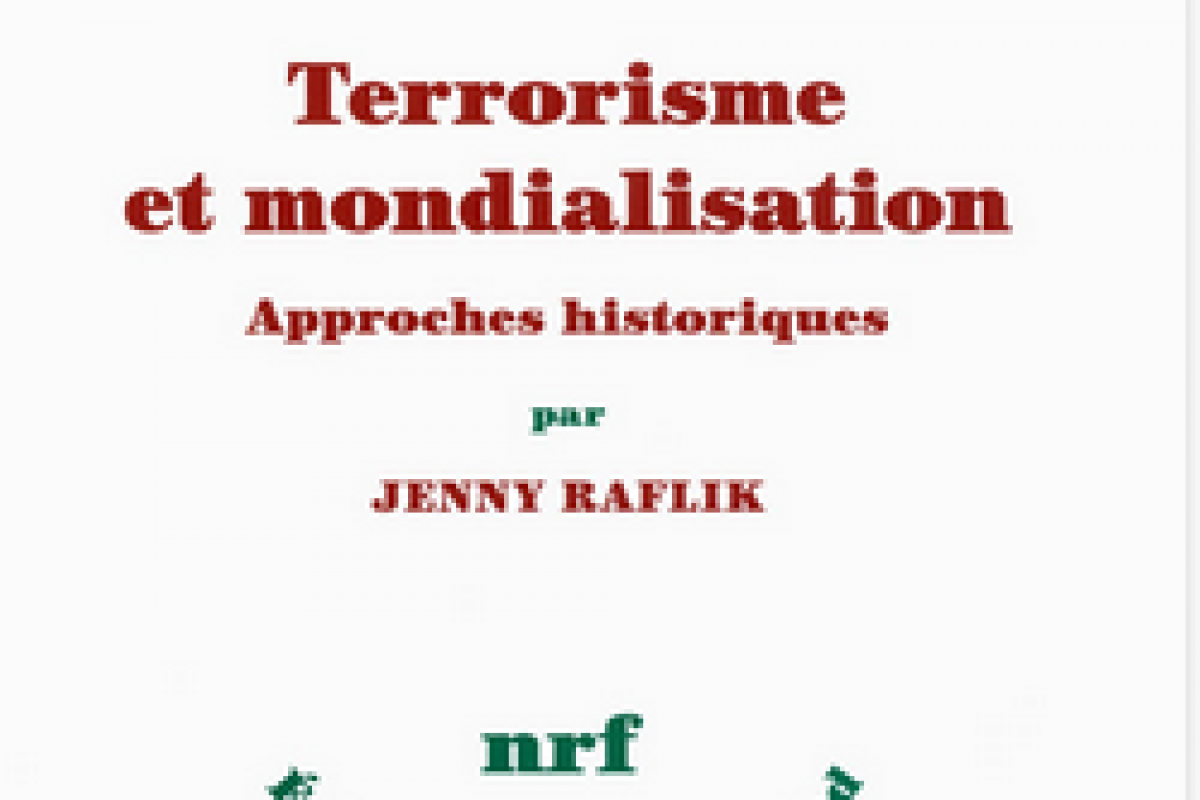



Laisser un commentaire
Créer un compte