Pour lire la première partie de l’article, cliquez ici
Par Olivier Babeau
Une analyse de Génération Libre

L’inflation des cachets des acteurs, supportée par les spectateurs (via la taxe sur les billets) et les consommateurs (via tous les autres prélèvements associés), n’est qu’un des effets pervers d’un système de soutien au cinéma fondé sur la neutralisation méthodique de presque tous les mécanismes de marché.
Une rupture trop radicale entre offre et demande
Au prétexte que la demande ne donne pas toujours les bons signaux à l’offre en matière culturelle, on a décidé qu’en France la demande culturelle ne devait jamais influencer, conditionner ou limiter l’offre. On a systématiquement cassé les liens naturels entre les deux : le prix, la quantité demandée et les coûts de production ont été rendus indépendants.
Les films français sont aujourd’hui presque tous produits grâce à un préfinancement à 100 % des frais. Autrement dit, le producteur ne prend aucun risque lorsqu’il produit un film, mais engrange en revanche les bénéfices en cas de succès. Le système est ainsi profondément déresponsabilisant et pervers puisque les producteurs sont couverts contre le risque d’échec, mais bénéficient en revanche des succès. Mutualisation des pertes et privatisation des bénéfices… cela rappelle précisément ce que l’on a beaucoup reproché aux banques au plus fort de la crise financière !
Une étude réalisée en 2005 montrait que, sur les 162 films produits cette année-là, seuls 15 films avaient recouvré leurs dépenses de production et de distribution sur l’ensemble des premières exploitations. Une autre étude réalisée par le CNC en 2013 a montré que sur les 200 films sortis cette année-là, seuls 20 étaient rentables, c’est-à-dire 10 %. Aucun film français ayant dépensé un budget de plus de 10 millions d’euros ne rentrait dans ses frais.
Des financements souvent dysfonctionnels
Comment est financé ce déficit ?
D’une part, par les acteurs privés (notamment les chaînes de télévision via leurs obligations d’investissement) ; d’autre part, par les contribuables via la redevance, le crédit d’impôt, les aides régionales et les outils de défiscalisation (SOFICA). Comment ne pas penser à la phrase de Bastiat : l’intervention des salaires vient « ébrécher le salaire de l’artisan pour constituer un supplément de profit à l’artiste. »
Déjà, en 1951, Pierre Cheret dénonçait le comportement des producteurs français qui « n’entreprennent de films nouveaux qu’à condition de trouver une combinaison financière leur permettant d’éviter de prendre personnellement un risque, celui-ci se trouvant reporté sur ceux auxquels ils font appel ». Ainsi, le producteur n’a plus à se préoccuper de rentabiliser son film en aval pour amortir les coûts. Cluzel et Cerutti condamnent le passage d’une « logique de risque » à une « logique de préfinancement » qui transfère tout risque sur les partenaires, notamment les chaînes de télévision. La place centrale donnée aux pré-achats de films dans le financement de cette industrie permet ainsi d’omettre complètement le rôle de l’exploitation en salle et de la fréquentation.
Ce système trouve son expression la plus évidente dans la tendance à l’augmentation des coûts du devis. Le devis médian est ainsi en augmentation quasi constante, atteignant 3,73 millions d’euros en 2011 contre 2,82 millions au début des années 2000. De plus, entre 2002 et 2011, l’investissement dans les films d’initiative française a augmenté de 5,1 % par an en moyenne. Les années 2013 et 2014, notons-le malgré tout, ont marqué un certain recul du niveau médian des devis repassant sous la barre des 3 millions d’euros.
L’augmentation du coût des films est clairement liée au système de soutien lui-même. Selon Laurent Creton, cette augmentation est en effet due, en partie, à l’arrivée de Canal Plus à partir de 1984. L’irruption d’un acteur bénéficiant d’un privilège de diffusion en échange d’une participation importante au financement a créé une prospérité favorisant l’augmentation des devis. Autrement dit, l’existence d’un guichet généreux a encouragé au gonflement des dépenses de création.
De plus, les devis semblent gonflés pour de multiples raisons (« faciliter l’obtention des prêts bancaires, des subventions de l’État ou provoquer un effet d’annonce publicitaire, les films à gros budget paraissant plus sérieux vis-à-vis des partenaires »), mais sont aussi la traduction d’une stratégie de la part des producteurs qui ont intérêt à gonfler le budget afin de minimiser leur apport personnel.
On note ainsi la présence d’une proportion de films surfinancés, c’est-à-dire dont le taux de couverture est supérieur à 100 %. L’intérêt du surfinancement est qu’il est récupéré par les producteurs s’il n’est pas dépensé…
Une filière subventionnée, des mécanismes pervers
Ce système de soutien a ainsi entraîné une déresponsabilisation complète du producteur qui, alors qu’il devrait favoriser la commercialisation et le succès de son film, ne repose que sur le préfinancement de gros distributeurs.
L’incitation à la création laisse place à la rente : là où tous les producteurs du monde cherchent à amortir les coûts d’un film par son exploitation, il s’agit en France de savoir mobiliser les financements ad hoc. L’industrie du cinéma n’apparaît alors plus comme un secteur aidé mais de façon bien plus radicale, comme une filière entièrement subventionnée, en décalage complet par rapport à son marché, privilégiant un petit nombre de professionnels n’ayant plus à se soucier des films qu’ils produisent, car le système permet d’accumuler les échecs en faisant payer les pertes aux partenaires.
Cette barrière consciemment édifiée entre la réception d’un film par le public et le moment de sa production a une justification bien connue : les œuvres culturelles ne doivent pas être bridées par de basses questions d’argent (au risque de perdre un chef-d’œuvre). Le problème de la rentabilité ne doit pas se poser. « Ce qui a un prix, écrivait Nietzsche, n’a pas de valeur ». Les bâtisseurs de notre politique culturelle semblent en avoir tiré la conclusion que, parce qu’elle a une valeur immense, la culture ne devait pas avoir de prix du tout !
Le corollaire de ce rejet du rôle structurant que joue normalement le prix est le mépris envers la demande. L’expression artistique étant supposée être entièrement libre, ou plutôt n’avoir pour seul guide que la voix des Muses, quiconque prétendrait l’influencer commettrait un crime de lèse-culture, fut-il le public lui-même. Pourtant, si la dépendance exclusive à des goûts et demande du grand public est un frein à la création, on peut réellement se demander si la déconnexion totale, ou presque, entre la réalisation d’une œuvre cinématographique et la nécessité de trouver un public n’est pas également problématique. Elle prend notamment la forme de la logique de l’éléphant blanc bien connue des économistes : un mécanisme pervers où l’absence de frein à la dépense favorise l’inflation des coûts sans rapport avec les besoins et sans efficacité quelconque en retour.
Quelle logique pour les investissements culturels ?
L’augmentation très importante du budget du CNC, largement provoquée par l’abondement des taxes versées par les fournisseurs d’accès à Internet, avait créé la polémique en 2011.
Elle a mis en lumière de façon assez crue le caractère avant tout quantitatif, et pourtant limité, des objectifs du CNC. La rationalité implicite de son fonctionnement paraît en effet être d’augmenter autant que possible les moyens consacrés au cinéma, sans égard aux logiques propres des acteurs économiques qui sont mis à contribution pour dégager ce financement, et de maximiser le nombre de films tournés en France, sans égard au public qu’ils rencontrent. La logique paraît inversée par rapport à la rationalité gestionnaire classique : au lieu de fixer des objectifs et de mobiliser les ressources nécessaires pour les atteindre, le CNC agit comme s’il s’agissait de mobiliser un maximum de ressources, et ensuite de se poser la question de la meilleure façon de les dépenser.
Cette logique nous semble pouvoir être questionnée.
Les justifications économiques des investissements culturels en termes d’externalités ou les considérations philosophiques concernant le rayonnement culturel doivent-elles justifier une escalade infinie des dépenses ?
Une réflexion en termes d’efficacité d’allocation des ressources est-elle forcément nuisible à la politique culturelle ?
Ne pourrait-on concevoir que la maximisation des sommes consacrées au cinéma ne soit pas nécessairement le facteur déterminant de l’atteinte des objectifs de la politique culturelle en faveur de ce même cinéma ?
Pourquoi serait-il nécessaire de maximiser le nombre de films produits ?
Une sélection plus serrée, plus « qualifiée » permettrait de faire des films atteignant non seulement l’objectif de diversité de l’expression, mais encore celui d’impact auprès des populations. Mais cette idée de sélection n’est pas elle-même exempte de faille : elle est à notre sens le second grand problème de notre système d’aide au cinéma.
L’arbitraire plutôt que la contrainte économique
Hier comme aujourd’hui, le contrôle de l’expression artistique a surtout été, de la part d’un pouvoir quel qu’il soit, un puissant outil de contrôle idéologique et politique. Outil d’autant plus pernicieux qu’il prétend être neutre. En admettant pourtant que le soutien à la culture soit réalisé de bonne foi, sans arrière-pensée contrôlante, il n’échappe pas aux travers habituels des politiques publiques, analysés notamment par l’école du Public Choice : phénomènes de corruption, de clientélisme, d’abus de pouvoir et de détournement des ressources au profit d’intérêts catégoriels.
Subventionner une association culturelle, un spectacle, c’est toujours faire un choix. Ce choix n’est jamais neutre : il détermine la forme, les intervenants, les modalités, quand ce ne sont pas les thèmes de l’œuvre. Ce moment du choix, même réalisé par des experts (désignés tels) est toujours problématique. Cette dimension subjective, voire purement arbitraire, du choix d’un artiste était autrefois assumée. Mécène a choisi de soutenir Horace ou Virgile plutôt que d’autres poètes. Louis XIV a choisi d’octroyer à Lully le monopole de la musique théâtrale en 1672, bridant les capacités d’expression de bataillons d’autres artistes… Les puissants d’hier n’avaient pas d’autre justification à apporter que leur bon vouloir ou leur goût. Nos institutions d’aujourd’hui prétendent choisir pour nous, mais quelle que soit leur bonne volonté, elles apportent juste la subjectivité individuelle de ceux qui sont chargés de choisir.
Dans le cas précis du cinéma, le choix souverain de la bureaucratie culturelle se traduit aujourd’hui par une crispation sur une forme d’expression (le long métrage cinématographique) et sur ses formes traditionnelles de diffusion (la salle). Il ne nous appartient pas de juger de la pertinence de ce choix. Soulignons seulement encore une fois que, comme toute protection d’une expression particulière, elle est réalisée aux dépens de l’émergence et du développement de formes alternatives. Imaginons que si l’équivalent du CNC avait existé au XIXe siècle, on continuerait aujourd’hui à produire à marche forcée (et à fonds perdus) des quantités d’opéras et d’opérettes que personne n’irait voir…
Plus grave encore : cette crispation est aussi, à terme, un choix suicidaire pour le film lui-même. Le système de soutien au cinéma, qui génère tant de confort pour les acteurs (c’est le cas de le dire !) en place, est à l’heure actuelle un frein aux développements de nouvelles formes de financement.
La révolution numérique et ses conséquences
L’industrie du cinéma doit se rendre compte que l’ère numérique dans laquelle nous entrons va totalement bouleverser l’économie de l’exploitation cinématographique. Les comportements de consommation de l’image ne sont déjà plus les mêmes, et une grande partie du modèle actuel ne tient finalement que grâce à la relative inertie des générations les plus âgées. Si l’on projette sur une population entière les habitudes qui sont déjà celles des moins de vingt ans, on comprend que l’équilibre économique du système actuel, déjà fragile, est condamné.
À terme, la consommation entièrement délinéarisée (à la demande) sera la règle. Elle se fera sur Internet, c’est-à-dire sans aucune captivité envers des diffuseurs particuliers (la création de chaînes sur les hébergeurs de contenus tels que YouTube se fait sans barrière comparable à celle du nombre limité de fréquences). Il est probable que la place relative de la salle dans les recettes tende à diminuer au profit des multiples formes de consommation en vidéo à la demande. C’est certes une mauvaise nouvelle pour l’écosystème actuel de l’audiovisuel, mais c’est aussi une formidable opportunité : la fenêtre d’exploitation du film va devenir virtuellement infinie, ouvrant des opportunités de rentabilisation et de diffusion des œuvres beaucoup plus diversifiées et plus longues.
Mais pour que les films français puissent bénéficier du nouvel ordre numérique et trouver un équilibre plus sain, le système de financement du cinéma doit refaire une place aux questions de rentabilité et au marché.
L’ensemble du mécanisme de pompage des ressources mises au service du cinéma (qui ne sont que des formes de fiscalité additionnelles) doit être repensé, en libérant en particulier les chaînes de télévision de ces paradoxales obligations de productions qui leur interdisent en même temps de devenir propriétaires de l’œuvre financée. Ce point est essentiel, puisqu’en pratique ce sont ces chaînes, en particulier Canal Plus, qui financent le cinéma français à travers leurs pré-achats (et en moindre part leur coproduction).
Or le film n’a plus pour la télévision la même valeur qu’il y a quarante ans. Ne pas l’accepter, c’est non seulement conserver des obligations obsolètes qui produisent les effets pervers dont nous avons parlé, mais aussi s’interdire de développer pour le film de nouvelles plateformes de financement. Cela ne veut pas dire d’ailleurs que les chaînes de télévision n’auraient pas intérêt à produire des films : elles le feraient d’autant plus volontiers que serait levée l’interdiction fondamentale qui leur est faite d’être aussi productrices et propriétaires des contenus produits. À cette condition elles auront intérêt à troquer une attitude frileuse axée sur le seul marché national, pour une capacité de création et de valorisation de l’œuvre à l’international.
Les pouvoirs publics, de façon générale, doivent cesser de justifier par l’exception culturelle ce qui n’est au fond qu’une abdication face à des lobbies défendant leurs rentes.
À lire aussi :
—




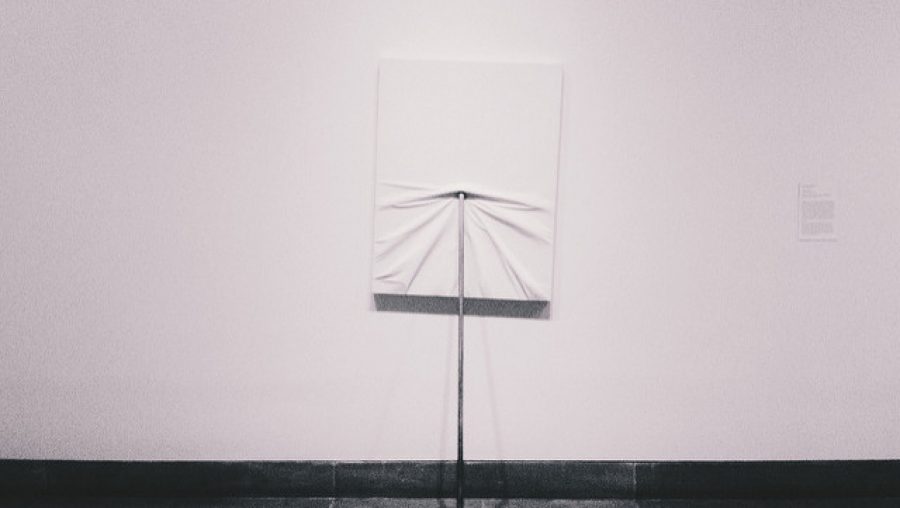
La révolution numérique va induire évidemment les mêmes comportements corporatistes qu’avec les taxis: limitation, taxation des plateformes, des accès ou de la bande passante.
Un jour les français vont se réveiller dans un pays devenu totalement archaïque.
OK, nous vivons dans une économie administrée. Le cinéma n’est qu’un exemple parmi d’autres. Et alors, c’est quoi exactement les news ou l’analyse là-dedans ?
“Les pouvoirs publics, de façon générale, doivent ….” Ah oui d’ailleurs ils n’attendaient que cet article pour se réveiller et se remettre un peu en question ?
Désolé pour le sarcasme mais franchement je saisis mal l’intérêt de se pencher sur ces choses. Ca ne va rien changer.