Damien Theillier explicite les thèses fondamentales de Bastiat dans l’introduction de la réédition de La Loi. Deuxième thèse : L’État ne peut faire ce qu’un individu n’a pas le droit de faire.
Par Damien Theillier.
Un article de l’Institut Coppet

« S’il est une chose évidente, c’est celle-ci : La Loi, c’est l’organisation du Droit naturel de légitime défense c’est la substitution de la force collective aux forces individuelles, pour agir dans le cercle où celles-ci ont le droit d’agir, pour faire ce que celles-ci ont le droit de faire, pour garantir les Personnes, les Libertés, les Propriétés, pour maintenir chacun dans son Droit, pour faire régner entre tous la Justice ».
En d’autres termes, Frédéric Bastiat considère comme évident que si un individu ne doit pas commettre certaines actions parce qu’elles attentent à autrui ou à sa propriété, aucun groupe d’individus ne doit les commettre, y compris l’État. Ce dernier n’étant qu’une association d’individus, il ne peut agir par des moyens qui sont fondamentalement viciés, des moyens qui impliquent la violence contre la personne humaine (l’homicide, l’esclavage, l’agression, le mensonge) et contre ses biens (le vol).
L’État n’est qu’une association d’individus
« Et si chaque force individuelle, agissant isolément ne peut légitimement attenter aux droits d’un autre individu, comment cela serait-il vrai de la force collective qui n’est que l’union organisée des forces isolées ? ».
Frédéric Bastiat cherche à définir la véritable mission de l’État et de la loi dont il est le garant. Or un symptôme a particulièrement effrayé notre auteur après la révolution de 1848, c’est cette idée dominante, dont nous avons déjà parlé en introduction, qui a envahi toutes les classes de la société, que l’État est chargé de faire vivre tout le monde.
Cette idée se rencontre chez tous les réformateurs sociaux, précurseurs du socialisme. Louis Blanc veut que l’État intervienne pour assurer l’égale répartition des salaires, Proudhon le charge d’instituer le crédit gratuit. Les devoirs, même moraux, tels que l’amour du prochain, doivent être prescrits par la loi et l’État doit veiller à leur accomplissement.
Mais l’État n’étant qu’une association d’individus, dit Bastiat, il n’a pas d’autres droits que ceux mêmes que ceux-ci possèdent préalablement. En effet, le droit collectif a son principe dans le droit individuel. Chacun tient de la nature le droit de défendre sa personne, sa liberté, sa propriété, qui sont les trois éléments constitutifs et conservateurs de sa vie. Et plusieurs personnes ont le droit de s’entendre, de s’organiser, pour pourvoir à cette défense de façon plus efficace et à moindre coût. Mais, de même que la force d’un individu ne peut légitimement attenter à la vie, à la liberté et à la propriété d’un autre individu, la force commune ne le peut pas davantage. Celle-ci n’est et ne peut avoir été instituée que pour maintenir la justice.
« L’État a-t-il d’autres droits que ceux que les citoyens ont déjà ? J’ai toujours pensé que sa mission était de protéger les droits existants déjà ».
Nous parlons souvent de l’État comme s’il était une entité réelle d’un ordre différent et supérieur à la réalité des choses banales que nous rencontrons dans la vie quotidienne. Mais l’État est tout simplement un nom pour un groupe particulier de personnes agissant de façon particulière à des moments et des lieux particuliers. Ce point étant admis, il faut présumer que ces personnes sont liées par des règles morales de conduite qui sont les mêmes pour chacun : ce qui est moralement bon pour chacun doit l’être pour tous et ce qui est immoral pour chacun doit l’être pour tous. Ce qu’un individu n’a pas le droit de faire : voler ou tuer, un État n’a pas le droit non plus de le faire.
Il faut donc comprendre la défense de l’individu par Bastiat en ce sens que celui-ci est le seul agent moral. Les notions de bien et de mal moral n’ont de sens que pour des personnes singulières, non pour des collectivités abstraites. La société, l’histoire, la nation n’ont pas de volonté, pas d’intentions et donc pas de droits. La source de toute moralité c’est l’individu. Il n’y a pas d’autre référence pour définir le bien et le mal, le juste et l’injuste que l’individu. C’est lui seul qui pense, lui seul qui agit, qui choisit, qui exerce une responsabilité morale.
Quand les hommes politiques promettent de l’argent et donnent des subventions, des prestations sociales, ils ne peuvent le faire qu’avec l’argent des autres. Ils ne peuvent donc être généreux qu’avec de l’argent volé, de l’argent pris à des gens qui ne voulaient pas le donner. Et si un individu faisait la même chose qu’eux, il serait sévèrement puni. Si le fait de spolier autrui est immoral pour un individu, cela vaut également pour un État. Ce dernier n’a donc pas de statut moral spécifique, pas d’autonomie propre.
Individualisme et collectivisme
« Quels sont les peuples les plus heureux, les plus moraux, les plus paisibles ? Ceux où (…) l’individualité a le plus de ressort ».
La société n’est pas un individu, elle n’agit pas, elle n’existe que par les individus qui la composent et qui agissent. Mais bien entendu Bastiat ne nie pas qu’il y ait des groupes humains, des collectivités, des choses telles que la société, le peuple ou la nation. Pour Bastiat l’homme est un être social par nature, fait pour vivre en société. Et la coopération, l’association, le partage, sont des valeurs essentielles pour le bien commun. Mais l’homme est un être social qui ne peut s’accomplir qu’en faisant des choix personnels libres et responsables, avec ce qui lui appartient et dans le respect d’autrui.
Cette idée est la véritable clé de voûte d’une société humaine civilisée et nous ramène au droit, sans lequel la vie collective n’est qu’une forme de tyrannie déshumanisante. Or l’accroissement de l’action collective, au nom d’une « fausse philanthropie », se traduit par l’effacement du droit, le déplacement de la responsabilité et son transfert de l’individu à l’État. Le résultat c’est la perte de liberté et d’initiative de la société civile et l’anéantissement de la responsabilité individuelle.
Le socialisme, consciemment ou inconsciemment, considère la société comme une construction arbitraire de l’intelligence humaine, destinée à réaliser une fin morale qui est l’égalité et subordonnée à la réalisation de cette fin. Dans ce cadre, les rapports économiques reposeraient uniquement sur la philanthropie, la fraternité et la solidarité imposées d’en haut, par la loi.
Bastiat, loin de cette utopie, considère la société comme née des besoins des hommes. Elle se perfectionne à mesure que chacun des éléments qui la composent comprend mieux le profit qu’il retire de la vie commune et contribue volontairement à l’améliorer. Pour lui, une société n’est heureuse que si elle jouit d’une certaine prospérité matérielle. Et elle n’est prospère que si chacun des individus qui la composent peut agir pour créer de la valeur par son effort et son initiative. L’effort et l’initiative de chacun conditionnent donc le bonheur commun.
On le voit, l’individualisme bien compris n’est absolument pas un relativisme en matière morale. Bastiat refuse d’accorder à l’État le droit de commettre des actions que tout le monde considère comme immorales si elles étaient commises par n’importe quel individu ou groupe social. Simplement l’État n’a pas un statut d’exception, une sorte de privilège qui l’exempterait des règles communes de droit. Une société libre et juste à la fois est une société dans laquelle un même code moral et juridique s’applique à tous, y compris et surtout aux hommes qui gouvernent, parce qu’ils disposent du pouvoir de contraindre.
Frédéric Bastiat, La Loi (précédé d’une étude par Damien Theillier), Institut Coppet, 2015.
À suivre
—


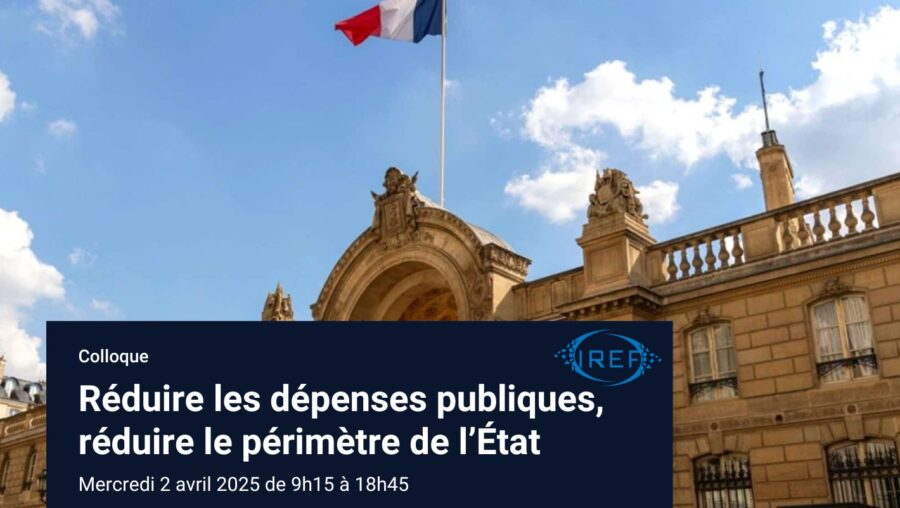


C’est dommage que le bon sens de certains n’atteigne pas les personnes haut perchées de l’Etat.