Par Simone Wapler
 L’argent des autres c’est, bien sûr, l’argent public, celui des impôts. Pour certains, la question européenne pourrait être facilement résolue avec l’argent des autres. Simple et facile : il suffit de faire des transferts entre pays. À les écouter, l’Allemagne paye pour la Grèce et il n’y aurait plus de problème grec.
L’argent des autres c’est, bien sûr, l’argent public, celui des impôts. Pour certains, la question européenne pourrait être facilement résolue avec l’argent des autres. Simple et facile : il suffit de faire des transferts entre pays. À les écouter, l’Allemagne paye pour la Grèce et il n’y aurait plus de problème grec.
Pour ceux qui aiment bien disposer de toujours plus d’argent des autres, l’Allemagne se montre psychorigide en refusant que l’argent de ses contribuables irrigue les pays économiquement faibles. Les riches doivent payer, l’harmonie de l’Europe est à ce prix. De surcroît, le riche n’a pas à demander de comptes car la souveraineté nationale du pauvre en serait humiliée. Les exemples de la fédération américaine ou de la confédération helvétique sont souvent cités. La différence de compétitivité – entre les riches Texans ou Californiens et les pauvres des États de la Rust belt du nord-est – ne donne lieu à aucune crise ; la Suisse, malgré ses trois langages, jouit d’une paisible prospérité. Il n’y a qu’à faire comme eux !
De tels raisonnements négligent quelques détails. Les finances publiques de l’État fédéral américain sont désastreuses. La Suisse est un petit pays où s’exerce une démocratie de proximité plutôt sourcilleuse du bon emploi de “l’argent des autres”.
Contre-exemples
Un contre-exemple frappant se trouve aussi en Italie. Depuis l’après-guerre, le nord verse au sud entre 0,5% et 1% du PIB national. Cette irrigation, qui porte le nom poétique de Mezzogiorno, n’a donné lieu à aucune convergence. La Sicile reste la Sicile et le Milanais le Milanais. Plutôt que de lire des centaines de pages de thèses de savants économistes payés par l’argent public, j’ai interrogé une amie de la région du Lac Majeur, toute proche de la frontière suisse. Où part l’argent du Mezzogiorno ? “Je ne sais pas”, m’a-t-elle répondu. Puis, après réflexion : “probablement dans la corruption”, en évoquant le projet d’un tunnel dans lequel son village de Cannobio était impliqué. Le projet avait reçu des contributions nationales, régionales, communales. Le chantier a commencé, n’a jamais été achevé et les impôts locaux ont augmenté.
Le problème de ces transferts est qu’ils sont illimités dans le temps et donc en montants, sauf peut-être dans le cas de la réunification allemande. À l’échelon national, “l’argent des autres” se gère par la représentation. Dans une démocratie qui fonctionne, le principe “pas de taxation sans représentation” est vivant. Ceci signifie que celui qui paye doit pouvoir voter et décider. Celui qui décide des subventions ne peut-être le fonctionnaire international qui ne paie pas d’impôt ni même le politicien professionnel payé par l’argent public national. Si celui qui décide ne paye pas, eh bien… “il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark”, soupirait Hamlet. Ensuite, dans une démocratie rigoureuse, le contrôle des dépenses publiques est également rigoureux.
La question grecque ne se résoudra pas à coups de transferts “d’argent des autres”. Les populations, échaudées par les échecs cuisants de nos fonctionnaires omniscients, ne veulent plus d’un gouvernement européen technocratique. Les suffrages recueillis par les partis séparatistes et nationalistes en témoignent. Pourquoi ce qui ne fonctionne pas à l’échelon national – en Italie ou en Belgique – marcherait-il à l’échelon international entre l’Allemagne et la Grèce ? Les miracles transfrontaliers seraient-ils plus courants que les miracles nationaux ? Bien au contraire. Il faudrait plutôt que les pays qui dépendent de “l’argent des autres” – qu’il soit national ou international – apprennent à s’en passer. Et si les taux d’emprunt montent, cela va devenir urgent.
—
Pour plus d’analyses de ce genre, c’est ici et c’est gratuit.




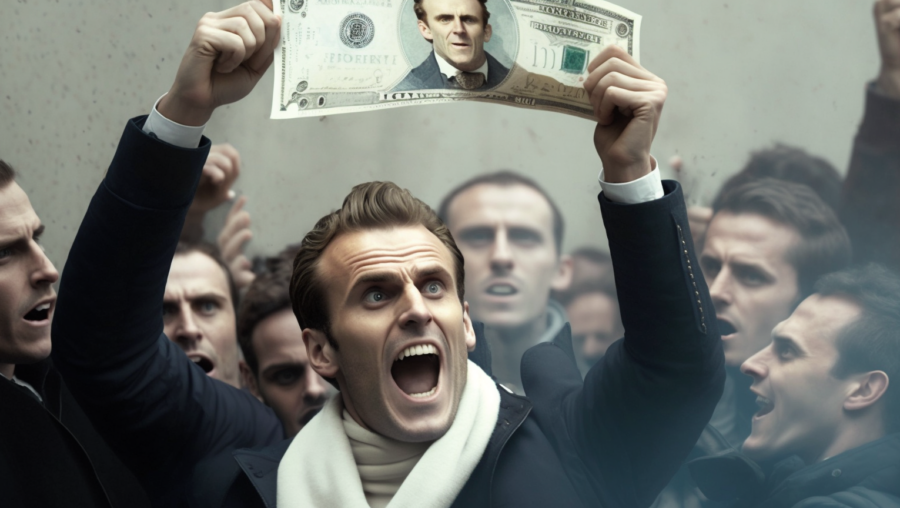
Laisser un commentaire
Créer un compte