Par Roseline Letteron.

Le 23 avril 2015, dans un arrêt François c. France, la Cour européenne évoque la situation étrange de l’avocat appelé en garde à vue et qui se retrouve placé en garde à vue.
Le requérant, avocat au barreau de Paris, a été appelé au commissariat d’Aulnay-sous-bois dans la nuit de la Saint Sylvestre du 31 décembre 2002 au 1er janvier 2003, pour assister un mineur placé en garde à vue. Lors de l’entretien avec son client, ce dernier affirme avoir été victime de violences policières et présente des lésions au visage. L’avocat demande alors la visite d’un médecin et rédige des observations écrites qu’il entend joindre au dossier. À partir de ce moment, les versions divergent. On se dispute pour des questions de photocopies, le ton monte, quelques coups sont échangés. Après cette altercation, l’officier de police judiciaire (OPJ) place l’avocat en garde à vue pour rébellion et outrage à agent de la force publique.
Maître François conteste non seulement la mesure de garde à vue mais aussi son déroulement. Il a été placé en cellule, a subi une fouille à corps particulièrement humiliante et son taux d’alcoolémie a été contrôlé. Sa plainte aboutit finalement à un non-lieu, confirmé par la chambre de l’instruction de la Cour d’appel, puis par la Cour de cassation en octobre 2010. Les juges estiment, d’une manière générale, qu’il n’y a pas lieu de mettre en doute la version des faits avancée par les policiers, même s’ils regrettent que l’OPJ qui a prononcé la mise en garde à vue de l’avocat soit précisément celui qui s’estime victime de violences.
La situation antérieure à la loi du 14 avril 2011
Devant la Cour européenne, l’avocat invoque essentiellement une violation de l’article 5 § 1 de la Convention qui garantit le principe de sûreté. À ses yeux, la privation de liberté dont il a été victime, et qui a finalement duré treize heures, s’analyse comme une détention doublement arbitraire.
Observons que les faits sont bien antérieurs à la loi du 14 avril 2011 qui a organisé les modalités d’intervention de l’avocat durant la garde à vue. À l’époque des faits, la personne gardée à vue a seulement droit à un entretien de trente minutes avec son avocat. Ce dernier n’assiste pas aux interrogatoires, même s’il peut effectivement déposer des observations écrites pour qu’elles soient jointes au dossier. De la même manière, les règles gouvernant la fouille à corps et le test d’alcoolémie ne sont pas clairement établies.
Au regard du droit interne de l’époque, les mesures prises à l’encontre de l’avocat n’étaient donc pas réellement illégales. Dans son avis rendu sur cette affaire le 25 avril 2003, la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS) recommandait d’ailleurs la constitution d’un groupe de travail commun entre le ministère de l’intérieur et celui de la justice, dans le but d’engager une “réflexion sur l’éventuelle protection à accorder aux avocats lorsqu’ils sont dans l’exercice de leurs fonctions“.
La Cour commence par reconnaître que le droit interne a effectivement été respecté, mais elle précise que la notion “d’arbitraire que contient l’article 5 § 1 va au-delà du défaut de conformité avec le droit national“. Autrement dit, une privation de liberté peut être régulière en droit interne et contraire à la Convention européenne. Ce principe est rappelé par une jurisprudence constante, en particulier les arrêtsBozano c. France du 18 décembre 1986 et Amuur c. France du 25 juin 1996.
Un gardé à vue pas comme les autres
D’une manière générale, la Cour accorde aux avocats une protection d’une intensité particulière, dans la mesure où leur mission est “fondamentale dans une démocratie et un Etat de droit“, formule reprise dans pratiquement toutes les décisions les concernant (par exemple : CEDH, 6 décembre 2012, Michaud c. France). En l’espèce, il n’est pas contesté que maître François était dans l’exercice de ses fonctions, lorsqu’il assistait un mineur gardé à vue.
La fouille à corps
Le requérant a pourtant été traité comme n’importe quel gardé à vue. Il a en particulier dû subir une fouille à corps, pratique à l’époque autorisée par l’article 63-5 du Code pénal, mais seulement “pour les nécessités de l’enquête“. De fait, le droit interne en la matière reposait sur une distinction assez simple.
Les fouilles dites d'”enquête” étaient assimilées à des perquisitions et étaient soumises aux mêmes conditions que les autres actes d’enquête, en particulier l’existence d’indices laissant penser que l’intéressé a commis une infraction. La fouille d’enquête sert donc à trouver des preuves, et il est bien peu probable que la fouille à corps du requérant ait pu conduire à trouver des preuves de l’infraction d’outrage à agent. Les fouilles dites “de sécurité” , quant à elles, sont réalisées précisément en garde à vue pour s’assurer que l’intéressé ne conserve sur lui aucun objet dangereux. Dans ce cas, une simple “palpation de sécurité” est suffisante.
Une décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 27 septembre 1988 opérait déjà cette distinction entre les deux types de fouilles, ajoutant qu’une fouille à corps opérée pour des motifs de sécurité pouvait, le cas échéant, être assimilée à une perquisition irrégulière. Dans le cas du requérant, avocat dans l’exercice de ses fonctions, il est clair que la fouille aurait dû consister en une simple palpation de sécurité, et c’est d’ailleurs ce qu’affirme la Cour européenne des droits de l’homme.
La loi du 14 avril 2011 est depuis venue préciser le cadre juridique de ces fouilles, précisant désormais que les mesures de sécurité prises à l’égard d’un gardé à vue “ne peuvent consister en une fouille intégrale” (art. 63-6 du code de procédure pénale).
Le test d’alcoolémie
Il en est de même du test d’alcoolémie subi par le requérant immédiatement après son placement en garde à vue. À l’époque, l’officier de police judiciaire avait invoqué, pour justifier cette mesure, le fait que les événements se sont déroulés durant la nuit de la Saint-Sylvestre, la Cour d’appel ajoutant que cette période est évidemment “propice aux libations“. Or, le droit de l’époque qui n’a d’ailleurs guère changé, repose sur l’idée qu’un contrôle d’alcoolémie ne peut être imposé que si des éléments de fait laissent penser que l’infraction a été commise sous l’emprise d’un état alcoolique. Concernant le requérant, le test s’est révélé négatif, résultat d’autant plus prévisible que l’avocat n’avait montré aucune trace d’ébriété pendant la garde à vue de son client.
La Cour sanctionne ainsi le déroulement d’une garde à vue disproportionnée par rapport aux impératifs de sécurité. La fouille à corps comme le test d’alcoolémie étaient parfaitement inutiles et établissaient, au contraire, “une intention étrangère à la finalité d’une garde à vue“.
L’impartialité
La décision proprement dite de mise en garde à vue, concernant pourtant un avocat dans l’exercice de ses fonctions, n’est pas sanctionnée en tant que telle. Elle posait pourtant un problème, dès lors que la mesure a été décidée par un OPJ qui s’estimait personnellement outragé par l’attitude de l’avocat. La Cour observe même que cet officier a également supervisé le début de la procédure, ordonnant en particulier la fouille et le test d’alcoolémie. Une fois ces mesures prises, il a transmis le dossier à un collègue et informé sa hiérarchie.
La question est donc celle du respect du principe d’impartialité. Dans l’état actuel du droit, aucune disposition n’interdit à un OPJ de mettre en examen un avocat pour outrage durant une garde à vue, quand bien même celui qui met en garde est aussi la personne outragée. Si l’on procède par analogie, on s’aperçoit que l’outrage à magistrat en audience est bien davantage encadré par le droit (art. 434-24 code pénal). Le code pénal prévoit que les infractions commises à l’audience sont jugées immédiatement “sans désemparer” (art. 676 code pénal). Par dérogation cependant, l’outrage à magistrat ne peut être jugé de la même manière. L’article 677 code pénal énonce en effet que “les magistrats ayant participé à l’audience lors de la commission du délit ne peuvent composer la juridiction saisie des poursuites“.
Dans l’arrêt François, la Cour européenne se borne à mentionner cette difficulté. Elle ne s’étend pas sur le sujet, sans doute parce que le caractère disproportionné de la garde à vue peut être déduit de son déroulement. Elle n’a donc pas besoin de s’interroger sur le respect du principe d’impartialité. Il n’en demeure pas moins que l’arrêt a le mérite de poser la question. Depuis la loi du 11 avril 2014, les avocats exercent une partie, parfois non négligeable, de leurs fonctions dans l’assistance aux gardés à vue. Il serait donc logique que le droit envisage sérieusement leurs droits et leurs devoirs, ainsi que ceux des officiers de police judiciaire. Il serait sans doute possible de poser une règle simple selon laquelle la mise en garde à vue de l’avocat ne peut pas être prononcée par l’officier même qui s’estime outragé. Quoi qu’il en soit, l’avocat gardé à vue devra alors songer à sa défense et appeler un confrère pour l’assister, en espérant que ce dernier ne sera, pas à son tour, mis en garde à vue.

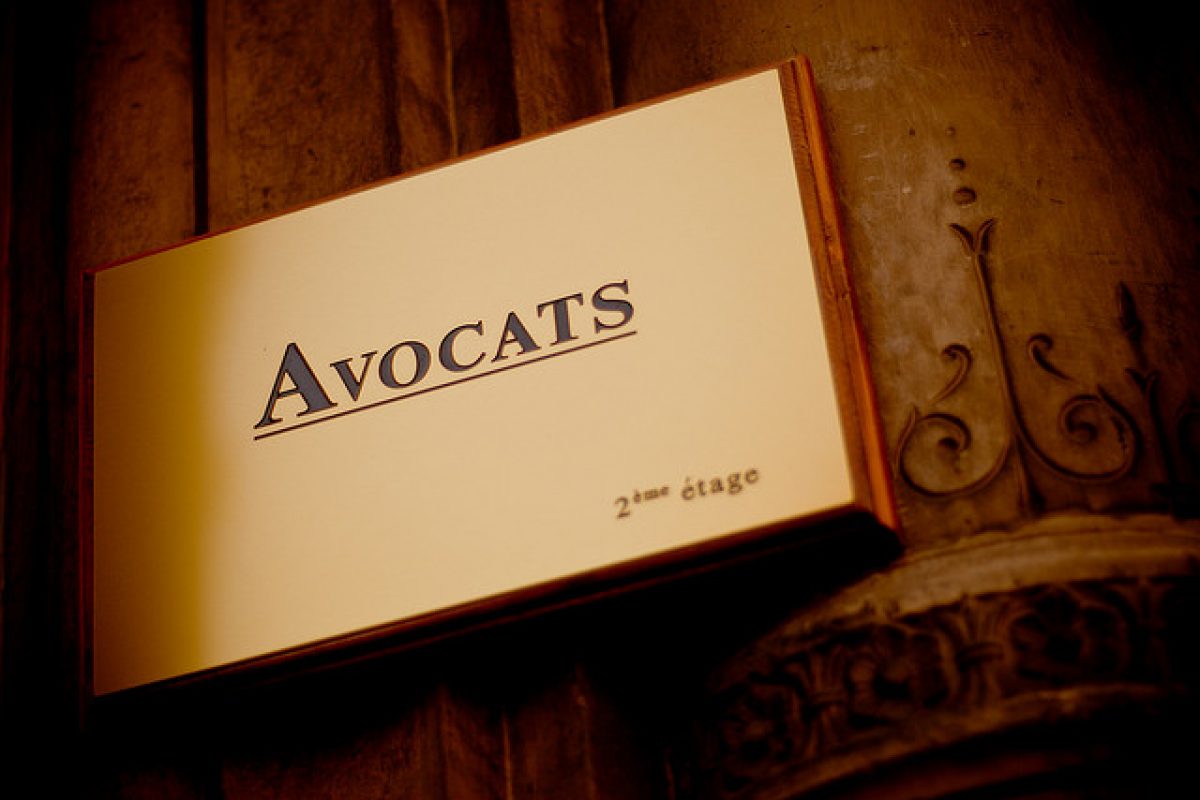


Il faut équiper tous les policiers, leurs voitures, salles d’interrogatoire et garde à vue…Tout – de mini caméras.. En échange de ce “flicage” permanent des flics ; ils faut leur octroyer : peines de 2 ans à tous ceux qui les insultent, leur font des doigts et autre irrespect.
Filmé en permanence, le policier respectera le droit, que celui-ci soit aussi respecté par les voyous présumés. évitant des millions d’Euros en procédures inutiles.
Nous avons la seule entreprise au monde, capable de déceler, si une photo ou un film a été truqué : ce qui exonèrerait les films de nullité devant les tribunaux.
Il est tant de rentrer dans la police scientifique.
S’ils pouvaient faire la même chose pour les élus, ça serait bien également.
D’ailleurs on pourrait installer des caméras dans tous les foyers pour éviter que les gens ne violent la loi.
On pourrait même appeler ça des télécrans!
A tout chien il faut une laisse
” garde à vous !!!!! ”
” chef ! oui chef ! “