Par Aurélien Portuese et Gaspard Kœnig [*]
Personne n’est plus embastillé pour ses opinions, et le temps où Voltaire écrivait que « sans l’agrément du Roi, vous ne pouvez penser » semble bien révolu. L’avalanche de sottises postées chaque jour sur le web conduit parfois à penser que, s’il y a un problème avec la liberté d’expression, il réside plutôt dans son abus.
Pourquoi alors des artistes aussi divers que Michel Houellebecq, Christian Clavier ou Karl Lagerfeld se sont-ils inquiétés récemment d’un retour rampant de la censure ?
Depuis quarante ans, nos gouvernants se sont mis en tête d’éradiquer la bêtise. La loi Pleven de 1972 condamnant les propos discriminatoires peut être considérée comme le point de départ de cette évolution.
Bien d’autres lois ont suivi, toutes rédigées avec les meilleures intentions du monde, mais qui ont considérablement limité le champ de la liberté d’expression. Ce corpus juridique est aujourd’hui heureusement peu utilisé, hormis par quelques associations spécialisées et personnalités procédurières, mais il définit un cadre potentiellement très dangereux, qui explique à la fois la judiciarisation du débat public en France, et le développement des phénomènes d’autocensure. Si ces lois étaient appliquées à la lettre, rares sont les écrits ou les paroles qui échapperaient à la justice.
Nous nous sommes tournés vers John Stuart Mill et son essai On Liberty (1859) pour retrouver les principes fondateurs de la liberté d’expression.
Nous en avons tiré la conviction que tout ce qui a trait à la définition de la « vérité » ou de la « morale » doit être ouvertement autorisé. Nous faisons le pari, à la base de nos démocraties, que l’individu est rationnel, et que l’opinion, correctement informée, est mieux à même de trancher le bien et le mal que les tribunaux.
Comme le dit Jamel Debbouze, « laissons les imbéciles dire tout et n’importe quoi ». Seul le souci de ne pas faire de mal à autrui doit pouvoir restreindre la liberté d’expression – ce qui peut justifier, par exemple, des lois protégeant la vie privée et la réputation, ou condamnant l’incitation à la violence.
 Munis de ces principes solides, nous avons passé en revue la législation française.
Munis de ces principes solides, nous avons passé en revue la législation française.
Si l’on peut sourire du délit d’« outrage à Ambassadeur », d’« opinions contraires à la décence » ou de « diffamation à l’encontre des administrations publiques », comment tolérer qu’un véritable délit de blasphème ait été réintroduit par la Cour de cassation ?
Que les lois mémorielles empêchent les historiens de faire leur travail (si elles avaient existé dans les années 1960, jamais on aurait pu montrer que le massacre de Katyn avait été perpétré par les Russes et non par les nazis) ? Que chaque communauté se dote de son association spécialisée traquant toute critique (une plainte pour « discrimination envers la communauté des femmes rondes » a récemment été déposée) ? Que l’on ne puisse pas montrer, dans un reportage, un vigneron qui prend plaisir à boire son vin ? Que l’usage trop aisé de la diffamation soit devenu une arme politique ? Qu’un simple retweet puisse valoir une mise en examen ?
En abandonnant tout principe, le législateur a mis le juge dans la position impossible de rétablir le bon sens. En ajoutant exception après exception, restriction après restriction, il s’est fait l’homme de main d’une société frileuse et inhibitrice, détruisant cet « esprit français » fait d’excès, d’esprit et d’espoir.
Pour redonner à la France son blason de pays des Lumières, nous formulons six propositions dont le détail et les implications juridiques sont fournis en conclusion du rapport :
- Affranchir la liberté d’expression de l’idée de morale ou de vérité.
- Libérer les propos excessifs.
- Restreindre l’usage de la diffamation.
- Redéfinir le droit à la vie privée.
- Protéger les journalistes.
- Créer des zones de catharsis.
—
L’étude intitulée “Pour rétablir la liberté d’expression” est téléchargeable sur le site de GenerationLibre.
[*] Aurélien Portuese est juriste, maître de conférences à l’Université de Westminster et Gaspard Kœnig est philosophe, président de GenerationLibre.

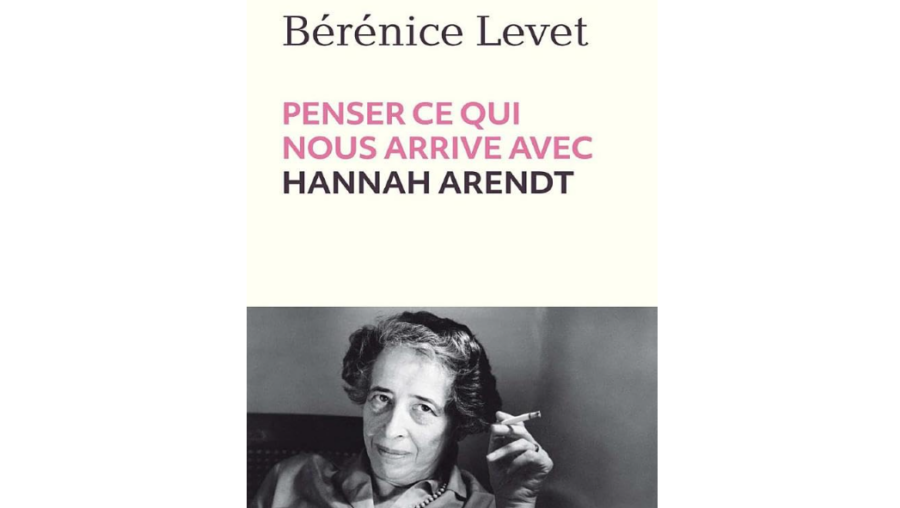


“Protéger les journalistes” : les détenteurs de la carte professionnelles ou les blogueurs ? Vu la capacité depuis longue date des premiers à chercher des protecteurs, il vaudrait mieux éclaircir ce point…
Les prôtéger des hommes politiques qui souhaiteraient que rien ne soit dit sur leurs magouilles.
Est ce que la meilleure défense ne serait pas l’attaque ?
A savoir ignorer ces lois dangereuses et continuer à s’exprimer librement avec sincérité ? Ne nous laissons plus toucher par ces menaces et ces intimidations.